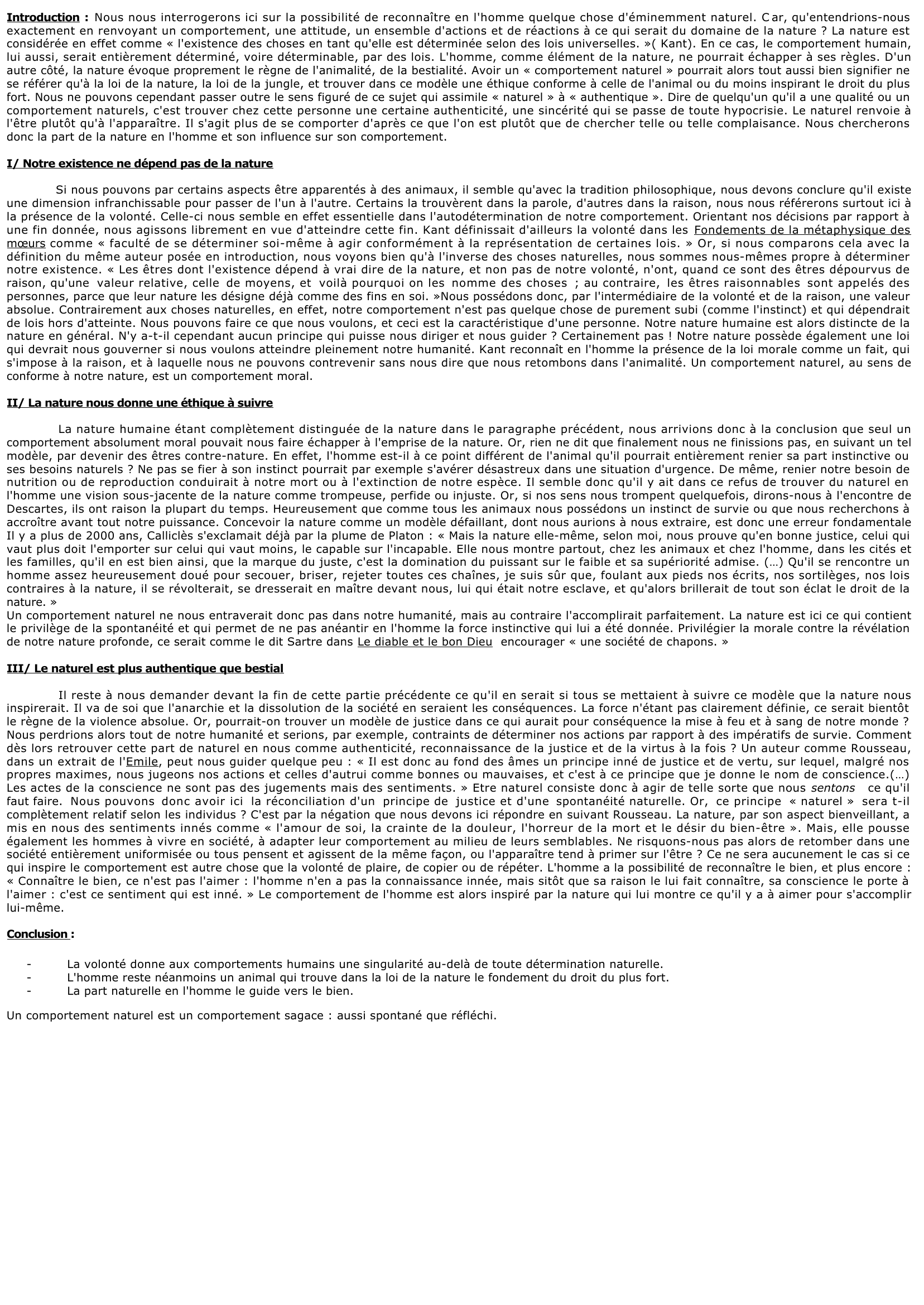Comportements naturels et comportements culturels ?
Extrait du document
xxx ?
«
Introduction : Nous nous interrogerons ici sur la possibilité de reconnaître en l'homme quelque chose d'éminemment naturel.
C ar, qu'entendrions-nous
exactement en renvoyant un comportement, une attitude, un ensemble d'actions et de réactions à ce qui serait du domaine de la nature ? La nature est
considérée en effet comme « l'existence des choses en tant qu'elle est déterminée selon des lois universelles.
»( Kant).
En ce cas, le comportement humain,
lui aussi, serait entièrement déterminé, voire déterminable, par des lois.
L'homme, comme élément de la nature, ne pourrait échapper à ses règles.
D'un
autre côté, la nature évoque proprement le règne de l'animalité, de la bestialité.
Avoir un « comportement naturel » pourrait alors tout aussi bien signifier ne
se référer qu'à la loi de la nature, la loi de la jungle, et trouver dans ce modèle une éthique conforme à celle de l'animal ou du moins inspirant le droit du plus
fort.
Nous ne pouvons cependant passer outre le sens figuré de ce sujet qui assimile « naturel » à « authentique ».
Dire de quelqu'un qu'il a une qualité ou un
comportement naturels, c'est trouver chez cette personne une certaine authenticité, une sincérité qui se passe de toute hypocrisie.
Le naturel renvoie à
l'être plutôt qu'à l'apparaître.
Il s'agit plus de se comporter d'après ce que l'on est plutôt que de chercher telle ou telle complaisance.
Nous chercherons
donc la part de la nature en l'homme et son influence sur son comportement.
I/ Notre existence ne dépend pas de la nature
Si nous pouvons par certains aspects être apparentés à des animaux, il semble qu'avec la tradition philosophique, nous devons conclure qu'il existe
une dimension infranchissable pour passer de l'un à l'autre.
Certains la trouvèrent dans la parole, d'autres dans la raison, nous nous référerons surtout ici à
la présence de la volonté.
Celle-ci nous semble en effet essentielle dans l'autodétermination de notre comportement.
Orientant nos décisions par rapport à
une fin donnée, nous agissons librement en vue d'atteindre cette fin.
Kant définissait d'ailleurs la volonté dans les Fondements de la métaphysique des
mœurs comme « faculté de se déterminer soi-même à agir conformément à la représentation de certaines lois.
» Or, si nous comparons cela avec la
définition du même auteur posée en introduction, nous voyons bien qu'à l'inverse des choses naturelles, nous sommes nous-mêmes propre à déterminer
notre existence.
« Les êtres dont l'existence dépend à vrai dire de la nature, et non pas de notre volonté, n'ont, quand ce sont des êtres dépourvus de
raison, qu'une valeur relative, celle de moyens, et voilà pourquoi on les nomme des choses ; au contraire, les êtres raisonnables sont appelés des
personnes, parce que leur nature les désigne déjà comme des fins en soi.
»Nous possédons donc, par l'intermédiaire de la volonté et de la raison, une valeur
absolue.
Contrairement aux choses naturelles, en effet, notre comportement n'est pas quelque chose de purement subi (comme l'instinct) et qui dépendrait
de lois hors d'atteinte.
Nous pouvons faire ce que nous voulons, et ceci est la caractéristique d'une personne.
Notre nature humaine est alors distincte de la
nature en général.
N'y a-t-il cependant aucun principe qui puisse nous diriger et nous guider ? Certainement pas ! Notre nature possède également une loi
qui devrait nous gouverner si nous voulons atteindre pleinement notre humanité.
Kant reconnaît en l'homme la présence de la loi morale comme un fait, qui
s'impose à la raison, et à laquelle nous ne pouvons contrevenir sans nous dire que nous retombons dans l'animalité.
Un comportement naturel, au sens de
conforme à notre nature, est un comportement moral.
II/ La nature nous donne une éthique à suivre
La nature humaine étant complètement distinguée de la nature dans le paragraphe précédent, nous arrivions donc à la conclusion que seul un
comportement absolument moral pouvait nous faire échapper à l'emprise de la nature.
Or, rien ne dit que finalement nous ne finissions pas, en suivant un tel
modèle, par devenir des êtres contre-nature.
En effet, l'homme est-il à ce point différent de l'animal qu'il pourrait entièrement renier sa part instinctive ou
ses besoins naturels ? Ne pas se fier à son instinct pourrait par exemple s'avérer désastreux dans une situation d'urgence.
De même, renier notre besoin de
nutrition ou de reproduction conduirait à notre mort ou à l'extinction de notre espèce.
Il semble donc qu'il y ait dans ce refus de trouver du naturel en
l'homme une vision sous-jacente de la nature comme trompeuse, perfide ou injuste.
Or, si nos sens nous trompent quelquefois, dirons-nous à l'encontre de
Descartes, ils ont raison la plupart du temps.
Heureusement que comme tous les animaux nous possédons un instinct de survie ou que nous recherchons à
accroître avant tout notre puissance.
Concevoir la nature comme un modèle défaillant, dont nous aurions à nous extraire, est donc une erreur fondamentale
Il y a plus de 2000 ans, Calliclès s'exclamait déjà par la plume de Platon : « Mais la nature elle-même, selon moi, nous prouve qu'en bonne justice, celui qui
vaut plus doit l'emporter sur celui qui vaut moins, le capable sur l'incapable.
Elle nous montre partout, chez les animaux et chez l'homme, dans les cités et
les familles, qu'il en est bien ainsi, que la marque du juste, c'est la domination du puissant sur le faible et sa supériorité admise.
(…) Qu'il se rencontre un
homme assez heureusement doué pour secouer, briser, rejeter toutes ces chaînes, je suis sûr que, foulant aux pieds nos écrits, nos sortilèges, nos lois
contraires à la nature, il se révolterait, se dresserait en maître devant nous, lui qui était notre esclave, et qu'alors brillerait de tout son éclat le droit de la
nature.
»
Un comportement naturel ne nous entraverait donc pas dans notre humanité, mais au contraire l'accomplirait parfaitement.
La nature est ici ce qui contient
le privilège de la spontanéité et qui permet de ne pas anéantir en l'homme la force instinctive qui lui a été donnée.
Privilégier la morale contre la révélation
de notre nature profonde, ce serait comme le dit Sartre dans Le diable et le bon Dieu encourager « une société de chapons.
»
III/ Le naturel est plus authentique que bestial
Il reste à nous demander devant la fin de cette partie précédente ce qu'il en serait si tous se mettaient à suivre ce modèle que la nature nous
inspirerait.
Il va de soi que l'anarchie et la dissolution de la société en seraient les conséquences.
La force n'étant pas clairement définie, ce serait bientôt
le règne de la violence absolue.
Or, pourrait-on trouver un modèle de justice dans ce qui aurait pour conséquence la mise à feu et à sang de notre monde ?
Nous perdrions alors tout de notre humanité et serions, par exemple, contraints de déterminer nos actions par rapport à des impératifs de survie.
Comment
dès lors retrouver cette part de naturel en nous comme authenticité, reconnaissance de la justice et de la virtus à la fois ? Un auteur comme Rousseau,
dans un extrait de l'Emile, peut nous guider quelque peu : « Il est donc au fond des âmes un principe inné de justice et de vertu, sur lequel, malgré nos
propres maximes, nous jugeons nos actions et celles d'autrui comme bonnes ou mauvaises, et c'est à ce principe que je donne le nom de conscience.(…)
Les actes de la conscience ne sont pas des jugements mais des sentiments.
» Etre naturel consiste donc à agir de telle sorte que nous sentons ce qu'il
faut faire.
Nous pouvons donc avoir ici la réconciliation d'un principe de justice et d'une spontanéité naturelle.
Or, ce principe « naturel » sera t-il
complètement relatif selon les individus ? C'est par la négation que nous devons ici répondre en suivant Rousseau.
La nature, par son aspect bienveillant, a
mis en nous des sentiments innés comme « l'amour de soi, la crainte de la douleur, l'horreur de la mort et le désir du bien-être ».
Mais, elle pousse
également les hommes à vivre en société, à adapter leur comportement au milieu de leurs semblables.
Ne risquons-nous pas alors de retomber dans une
société entièrement uniformisée ou tous pensent et agissent de la même façon, ou l'apparaître tend à primer sur l'être ? Ce ne sera aucunement le cas si ce
qui inspire le comportement est autre chose que la volonté de plaire, de copier ou de répéter.
L'homme a la possibilité de reconnaître le bien, et plus encore :
« Connaître le bien, ce n'est pas l'aimer : l'homme n'en a pas la connaissance innée, mais sitôt que sa raison le lui fait connaître, sa conscience le porte à
l'aimer : c'est ce sentiment qui est inné.
» Le comportement de l'homme est alors inspiré par la nature qui lui montre ce qu'il y a à aimer pour s'accomplir
lui-même.
Conclusion :
-
La volonté donne aux comportements humains une singularité au-delà de toute détermination naturelle.
L'homme reste néanmoins un animal qui trouve dans la loi de la nature le fondement du droit du plus fort.
La part naturelle en l'homme le guide vers le bien.
Un comportement naturel est un comportement sagace : aussi spontané que réfléchi..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Aristote: L'espace et la théorie des lieux naturels
- Les sentiments naturels de l'homme sont-ils pour la moralité un auxiliaire ou un obstacle ?
- Restreindre nos désirs à nos besoins naturels est ce possible est ce souhaitable ?
- Qu'est-ce qu'expliquer? Explique-t-on de la même manière les phénomènes naturels et la conduite humaine ?
- COURNOT: Bornons-nous [...] a considerer les phenomenes naturels...