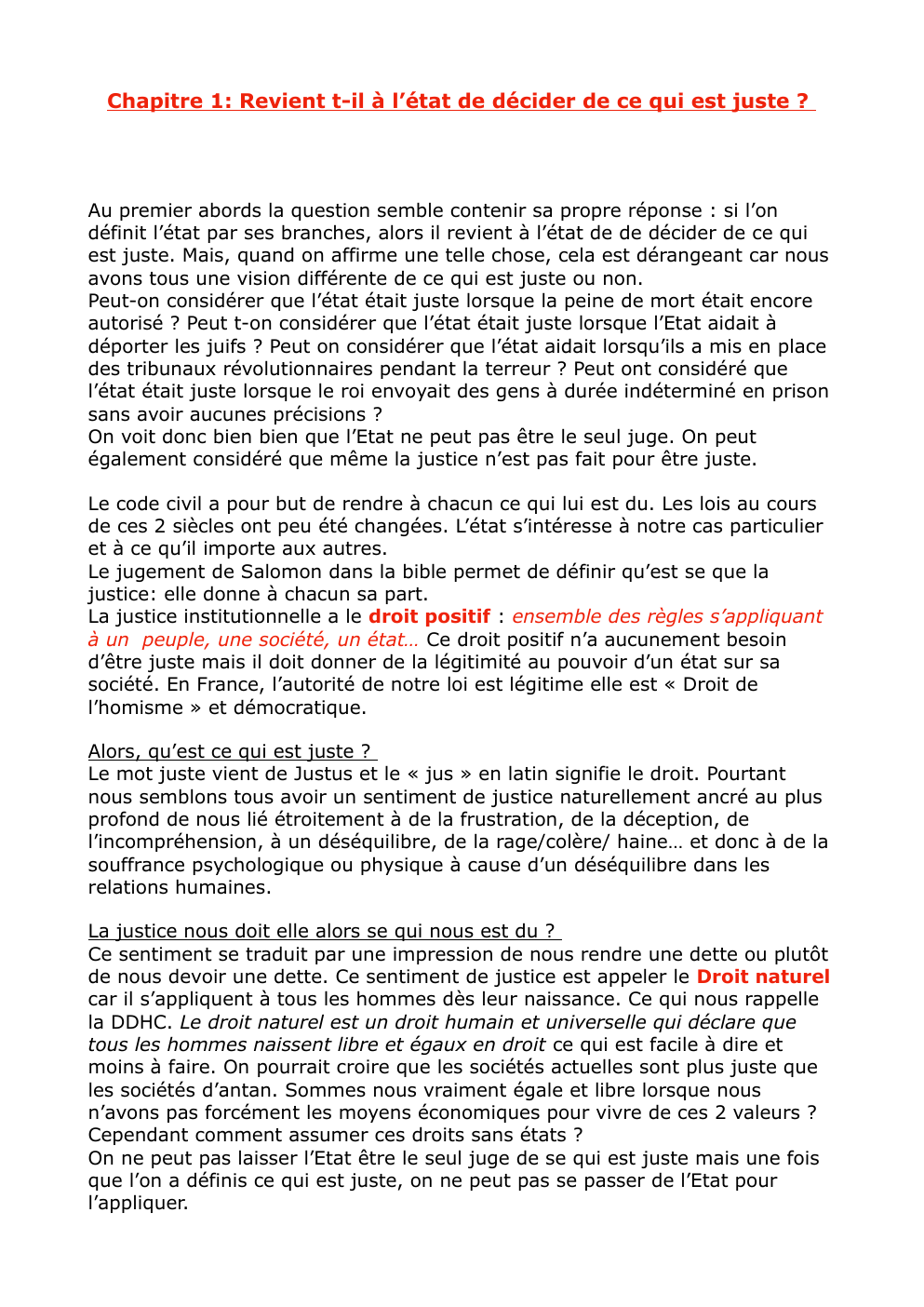Chapitre 1: Revient t-il à l’état de décider de ce qui est juste ?
Publié le 30/01/2025
Extrait du document
«
Chapitre 1: Revient t-il à l’état de décider de ce qui est juste ?
Au premier abords la question semble contenir sa propre réponse : si l’on
définit l’état par ses branches, alors il revient à l’état de de décider de ce qui
est juste.
Mais, quand on affirme une telle chose, cela est dérangeant car nous
avons tous une vision différente de ce qui est juste ou non.
Peut-on considérer que l’état était juste lorsque la peine de mort était encore
autorisé ? Peut t-on considérer que l’état était juste lorsque l’Etat aidait à
déporter les juifs ? Peut on considérer que l’état aidait lorsqu’ils a mis en place
des tribunaux révolutionnaires pendant la terreur ? Peut ont considéré que
l’état était juste lorsque le roi envoyait des gens à durée indéterminé en prison
sans avoir aucunes précisions ?
On voit donc bien bien que l’Etat ne peut pas être le seul juge.
On peut
également considéré que même la justice n’est pas fait pour être juste.
Le code civil a pour but de rendre à chacun ce qui lui est du.
Les lois au cours
de ces 2 siècles ont peu été changées.
L’état s’intéresse à notre cas particulier
et à ce qu’il importe aux autres.
Le jugement de Salomon dans la bible permet de définir qu’est se que la
justice: elle donne à chacun sa part.
La justice institutionnelle a le droit positif : ensemble des règles s’appliquant
à un peuple, une société, un état… Ce droit positif n’a aucunement besoin
d’être juste mais il doit donner de la légitimité au pouvoir d’un état sur sa
société.
En France, l’autorité de notre loi est légitime elle est « Droit de
l’homisme » et démocratique.
Alors, qu’est ce qui est juste ?
Le mot juste vient de Justus et le « jus » en latin signifie le droit.
Pourtant
nous semblons tous avoir un sentiment de justice naturellement ancré au plus
profond de nous lié étroitement à de la frustration, de la déception, de
l’incompréhension, à un déséquilibre, de la rage/colère/ haine… et donc à de la
souffrance psychologique ou physique à cause d’un déséquilibre dans les
relations humaines.
La justice nous doit elle alors se qui nous est du ?
Ce sentiment se traduit par une impression de nous rendre une dette ou plutôt
de nous devoir une dette.
Ce sentiment de justice est appeler le Droit naturel
car il s’appliquent à tous les hommes dès leur naissance.
Ce qui nous rappelle
la DDHC.
Le droit naturel est un droit humain et universelle qui déclare que
tous les hommes naissent libre et égaux en droit ce qui est facile à dire et
moins à faire.
On pourrait croire que les sociétés actuelles sont plus juste que
les sociétés d’antan.
Sommes nous vraiment égale et libre lorsque nous
n’avons pas forcément les moyens économiques pour vivre de ces 2 valeurs ?
Cependant comment assumer ces droits sans états ?
On ne peut pas laisser l’Etat être le seul juge de se qui est juste mais une fois
que l’on a définis ce qui est juste, on ne peut pas se passer de l’Etat pour
l’appliquer.
I Est-il juste de se passer de l’Etat ?
L’anarchisme considère que l’on peut se débarrasser de l’institution de l’état et
que l’homme est suffisamment intelligent pour se diriger tout seul.
L’Etat semble souvent être la source de l’injustice dans l’histoire : il justifiais
les inégalités féodales, le suffrage censitaire, le droit de vote uniquement
masculin…
La démocratie est très souvent utilisé pour régler le problème.
La démocratie
Athénienne est un contre exemple : elle est volontairement et consciemment
misogyne et esclavagiste.
De plus, notre démocratie peut être considérée
comme injuste car nous ne faisons pas nos propres lois et que nous ne
sommes pas forcément en accords avec notre gouvernement ce qui peut
entraînée l’antiparlementarisme.
La forme de l’Etat n’est donc pas la solution à adopter et à changer pour
résoudre ce problème.
Avec la modernité, cette question se manifeste de plus
en plus.
Durant la Renaissance par exemple, la découverte de l’Amérique, la
peste noir, le capitalisme, le développement de la bourgeoisie, la redécouverte
de l’antiquité et le protestantisme… vont venir faire changer les choses au
niveau de l Etat.
Ce changement se remarque également dans les philosophie
avec la scolastique (Aristote + Bible) qui est fragilisé et progressivement
détruite.
« L’Homme est un animal Politique » Aristote, les politiques.
Pour la
scolastique, l’homme est naturellement fait pour la sociétés.
Pour Aristote,
l'homme solitaire est donc soit un Dieu car il est autosuffisant ou un monstre
car il devient alors fou et agressif.
Pour Aristote, nous faisons tous partis d’une
même famille qui s’intègre dans la société.
Pourtant, c’est au XVIIe siècle, que ce principe s’écroule durant les guerres de
religions, suite à la division de l’Europe en deux groupes religieusement
opposés, que nous pourrions rapprocher à des guerres civiles d’une intensité
sans précédents (des familles peuvent se faire le guerre).
Henri IV a mis fin à ces guerres en France grâce aux édits de Nantes.
Thomas Hobbes, philosophe anglais , a été témoin d’une des dernière
ramifications qui sont les guerres civiles anglaises (1642-1646) qui détruit
20% de la population et écrit le Leviathan.
Selon lui, ce monstre marin biblique
est comparable à l’état.
Pour Hobbes, l Etat de nature est une tendance à la guerre lié à une disposition
au combat.
Dans les 2e paragraphe, il le qualifie d’un état sauvage dans lequel L’Homme
ne peut pas se développer car il a besoin d’être en groupe pour le faire.
Dans le paragraphe 3, il dit que les Hommes doivent passer une contrant
social.
Il définit le droit de nature comme une liberté de se défendre et donc un
droit à suivre.
Il existe également une loi de nature qu’il définit par une
interdiction d’aller contre son propre intérêt et donc de se suicider.
L’Etat de nature est donc contradictoire et qui ne peut être expliqué part la
raison, il faut donc passer un contrat social entre Hommes pour passer à l’état
social.
Pour le contrat, le droit de nature est remis entre les mains de l’Etat
donc une situation de monopole de la violence ce qui fait de l Etat une être
puissant.
Le terme de contrat, pour être remplacé par le terme constitution, de
nos jours.
L’Etat assume alors la sécurité par la force et donc également la
paix.
Dans le Léviathan, il compare l’état à un dieu mortel.
Le contrat fait en sorte que le droit de nature revient a l’état mais également
que la personne et donc son identité lui revient aussi, l’état devient alors notre
porteur d identité.
Grace à ça, l’état à une volonté d’action, il pense et agit
pour nous.
Cependant, le contrat peut être brisé s’il entre en contradiction avec
la loi de nature.
La conception de la justice, pour Hobbes ressemble donc à la loi du plus fort
car l’Etat préserve la sécurité par la force mais ce n’est pas un état fasciste.
Cependant, cette justice n est pas vraiment juste car l’homme, dans ce
système, n’est pas responsable de ses actes et qu’on ne peut faire justice qu’a
des hommes responsables.
Dans le Contrat sociale de Rousseau, Rousseau, inverse à celui de Hobbes.
Dans le contrat sociale, on retrouve le concept d’état de nature qui est un
état paradisiaque parce que pour lui nous ne pourrions pas être aussi libre qu’a
l’état de nature.
Pour lui, c’est la plus grande liberté .
Pour Rousseau, l’état sociale représenté l’enfer à cause de la propriété qui
s’oppose selon lui à la liberté et à l’égalité.
Pour lui, il faut changer l’état
sociale.
Les Hommes vont devoir s’entendre et proposer entre eux un contrat,
on remet alors alors notre droit de nature et donc notre liberté naturelle et
absolue aux mains de la société elle même qui fait de la société l’Etat.
Il y a
donc une égalité stricte de devoir établir entre tous les contractants et l Etat
est alors autonome car le peuple fais les lois, il y’a donc une liberté
conventionnelle.
Pour rousseau, l’unité est importante, il pense alors à la
volonté générale: chaque individus doit se soumettre au point de vue du
groupe, il faut donc se désintéresser et se mettre à la place d’autrui en, faisant
preuve de pitié.
Les partis politique sont pour Rousseau ce qu’il y a de pire car ces derniers
sont intéressés et rendent pour lui le système encore plus injuste.
Une
démocratie directe, selon Rousseau ne peut exister que pour des petits pays.
Cette idée se retrouve dans la 1er devise française : « La nation et la loi ».
Le
principe de Nation devient alors important, pendant la révolution Française,
car la figure du roi perd sa légitimité progressivement, la nation remplace le
roi.
Chez Hobbes et Rousseau, nous pouvons quand même distinguer un default: il
n y a pas de séparation des pouvoirs.
Montesquieu y pense dans L’Esprit des
lois.
Cependant....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Chapitre 11. Axe 1. Comment définir et mesurer la mobilité sociale ?
- chapitre génétique
- Stratification sociale: Chapitre 4 Comment est structurée la société française actuelle ?
- Chapitre de SES : la déviance sociale
- Soren KIERKEGAARD (1813-1855) Ou bien ... ou bien, chapitre L'Assolement: commentaire