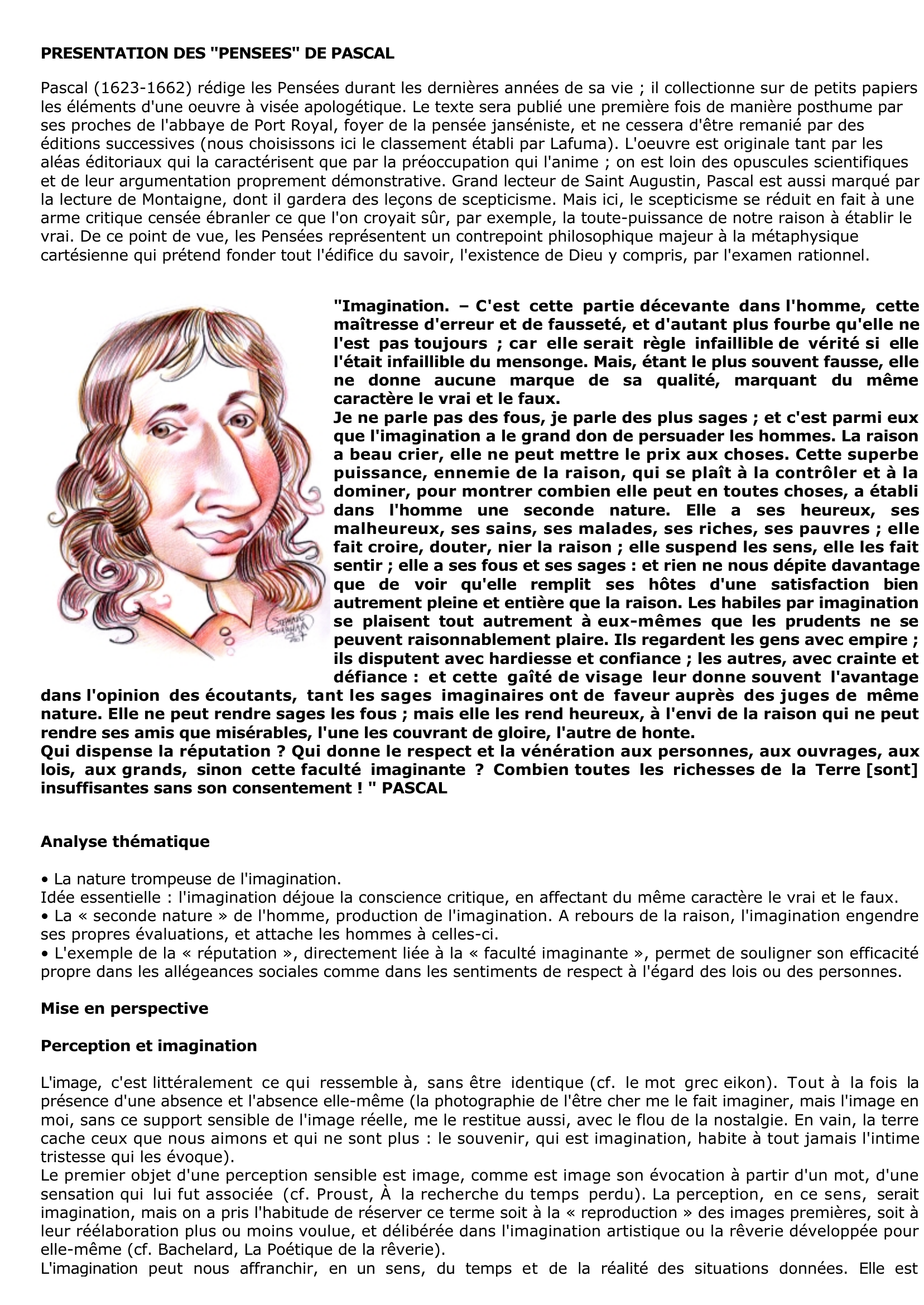Blaise PASCAL
Extrait du document
«
PRESENTATION DES "PENSEES" DE PASCAL
Pascal (1623-1662) rédige les Pensées durant les dernières années de sa vie ; il collectionne sur de petits papiers
les éléments d'une oeuvre à visée apologétique.
Le texte sera publié une première fois de manière posthume par
ses proches de l'abbaye de Port Royal, foyer de la pensée janséniste, et ne cessera d'être remanié par des
éditions successives (nous choisissons ici le classement établi par Lafuma).
L'oeuvre est originale tant par les
aléas éditoriaux qui la caractérisent que par la préoccupation qui l'anime ; on est loin des opuscules scientifiques
et de leur argumentation proprement démonstrative.
Grand lecteur de Saint Augustin, Pascal est aussi marqué par
la lecture de Montaigne, dont il gardera des leçons de scepticisme.
Mais ici, le scepticisme se réduit en fait à une
arme critique censée ébranler ce que l'on croyait sûr, par exemple, la toute-puissance de notre raison à établir le
vrai.
De ce point de vue, les Pensées représentent un contrepoint philosophique majeur à la métaphysique
cartésienne qui prétend fonder tout l'édifice du savoir, l'existence de Dieu y compris, par l'examen rationnel.
"Imagination.
– C'est cette partie décevante dans l'homme, cette
maîtresse d'erreur et de fausseté, et d'autant plus fourbe qu'elle ne
l'est pas toujours ; car elle serait règle infaillible de vérité si elle
l'était infaillible du mensonge.
Mais, étant le plus souvent fausse, elle
ne donne aucune marque de sa qualité, marquant du même
caractère le vrai et le faux.
Je ne parle pas des fous, je parle des plus sages ; et c'est parmi eux
que l'imagination a le grand don de persuader les hommes.
La raison
a beau crier, elle ne peut mettre le prix aux choses.
Cette superbe
puissance, ennemie de la raison, qui se plaît à la contrôler et à la
dominer, pour montrer combien elle peut en toutes choses, a établi
dans l'homme une seconde nature.
Elle a ses heureux, ses
malheureux, ses sains, ses malades, ses riches, ses pauvres ; elle
fait croire, douter, nier la raison ; elle suspend les sens, elle les fait
sentir ; elle a ses fous et ses sages : et rien ne nous dépite davantage
que de voir qu'elle remplit ses hôtes d'une satisfaction bien
autrement pleine et entière que la raison.
Les habiles par imagination
se plaisent tout autrement à eux-mêmes que les prudents ne se
peuvent raisonnablement plaire.
Ils regardent les gens avec empire ;
ils disputent avec hardiesse et confiance ; les autres, avec crainte et
défiance : et cette gaîté de visage leur donne souvent l'avantage
dans l'opinion des écoutants, tant les sages imaginaires ont de faveur auprès des juges de même
nature.
Elle ne peut rendre sages les fous ; mais elle les rend heureux, à l'envi de la raison qui ne peut
rendre ses amis que misérables, l'une les couvrant de gloire, l'autre de honte.
Qui dispense la réputation ? Qui donne le respect et la vénération aux personnes, aux ouvrages, aux
lois, aux grands, sinon cette faculté imaginante ? Combien toutes les richesses de la Terre [sont]
insuffisantes sans son consentement ! " PASCAL
Analyse thématique
• La nature trompeuse de l'imagination.
Idée essentielle : l'imagination déjoue la conscience critique, en affectant du même caractère le vrai et le faux.
• La « seconde nature » de l'homme, production de l'imagination.
A rebours de la raison, l'imagination engendre
ses propres évaluations, et attache les hommes à celles-ci.
• L'exemple de la « réputation », directement liée à la « faculté imaginante », permet de souligner son efficacité
propre dans les allégeances sociales comme dans les sentiments de respect à l'égard des lois ou des personnes.
Mise en perspective
Perception et imagination
L'image, c'est littéralement ce qui ressemble à, sans être identique (cf.
le mot grec eikon).
Tout à la fois la
présence d'une absence et l'absence elle-même (la photographie de l'être cher me le fait imaginer, mais l'image en
moi, sans ce support sensible de l'image réelle, me le restitue aussi, avec le flou de la nostalgie.
En vain, la terre
cache ceux que nous aimons et qui ne sont plus : le souvenir, qui est imagination, habite à tout jamais l'intime
tristesse qui les évoque).
Le premier objet d'une perception sensible est image, comme est image son évocation à partir d'un mot, d'une
sensation qui lui fut associée (cf.
Proust, À la recherche du temps perdu).
La perception, en ce sens, serait
imagination, mais on a pris l'habitude de réserver ce terme soit à la « reproduction » des images premières, soit à
leur réélaboration plus ou moins voulue, et délibérée dans l'imagination artistique ou la rêverie développée pour
elle-même (cf.
Bachelard, La Poétique de la rêverie).
L'imagination peut nous affranchir, en un sens, du temps et de la réalité des situations données.
Elle est.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire Blaise pascal, Pensées: richesse et vérité
- L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant - Blaise Pascal (1623-1662)
- Blaise PASCAL: la justice n'est pas dans les coutumes
- Blaise PASCAL: Quelque condition qu'on se figure
- Blaise PASCAL