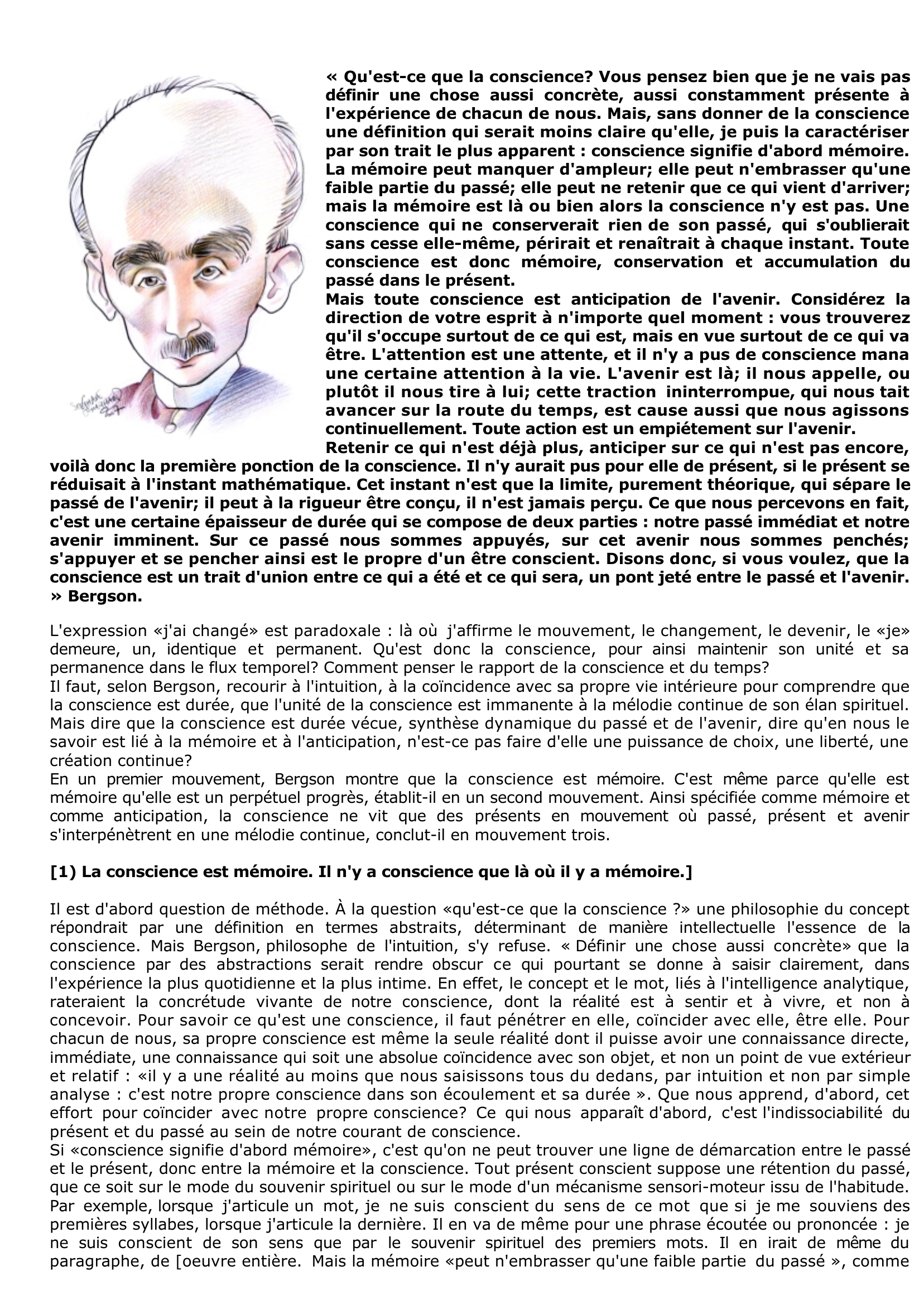Bergson
Extrait du document
«
« Qu'est-ce que la conscience? Vous pensez bien que je ne vais pas
définir une chose aussi concrète, aussi constamment présente à
l'expérience de chacun de nous.
Mais, sans donner de la conscience
une définition qui serait moins claire qu'elle, je puis la caractériser
par son trait le plus apparent : conscience signifie d'abord mémoire.
La mémoire peut manquer d'ampleur; elle peut n'embrasser qu'une
faible partie du passé; elle peut ne retenir que ce qui vient d'arriver;
mais la mémoire est là ou bien alors la conscience n'y est pas.
Une
conscience qui ne conserverait rien de son passé, qui s'oublierait
sans cesse elle-même, périrait et renaîtrait à chaque instant.
Toute
conscience est donc mémoire, conservation et accumulation du
passé dans le présent.
Mais toute conscience est anticipation de l'avenir.
Considérez la
direction de votre esprit à n'importe quel moment : vous trouverez
qu'il s'occupe surtout de ce qui est, mais en vue surtout de ce qui va
être.
L'attention est une attente, et il n'y a pus de conscience mana
une certaine attention à la vie.
L'avenir est là; il nous appelle, ou
plutôt il nous tire à lui; cette traction ininterrompue, qui nous tait
avancer sur la route du temps, est cause aussi que nous agissons
continuellement.
Toute action est un empiétement sur l'avenir.
Retenir ce qui n'est déjà plus, anticiper sur ce qui n'est pas encore,
voilà donc la première ponction de la conscience.
Il n'y aurait pus pour elle de présent, si le présent se
réduisait à l'instant mathématique.
Cet instant n'est que la limite, purement théorique, qui sépare le
passé de l'avenir; il peut à la rigueur être conçu, il n'est jamais perçu.
Ce que nous percevons en fait,
c'est une certaine épaisseur de durée qui se compose de deux parties : notre passé immédiat et notre
avenir imminent.
Sur ce passé nous sommes appuyés, sur cet avenir nous sommes penchés;
s'appuyer et se pencher ainsi est le propre d'un être conscient.
Disons donc, si vous voulez, que la
conscience est un trait d'union entre ce qui a été et ce qui sera, un pont jeté entre le passé et l'avenir.
» Bergson.
L'expression «j'ai changé» est paradoxale : là où j'affirme le mouvement, le changement, le devenir, le «je»
demeure, un, identique et permanent.
Qu'est donc la conscience, pour ainsi maintenir son unité et sa
permanence dans le flux temporel? Comment penser le rapport de la conscience et du temps?
Il faut, selon Bergson, recourir à l'intuition, à la coïncidence avec sa propre vie intérieure pour comprendre que
la conscience est durée, que l'unité de la conscience est immanente à la mélodie continue de son élan spirituel.
Mais dire que la conscience est durée vécue, synthèse dynamique du passé et de l'avenir, dire qu'en nous le
savoir est lié à la mémoire et à l'anticipation, n'est-ce pas faire d'elle une puissance de choix, une liberté, une
création continue?
En un premier mouvement, Bergson montre que la conscience est mémoire.
C'est même parce qu'elle est
mémoire qu'elle est un perpétuel progrès, établit-il en un second mouvement.
Ainsi spécifiée comme mémoire et
comme anticipation, la conscience ne vit que des présents en mouvement où passé, présent et avenir
s'interpénètrent en une mélodie continue, conclut-il en mouvement trois.
[1) La conscience est mémoire.
Il n'y a conscience que là où il y a mémoire.]
Il est d'abord question de méthode.
À la question «qu'est-ce que la conscience ?» une philosophie du concept
répondrait par une définition en termes abstraits, déterminant de manière intellectuelle l'essence de la
conscience.
Mais Bergson, philosophe de l'intuition, s'y refuse.
« Définir une chose aussi concrète» que la
conscience par des abstractions serait rendre obscur ce qui pourtant se donne à saisir clairement, dans
l'expérience la plus quotidienne et la plus intime.
En effet, le concept et le mot, liés à l'intelligence analytique,
rateraient la concrétude vivante de notre conscience, dont la réalité est à sentir et à vivre, et non à
concevoir.
Pour savoir ce qu'est une conscience, il faut pénétrer en elle, coïncider avec elle, être elle.
Pour
chacun de nous, sa propre conscience est même la seule réalité dont il puisse avoir une connaissance directe,
immédiate, une connaissance qui soit une absolue coïncidence avec son objet, et non un point de vue extérieur
et relatif : «il y a une réalité au moins que nous saisissons tous du dedans, par intuition et non par simple
analyse : c'est notre propre conscience dans son écoulement et sa durée ».
Que nous apprend, d'abord, cet
effort pour coïncider avec notre propre conscience? Ce qui nous apparaît d'abord, c'est l'indissociabilité du
présent et du passé au sein de notre courant de conscience.
Si «conscience signifie d'abord mémoire», c'est qu'on ne peut trouver une ligne de démarcation entre le passé
et le présent, donc entre la mémoire et la conscience.
Tout présent conscient suppose une rétention du passé,
que ce soit sur le mode du souvenir spirituel ou sur le mode d'un mécanisme sensori-moteur issu de l'habitude.
Par exemple, lorsque j'articule un mot, je ne suis conscient du sens de ce mot que si je me souviens des
premières syllabes, lorsque j'articule la dernière.
Il en va de même pour une phrase écoutée ou prononcée : je
ne suis conscient de son sens que par le souvenir spirituel des premiers mots.
Il en irait de même du
paragraphe, de [oeuvre entière.
Mais la mémoire «peut n'embrasser qu'une faible partie du passé », comme.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- [Affinités de l'art et de la philosophie] Bergson
- Henri BERGSON (1859-1941) La Pensée et le Mouvant, chap. V (commentaire)
- Bergson étude de texte: liberté et invention
- Explication de texte : Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience
- Explication d'un texte de Bergson sur la conscience