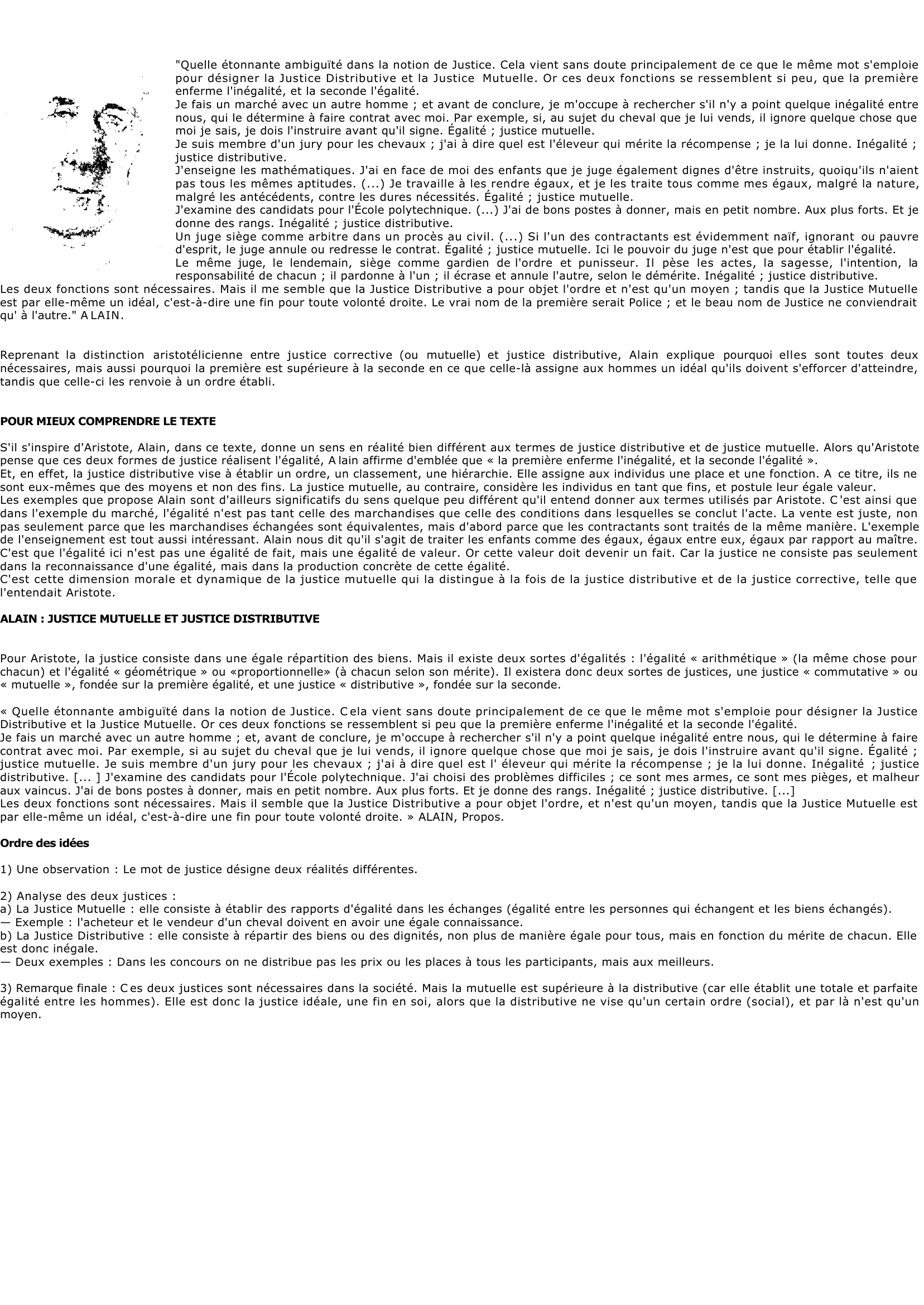Alain
Extrait du document
«
"Quelle étonnante ambiguïté dans la notion de Justice.
Cela vient sans doute principalement de ce que le même mot s'emploie
pour désigner la Justice Distributive et la Justice Mutuelle.
Or ces deux fonctions se ressemblent si peu, que la première
enferme l'inégalité, et la seconde l'égalité.
Je fais un marché avec un autre homme ; et avant de conclure, je m'occupe à rechercher s'il n'y a point quelque inégalité entre
nous, qui le détermine à faire contrat avec moi.
Par exemple, si, au sujet du cheval que je lui vends, il ignore quelque chose que
moi je sais, je dois l'instruire avant qu'il signe.
Égalité ; justice mutuelle.
Je suis membre d'un jury pour les chevaux ; j'ai à dire quel est l'éleveur qui mérite la récompense ; je la lui donne.
Inégalité ;
justice distributive.
J'enseigne les mathématiques.
J'ai en face de moi des enfants que je juge également dignes d'être instruits, quoiqu'ils n'aient
pas tous les mêmes aptitudes.
(...) Je travaille à les rendre égaux, et je les traite tous comme mes égaux, malgré la nature,
malgré les antécédents, contre les dures nécessités.
Égalité ; justice mutuelle.
J'examine des candidats pour l'École polytechnique.
(...) J'ai de bons postes à donner, mais en petit nombre.
Aux plus forts.
Et je
donne des rangs.
Inégalité ; justice distributive.
Un juge siège comme arbitre dans un procès au civil.
(...) Si l'un des contractants est évidemment naïf, ignorant ou pauvre
d'esprit, le juge annule ou redresse le contrat.
Égalité ; justice mutuelle.
Ici le pouvoir du juge n'est que pour établir l'égalité.
Le même juge, le lendemain, siège comme gardien de l'ordre et punisseur.
Il pèse les actes, la sagesse, l'intention, la
responsabilité de chacun ; il pardonne à l'un ; il écrase et annule l'autre, selon le démérite.
Inégalité ; justice distributive.
Les deux fonctions sont nécessaires.
Mais il me semble que la Justice Distributive a pour objet l'ordre et n'est qu'un moyen ; tandis que la Justice Mutuelle
est par elle-même un idéal, c'est-à-dire une fin pour toute volonté droite.
Le vrai nom de la première serait Police ; et le beau nom de Justice ne conviendrait
qu' à l'autre." A LAIN.
Reprenant la distinction aristotélicienne entre justice corrective (ou mutuelle) et justice distributive, Alain explique pourquoi elles sont toutes deux
nécessaires, mais aussi pourquoi la première est supérieure à la seconde en ce que celle-là assigne aux hommes un idéal qu'ils doivent s'efforcer d'atteindre,
tandis que celle-ci les renvoie à un ordre établi.
POUR MIEUX COMPRENDRE LE TEXTE
S'il s'inspire d'Aristote, Alain, dans ce texte, donne un sens en réalité bien différent aux termes de justice distributive et de justice mutuelle.
Alors qu'Aristote
pense que ces deux formes de justice réalisent l'égalité, A lain affirme d'emblée que « la première enferme l'inégalité, et la seconde l'égalité ».
Et, en effet, la justice distributive vise à établir un ordre, un classement, une hiérarchie.
Elle assigne aux individus une place et une fonction.
A ce titre, ils ne
sont eux-mêmes que des moyens et non des fins.
La justice mutuelle, au contraire, considère les individus en tant que fins, et postule leur égale valeur.
Les exemples que propose Alain sont d'ailleurs significatifs du sens quelque peu différent qu'il entend donner aux termes utilisés par Aristote.
C 'est ainsi que
dans l'exemple du marché, l'égalité n'est pas tant celle des marchandises que celle des conditions dans lesquelles se conclut l'acte.
La vente est juste, non
pas seulement parce que les marchandises échangées sont équivalentes, mais d'abord parce que les contractants sont traités de la même manière.
L'exemple
de l'enseignement est tout aussi intéressant.
Alain nous dit qu'il s'agit de traiter les enfants comme des égaux, égaux entre eux, égaux par rapport au maître.
C'est que l'égalité ici n'est pas une égalité de fait, mais une égalité de valeur.
Or cette valeur doit devenir un fait.
Car la justice ne consiste pas seulement
dans la reconnaissance d'une égalité, mais dans la production concrète de cette égalité.
C'est cette dimension morale et dynamique de la justice mutuelle qui la distingue à la fois de la justice distributive et de la justice corrective, telle que
l'entendait Aristote.
ALAIN : JUSTICE MUTUELLE ET JUSTICE DISTRIBUTIVE
Pour Aristote, la justice consiste dans une égale répartition des biens.
Mais il existe deux sortes d'égalités : l'égalité « arithmétique » (la même chose pour
chacun) et l'égalité « géométrique » ou «proportionnelle» (à chacun selon son mérite).
Il existera donc deux sortes de justices, une justice « commutative » ou
« mutuelle », fondée sur la première égalité, et une justice « distributive », fondée sur la seconde.
« Quelle étonnante ambiguïté dans la notion de Justice.
C ela vient sans doute principalement de ce que le même mot s'emploie pour désigner la Justice
Distributive et la Justice Mutuelle.
Or ces deux fonctions se ressemblent si peu que la première enferme l'inégalité et la seconde l'égalité.
Je fais un marché avec un autre homme ; et, avant de conclure, je m'occupe à rechercher s'il n'y a point quelque inégalité entre nous, qui le détermine à faire
contrat avec moi.
Par exemple, si au sujet du cheval que je lui vends, il ignore quelque chose que moi je sais, je dois l'instruire avant qu'il signe.
Égalité ;
justice mutuelle.
Je suis membre d'un jury pour les chevaux ; j'ai à dire quel est l' éleveur qui mérite la récompense ; je la lui donne.
Inégalité ; justice
distributive.
[...
] J'examine des candidats pour l'École polytechnique.
J'ai choisi des problèmes difficiles ; ce sont mes armes, ce sont mes pièges, et malheur
aux vaincus.
J'ai de bons postes à donner, mais en petit nombre.
Aux plus forts.
Et je donne des rangs.
Inégalité ; justice distributive.
[...]
Les deux fonctions sont nécessaires.
Mais il semble que la Justice Distributive a pour objet l'ordre, et n'est qu'un moyen, tandis que la Justice Mutuelle est
par elle-même un idéal, c'est-à-dire une fin pour toute volonté droite.
» ALAIN, Propos.
Ordre des idées
1) Une observation : Le mot de justice désigne deux réalités différentes.
2) Analyse des deux justices :
a) La Justice Mutuelle : elle consiste à établir des rapports d'égalité dans les échanges (égalité entre les personnes qui échangent et les biens échangés).
— Exemple : l'acheteur et le vendeur d'un cheval doivent en avoir une égale connaissance.
b) La Justice Distributive : elle consiste à répartir des biens ou des dignités, non plus de manière égale pour tous, mais en fonction du mérite de chacun.
Elle
est donc inégale.
— Deux exemples : Dans les concours on ne distribue pas les prix ou les places à tous les participants, mais aux meilleurs.
3) Remarque finale : C es deux justices sont nécessaires dans la société.
Mais la mutuelle est supérieure à la distributive (car elle établit une totale et parfaite
égalité entre les hommes).
Elle est donc la justice idéale, une fin en soi, alors que la distributive ne vise qu'un certain ordre (social), et par là n'est qu'un
moyen..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Alain et l'intelligence humaine
- [ Art, jeu et travail ] Alain
- Explication philosophique d'un texte d'Alain sur le sujet
- Alain et la technique
- ALAIN : toute passion est malheureuse