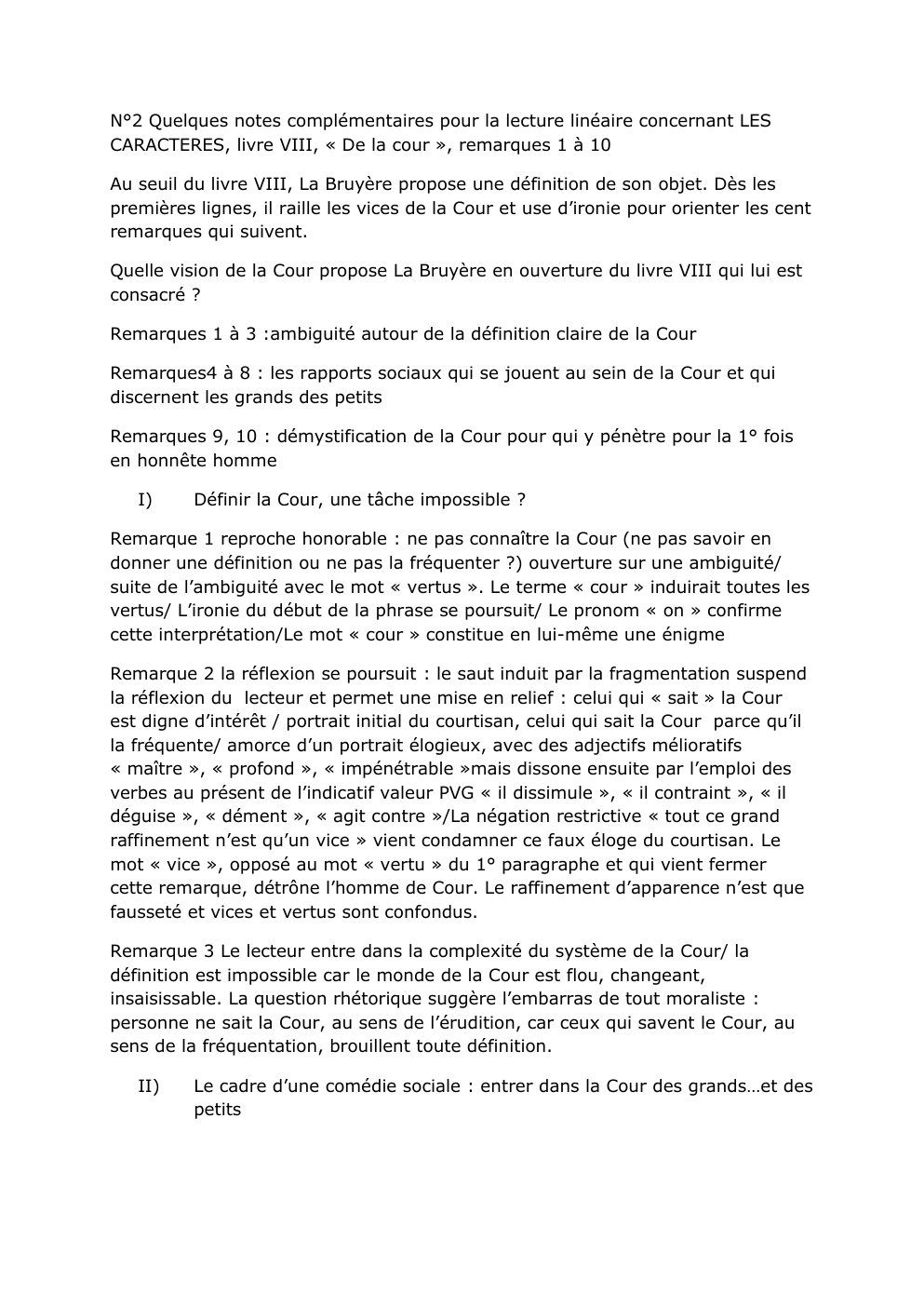Remarque 1 a 10, livre 8 Les Caracteres
Publié le 11/03/2023
Extrait du document
«
N°2 Quelques notes complémentaires pour la lecture linéaire concernant LES
CARACTERES, livre VIII, « De la cour », remarques 1 à 10
Au seuil du livre VIII, La Bruyère propose une définition de son objet.
Dès les
premières lignes, il raille les vices de la Cour et use d’ironie pour orienter les cent
remarques qui suivent.
Quelle vision de la Cour propose La Bruyère en ouverture du livre VIII qui lui est
consacré ?
Remarques 1 à 3 :ambiguité autour de la définition claire de la Cour
Remarques4 à 8 : les rapports sociaux qui se jouent au sein de la Cour et qui
discernent les grands des petits
Remarques 9, 10 : démystification de la Cour pour qui y pénètre pour la 1° fois
en honnête homme
I)
Définir la Cour, une tâche impossible ?
Remarque 1 reproche honorable : ne pas connaître la Cour (ne pas savoir en
donner une définition ou ne pas la fréquenter ?) ouverture sur une ambiguité/
suite de l’ambiguité avec le mot « vertus ».
Le terme « cour » induirait toutes les
vertus/ L’ironie du début de la phrase se poursuit/ Le pronom « on » confirme
cette interprétation/Le mot « cour » constitue en lui-même une énigme
Remarque 2 la réflexion se poursuit : le saut induit par la fragmentation suspend
la réflexion du lecteur et permet une mise en relief : celui qui « sait » la Cour
est digne d’intérêt / portrait initial du courtisan, celui qui sait la Cour parce qu’il
la fréquente/ amorce d’un portrait élogieux, avec des adjectifs mélioratifs
« maître », « profond », « impénétrable »mais dissone ensuite par l’emploi des
verbes au présent de l’indicatif valeur PVG « il dissimule », « il contraint », « il
déguise », « dément », « agit contre »/La négation restrictive « tout ce grand
raffinement n’est qu’un vice » vient condamner ce faux éloge du courtisan.
Le
mot « vice », opposé au mot « vertu » du 1° paragraphe et qui vient fermer
cette remarque, détrône l’homme de Cour.
Le raffinement d’apparence n’est que
fausseté et vices et vertus sont confondus.
Remarque 3 Le lecteur entre dans la complexité du système de la Cour/ la
définition est impossible car le monde de la Cour est flou, changeant,
insaisissable.
La question rhétorique suggère l’embarras de tout moraliste :
personne ne sait la Cour, au sens de l’érudition, car ceux qui savent le Cour, au
sens de la fréquentation, brouillent toute définition.
II)
Le cadre d’une comédie sociale : entrer dans la Cour des grands…et des
petits
Le moraliste cherche à orienter son regard et à distinguer, derrière le voile, la
vérité
Remarque 4 la permanence de la Cour ne tient qu’à la fidélité de ses sujets, les
courtisans.
S’éloigner de la Cour, c’est perdre son statut, c’est perdre toute
reconnaissance
Remarque 5 prolongation de cette idée selon laquelle tout courtisan est un petit
homme.
Ce qui est immense (c’est confirmé dans la remarque 10 qui en fait un
édifice de marbre) c’est la Cour.
Ce serait cette chose abstraite, ni tout à fait un
lieu, ni tout à fait une communauté, constituée d’hommes troubles,
faux ,changeants, mais dont la permanence et la pérennité tiennent à la
constance fréquentation de ses sujets.
En distinguant petits et grands , La
Bruyère projette le propos vers le livre IX, dédié aux Grands, et poursuit la
gradation du peuple au souverain, en émettant un jugement cruel : toute idée de
grandeur courtisane est pure vanité.
Remarque 6 La Bruyère fissure encore davantage son objet pour mieux le
comprendre : ce qui se voit de loin, de la province, n’est pas la réalité.
La
« chose admirable » vue de loin perd tout son charme lorsqu’on s’en approche.
Il
propose une métaphore de l’exploration : on voit de loin sa destination (en
perspective), on s’émeut à la découverte d’un nouveau monde et on peut être
déçu quand on atteint son but.
Remarque 7 et 8 tirent la conséquence d’un constat amer : la Cour se fait
lointaine, inaccessible, non pour rendre heureux ses sujets mais par vice, pour
empêcher le bonheur des non-courtisans/ Dans l’énumération de la remarque 7
« dans une....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n’en lisent qu’une page » AUGUSTIN D’HIPPONE
- « ARRIAS » LIVRE V FRAGMENT 9
- Commentaire de texte Platon de la République (livre III)
- Commentaire de texte Epictète: chapitre 28 du livre I des Entretiens
- David HUME - Traité de la nature humaine - livre I, quatrième partie, section VI