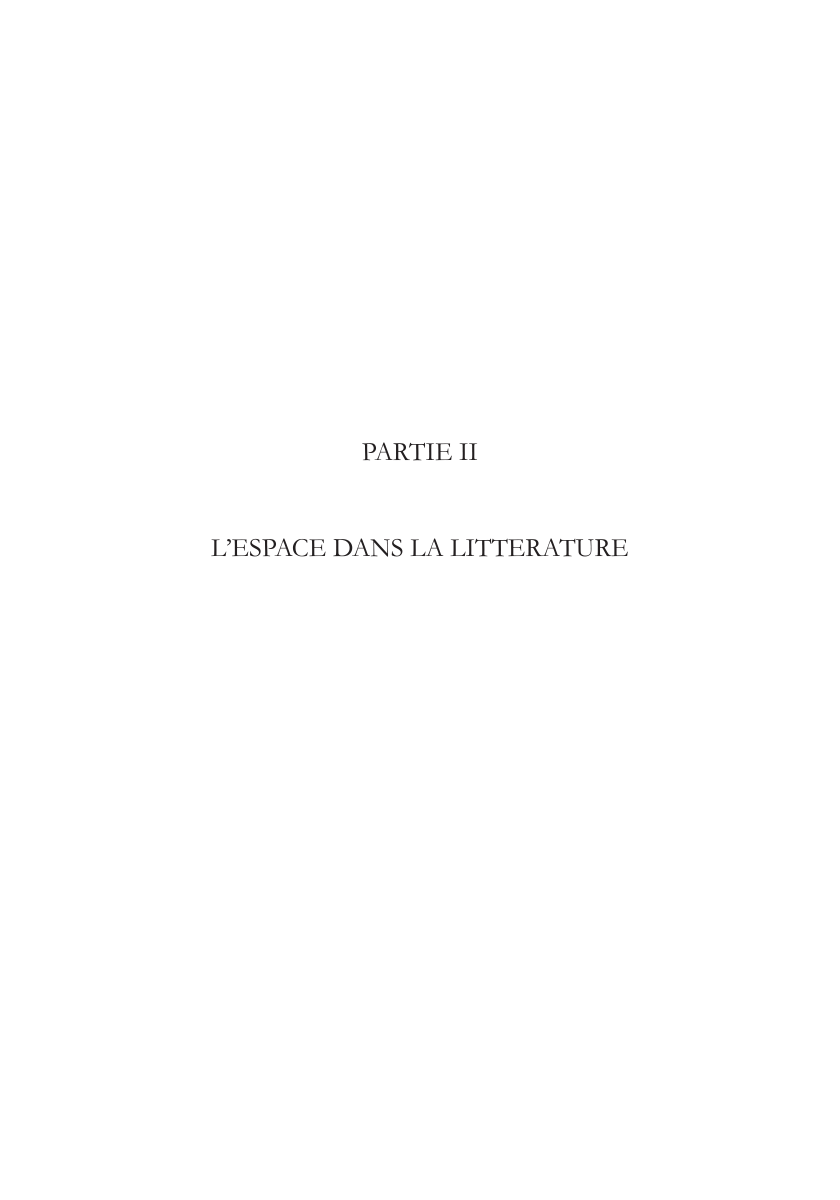PARTIE_II_LESPACE_DANS_LA_LITTERATURE
Publié le 14/01/2024
Extrait du document
«
PARTIE II
L’ESPACE DANS LA LITTERATURE
« Espaces clos, espaces ouverts : la symbolique du cadre
spatial dans les romans d’Aminata Sow Fall »
Assane Ndiaye
Université Assane SECK/Ziguinchor
Résumé : Les critiques de la littérature ne cessent d’accorder une importance particulière à
la représentation de l’univers dans les œuvres littéraires, chaque auteur plaçant son récit dans
un cadre qui suscite beaucoup d’interrogations.
Les romanciers africains, conscients du rôle
déterminant que joue le cadre spatial dans leurs ouvrages, tentent de diversifier l’espace pour
donner à chaque milieu une orientation précise et significative.
La critique de l’espace peut
alors aider à saisir le sens caché des sphères dans lesquelles évoluent les personnages.
Dans
cette optique, la lecture des romans d’Aminata Sow Fall révèle l’intérêt que la romancière
sénégalaise accorde à l’espace dans sa création.
La présente étude s’intéresse au sens profond
de divers espaces évoqués dans l’univers romanesque d’Aminata Sow Fall en s’appuyant sur
cinq de ses romans.
Par une démarche thématico-stylisque, nous avons cherché à comprendre la
symbolique du cadre spatial dans les romans de cette écrivaine sénégalaise éprise de détails.
Mots-clés : espace, univers romanesque, ouvert, fermé
Introduction
La notion d’espace est intimement liée à la création littéraire.
Qu’il soit romanesque,
théâtral, poétique…, « l’espace littéraire » (Cortès, 2014 : 12) occupe une place importante
dans la recherche scientifique.
Pour beaucoup de chercheurs, il est souvent question de
s’intéresser aux significations diverses des cadres spatiaux.
Ki-Jeong Song a réfléchi sur
« La Sémiotique de l’espace » (Song, 2012), Kristina Kohoutová sur le « Rôle du temps et
de l’espace » (Kohoutová, 2010).
Quant à certains critiques, ils ont consacré entièrement
leur ouvrage à l’étude de la même thématique.
Maurice Blanchot publie L’Espace littéraire
en 1955 et Florence Paravy L’Espace dans le roman africain francophone contemporain en 1999.
Pour ces spécialistes de la littérature, il ne convient certes pas d’étudier l’espace comme des
géographes, mais de s’intéresser au sens profond de chaque cadre spatial représenté dans
les œuvres littéraires.
Faut-il souligner que c’est bien l’intérêt accordé par les écrivains à la
représentation de l’espace, surtout les romanciers, qui mène les chercheurs à réserver une
place de choix à l’étude du village, de la ville, par exemple ? Dans plusieurs romans négroafricains comme Maïmouna (Sadji, 1968), Afrika Ba’a (Médou-Mvomo, 1969), Les Soleils des
Indépendances (Kourouma, 1970), Le Revenant (Fall, 1976), pour ne citer que ceux-là, c’est
149
Les Cahiers du CREILAC
surtout la différence entre la ville et le village qui est mise en valeur.
Pour notre propos, il
ne s’agira pas de s’intéresser à ces deux types d’espaces suffisamment élucidés.
En axant
notre analyse sur les œuvres de la romancière sénégalaise Aminata Sow Fall, notre travail
cherche spécifiquement à élucider le sens des espaces de l’intérieur et ceux de l’extérieur.
Par
une approche thématico-stylisque, nous envisageons de montrer que les éléments spatiaux
représentés dans Le Revenant (Fall, 1976), La Grève des bàttu (Fall, 1979), L’Ex-père de la nation
(Fall, 1987), Le Jujubier du patriarche (Fall, 1993) et Festins de la détresse (Fall, 2005) ne sont pas
un simple décor : chacun a une fonction particulière.
Organisé autour d’un plan binaire, le
travail s’attachera d’abord à analyser le sens des espaces dits clos.
Ensuite, il s’intéressera à
la signification des espaces dits fermés.
1.
L’espace clos
Nous entendons par espace clos tout lieu fermé.
Il peut s’agir de l’intérieur d’une voiture,
d’une maison, entre autres.
Dans ses romans, Aminata Sow Fall insiste sur les réalités
socioculturelles en relatant les détails de la vie quotidienne, leurs traits dans tous les aspects.
C’est ainsi que chaque espace remplit une fonction précise dans le roman.
En ce qui concerne
notre étude, l’intérêt sera porté sur deux cadres spatiaux internes : la cour et la prison.
La cour
La cour est définie par Jean-Marie Pruvost-Beaurain comme « un espace découvert et clos »
(Pruvost-Beaurain, 1985 : 268).
Cette caractéristique double révèle qu’elle peut être à la fois
hostile et paisible.
Des romanciers africains comme Ousmane Sembène ont eu à peindre
l’image cruelle de la cour (1).
Chez Aminata Sow Fall, la représentation de ce cadre spatial
montre qu’il est un espace de libre expression.
En effet, dans l’univers romanesque de
l’auteure, la cour accorde à ceux qui la fréquentent la possibilité d’être libres, épanouis.
Elle
regroupe de nombreux personnages parce qu’étant un espace de rencontre de tous, voire
d’une collectivité.
À ce sujet, il convient de reconnaitre que « dans le roman africain, l’espace
du dedans est souvent […] une cour commune à tous les membres de la famille » (Bâ et
al., 2014 : 95).
Ceux-ci discutent des sujets d’ordre général, expriment leurs opinions.
Cela
contribue à renforcer la convivialité et cultive l’esprit de solidarité et d’unité du groupe.
C’est dans cette mouvance que « tous les mendiants de la Ville sont réunis dans la cour de Salla
Niang pour participer au tirage de la tontine quotidienne » (Fall, 1979 : 14).
En fait, opprimés
et chassés par les policiers, ceux qui sont considérés tels des « encombrements humains »
décident de s’unir et d’unir leur force afin de vivre paisiblement.
Alors, contrairement à
l’ambiance morose de la rue, l’atmosphère qui règne dans la cour est réconfortante.
C’est un
lieu de refuge pour eux.
Ils aspirent à une nouvelle vie.
Se sentant en sécurité dans la maison
de Salla Niang, ils comptent vivre aisément à présent sans être inquiétés par des brimades.
Nguirane Sarr, un des leurs, s’exclame en ces termes : « Maintenant, il nous suffit de nous
asseoir, et tout nous tombe du ciel.
Plus de randonnées matinales, plus de courses effrénées,
plus de cordes vocales cassées » (Fall, 1979 : 81).
Nguirane Sarr admet que la cour est pour
eux un espace de jouissance, d’espérance, d’extrême liberté.
150
Les Cahiers du CREILAC
Ce cadre est donc un lieu de réconfort pour tous les mendiants.
Ils n’ont plus besoin de
tendre la main pour avoir de quoi manger.
Le fait d’être installés dans la cour du domicile
de Salla Niang leur porte-chance.
Ils sont bien nourris quotidiennement.
Ils peuvent même
refuser des dons ou prendre leur vengeance sur leurs bourreaux.
D’ailleurs, c’est à l’intérieur
de cet espace mi-clos que les erreurs de Mour Ndiaye sont mises à jour.
Venu demander aux
personnes qu’il avait pourtant chassées violemment des artères de la capitale d’y retourner,
il est humilié par des mendiants énervés en raison de son comportement hypocrite.
Le
« Directeur du Service de la salubrité publique » assiste à son lynchage moral.
Les mendiants,
rassurés par le cadre dans lequel ils se trouvent, se permettent d’être arrogants et moqueurs
à l’encontre de Mour Ndiaye.
Dès lors, la cour leur permet de prendre leur revanche sur
leur ancien tortionnaire.
Aussi la cour peut-elle offrir beaucoup d’opportunités aux personnages.
Effectivement,
elle permet à ces derniers de s’épanouir.
Grâce à son architecture, ils peuvent s’y mouvoir,
développer certaines de leurs activités sans d’importantes contraintes.
C’est un cadre de
liberté de mouvement et même d’expression libre qui soulage les personnages.
La cour leur
permet de développer convenablement leurs pensées.
Dans Festins de la détresse, la « courette », ainsi que le désignent les gens qui la fréquentent,
est l’endroit qui réunit tous « ceux que leur flair ou le hasard auront guidés » (Fall, 2005 :
26).
C’est l’un des rares espaces où les personnages ont la possibilité de se regrouper afin de
soulever librement des questions qui les préoccupent.
L’occasion est alors donnée à chacun
d’exprimer ses points de vue.
La cour de la demeure de Maar, le personnage principal du
roman, offre à tous ceux qui la fréquentent la possibilité de se prononcer librement sur des
sujets qui les intéressent.
L’instance narrative n’hésite pas à y surprendre d’ailleurs quelques-uns des personnages
dans leurs réflexions.
Elle renseigne à ce propos :
Ce matin, elle [Sarata] a eu toute la latitude de détailler la bagarre de deux coépouses, ses
voisines.
[…] D’habitude, après avoir pris sa tasse de quinkéliba au lait, Maar commente
le gros titre d’un quotidien à cent francs qui puise abondamment dans les carences de
la haute administration, les fresques politiques, les coups de génie des escrocs de tout
bord […].
La conversation débouche inévitablement sur la corruption, véritable fléau
du siècle.
(Fall, 2005 : 26-27)
Ainsi que le prouve l’expression « toute la latitude », la cour constitue un véritable espace de
liberté.
Sarata a alors le temps « de détailler » son récit sans qu’elle soit du tout inquiétée.
Cette
même possibilité de s’exprimer sur des sujets sensibles, sans aucun risque d’être intimidé,
est notable chez Maar.
En effet, la cour lui offre l’occasion de fustiger le pouvoir quant
à la gestion des deniers publics, de condamner les dérives des hommes.
Il peut dénoncer
l’incompétence des dirigeants.
Le lecteur découvre que la romancière se désole de constater
que les décideurs versent dans l’amateurisme, les citoyens dans la facilité.
Personne ne se
soucie de secteurs importants comme l’éducation et la santé.
Il apparaît que ce lieu est une
sorte de parlement pour....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- explication linéaire Wajdi Mouawad, Incendies , Première partie, « Incendie de Nawal », 2009, Léméac
- La Princesse de Clèves, explications linéaires Explication linéaire I : de « Madame de Chartres, qui avait eu tant d’application […] » à « […] quand on était jeune. » (Première partie)
- David HUME - Traité de la nature humaine - livre I, quatrième partie, section VI
- LA LITTERATURE DE L'ENTRE DEUX GUERRES
- Résumé partie 6 germinal