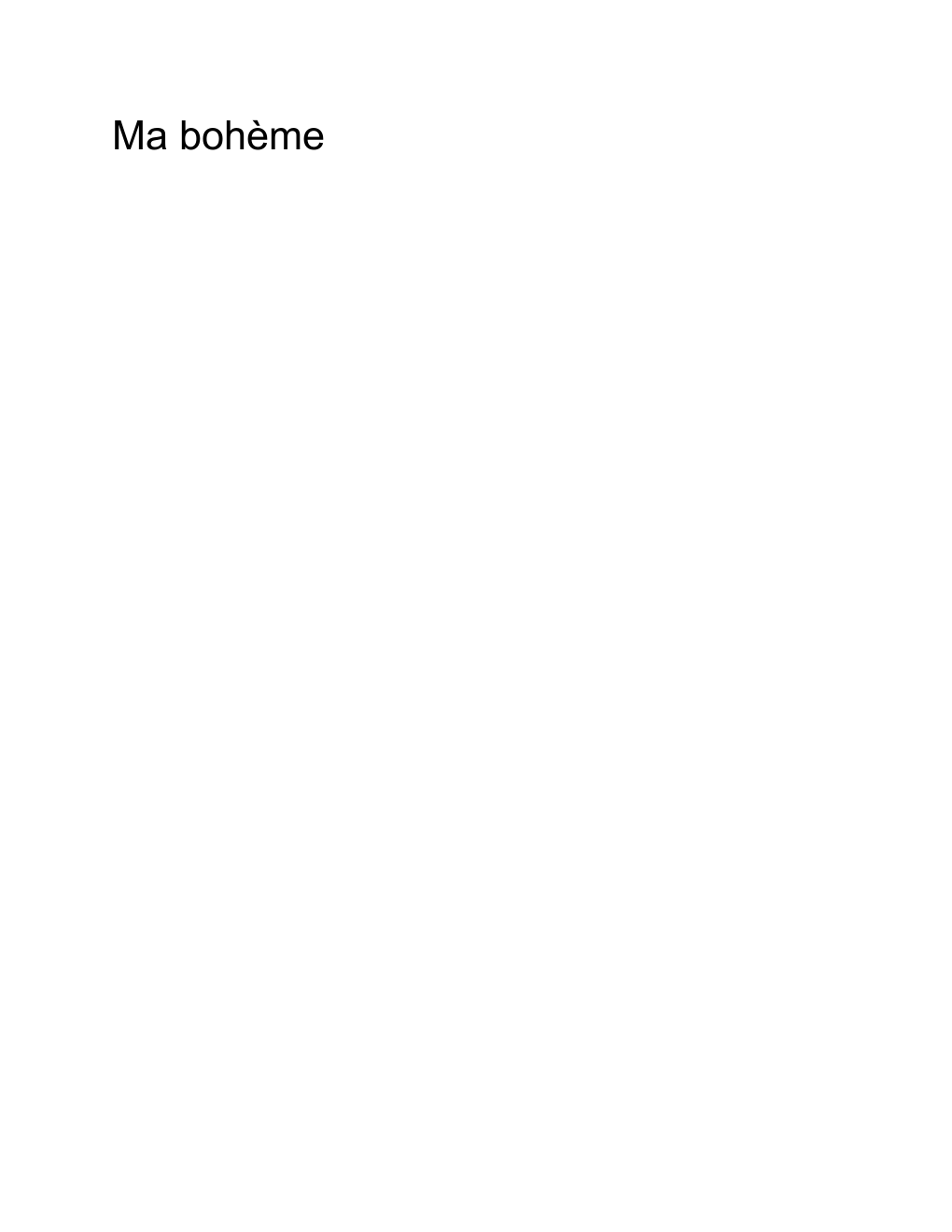Ma bohème analyse linéaire
Publié le 12/02/2025
Extrait du document
«
Ma bohème
Ma bohème
Introduction
La littérature a toujours été en constante évolution, portée par des auteurs en quête de
renouveau et d'idéal.
Chaque époque voit en effet émerger des écrivains qui tentent de
bousculer les codes établis, de réinventer l’art d’écrire.
C’est donc au XIXᵉ siècle, dans un
contexte où la poésie romantique et parnassienne domine, qu’Arthur Rimbaud émerge.
S’inspirant en grande partie de ses grands courant, il semble cependant tenter de s’affranchir
de ses influences dès l’aurore de sa création poétique, notamment dans le sonnet Ma bohème,
écrit en 1870, où il transforme l’errance en une expérience nécessaire à la création poétique.
Lecture expressive
Nous verrons donc par cette lecture linéaire comment, à travers sa quête poétique, Rimbaud
mentionne une nécessité de renouveler la poésie afin d’atteindre un idéal, en nous
intéressant en premier lieu à la première strophe (L.1 à L.4) caractérisé par un autoportrait
pauvre de matérialité, puis nous avancerons à la deuxième strophe qui mentionne une volonté
d'évolution esthétique, pour finir sur les deux derniers tercets qui annoncent la véritable
blessure du poète.
Seule la fugue est propice à la création et à l’imagination
Progression
“l1- l4” : autoportrait d’un pauvre poète
“l5- l8” : Évolution esthétique
“l9 - l14” : La véritable blessure du poète
Je m’en allais, les poings dans mes poches crevées ;
Mon paletot aussi devenait idéal ;
J’allais sous le ciel, Muse ! et j’étais ton féal ;
Oh ! là là ! que d’amours splendides j’ai rêvées !
Mon unique culotte avait un large trou.
Petit-Poucet rêveur, j’égrenais dans ma course
Des rimes.
Mon auberge était à la Grande-Ourse.
Mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frou
Et je les écoutais, assis au bord des routes,
Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes
De rosée à mon front, comme un vin de vigueur ;
Où, rimant au milieu des ombres fantastiques, ;
Comme des lyres, je tirais les élastiques
De mes souliers blessés, un pied près de mon cœur !
I. Autoportrait d’une errance
Je m’en allais, les poings dans mes poches crevées ;
Mon paletot aussi devenait idéal ;
J’allais sous le ciel, Muse ! et j’étais ton féal ;
Oh ! là là ! que d’amours splendides j’ai rêvées !
« Les poings dans mes poches crevées » : des poings dans des poches crevés sont forcément
des mains vides.
Ensuite, les poches crevées perdent ce qu'elles contiennent.
Et pourtant, le
poète multiplie les pronoms possessifs, que l'on trouve d'ailleurs dès le titre du poème, on peut
donc suggérer que quelque chose de plus important dépasse cette misère physique.
Un « paletot », c'est un manteau.
Ici, il devient « Idéal ».
Ici, l'idéal peut faire référence à une
idée relevant du domaine de l’abstrait, du non concret, soit du domaine conceptuel.
Ici Rimbaud
use de l'autodérision pour décrire son manteau : tellement dégradé, il s‘est vu transformé en
simple idée de manteau.
Le mot « paletot » est particulièrement intéressant dans la mesure où l’on entend « pâle » et «
tôt » des mots qui s'appliquent bien au voyageur fatigué par une journée de marche.
Le poète
est à l'image de son manteau : crevé, mais proche de l'idéal, c’est donc une figure d’hypallage
qui est utilisée ici.
Le verbe « aller » (l.1, l.3) revient deux fois, mais il est utilisé de deux manières très différentes
: « s'en aller » c'est partir ou fuir...
Alors que « aller sous le ciel » c'est une marche sans but :
une errance.
Le complément de lieu « sous le ciel » ne désigne pas une direction ou une
destination : c'est le lieu même de l'errance.
L'adverbe “aussi” fait référence aux poches crevées qui ne contiennent rien, si ce n’est des
poings serrés.
On a les poings serrés par révolte, ou à cause du froid, ici, ils sont aussi idéal,
l'idéal et donc souffrant, soit de révolte, soit de froid.
A la ligne 3, on voit une référence aux inspirations de Rimbaud.
Dans la littérature, on trouve le
motif bien connu du chevalier errant, une image qui plaît beaucoup aux romantiques.
C’est
exactement ce que Rimbaud suggère avec le mot « féal » il se voit comme un chevalier qui a
prêté allégeance à sa Muse, dont on remarque l’importance notamment par la majuscule,
apostrophée à la deuxième personne.
Cette démarche se poursuit par les exclamations avec les interjections « Oh ! là là ! », la force
de l'adjectif « splendide », le féminin pluriel pour les amours, qui renvoie à l'amour courtois.
Rimbaud en fait trop pour ne pas être ironique.
Cependant cette distance critique semble nouvelle.
En effet, si l’on revient sur l’un des premiers
poèmes de Rimbaud, soit Sensation qu’il a écrit a 15 ans, il se projette dans le futur : « j'irai …
je sentirai … je laisserai, etc.
», le jeune poète se définit lui-même comme un rêveur.
Il cultive
une certaine naïveté.
Dans « Ma Bohème » au contraire, les verbes sont au passé « allais …
devenait … étais ».
L'imparfait signale des actions qui ont duré dans un passé révolu.
Le « rêve
» est devenu un passé composé.
En quelques mois, on voit apparaître une véritable distance
critique : à peine plus âgé, Rimbaud se moque déjà gentiment de l'enfant qu'il a été.
La rime embrassée « crevées ...
rêvées »(l.1/l.4) est signifiante : le rêve s'oppose à cette réalité
où les vêtements ne durent pas.
II. Une volontée d'évoluer
Mon unique culotte avait un large trou.
— Petit Poucet rêveur, j’égrenais dans ma course
Des rimes.
Mon auberge était à la Grande-Ourse ;
— Mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frou.
La culotte trouée est un signe de pauvreté, et pourtant, il égraine des rimes, comme des
semailles : en quelque sorte, il déborde d'une créativité qui va peut-être germer et qui naît
seulement de sa course.
C’est ici une métonymie directe de la création poétique.
Le verbe « avoir » revient deux fois (l.5 et l.8), mais que possède-t-il si ce n’est un large trou,
qui ne représente en réalité rien.
Ou alors, des étoiles avec un doux frou-frou, c'est-à-dire un
simple bruit légèrement musical !
Mais à travers ce frou-frou, c'est la lumière des étoiles qui devient sonore, exactement comme
les rimes qui deviennent solides comme des cailloux.
C'est une synesthésie : une confusion
des perceptions.
La création se nourrit donc de ce dérèglement des sens.
Avec le Petit-Poucet, Rimbaud fait référence au genre du conte de fées et à l'univers de
l'enfance.
Rimbaud développe cet imaginaire enfantin, tout en insistant....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Analyse linéaire Cyrano de Bergerac - La scène du balcon
- Analyse linéaire : le dernier feu Les vrilles de la vigne
- Séquence 3 : Le Malade imaginaire de Molière. Analyse linéaire n°12 scène 10 acte III
- Analyse linéaire la princesse de Clèves - Analyse linéaire L’apparition à la cour
- ANALYSE LINÉAIRE PRINCESSE DE CLÈVES « Il parut alors une beauté à la cours… »