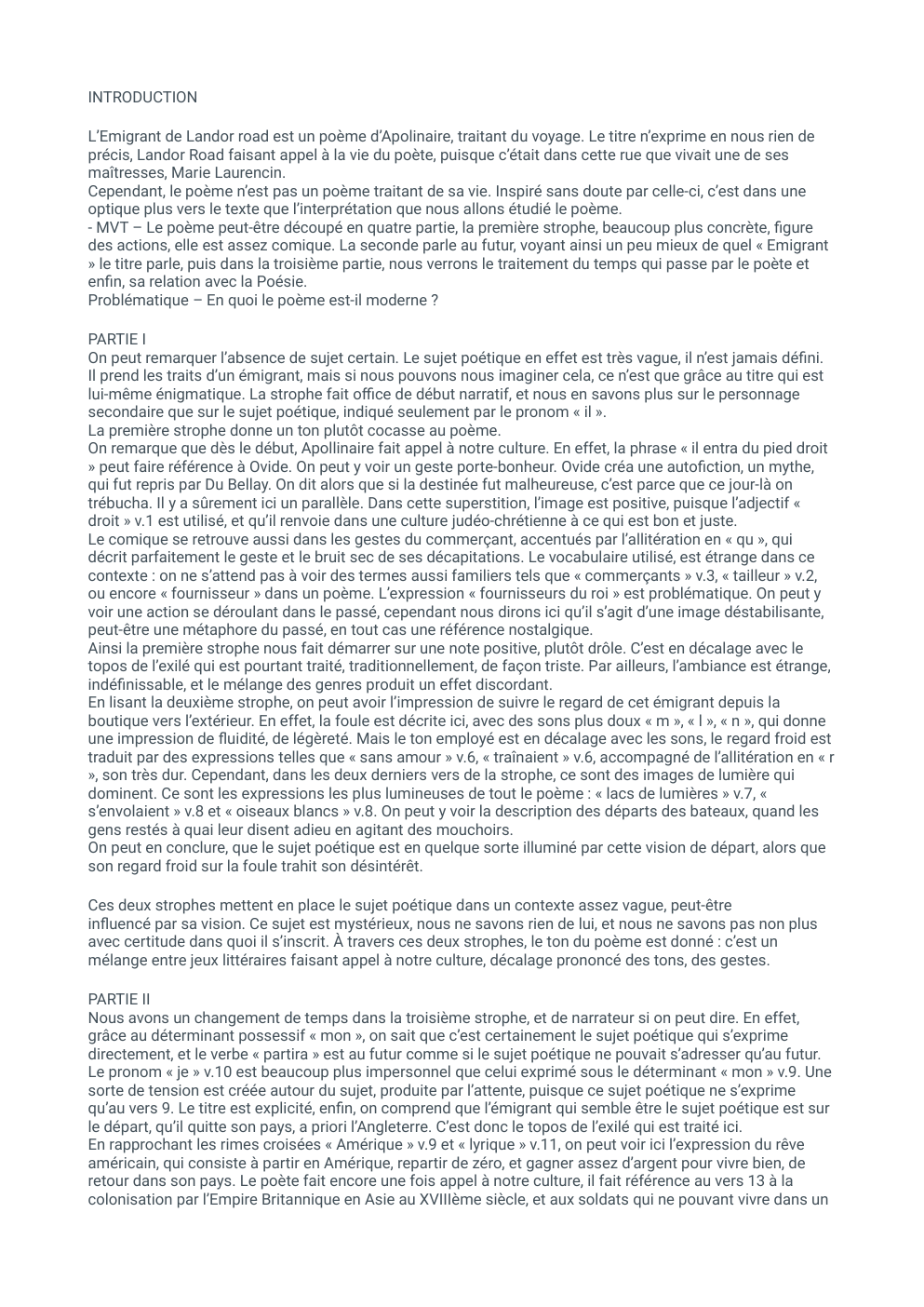L’Emigrant de Landor d’Apollinaire,
Publié le 04/08/2023
Extrait du document
«
INTRODUCTION
L’Emigrant de Landor road est un poème d’Apolinaire, traitant du voyage.
Le titre n’exprime en nous rien de
précis, Landor Road faisant appel à la vie du poète, puisque c’était dans cette rue que vivait une de ses
maîtresses, Marie Laurencin.
Cependant, le poème n’est pas un poème traitant de sa vie.
Inspiré sans doute par celle-ci, c’est dans une
optique plus vers le texte que l’interprétation que nous allons étudié le poème.
- MVT – Le poème peut-être découpé en quatre partie, la première strophe, beaucoup plus concrète, figure
des actions, elle est assez comique.
La seconde parle au futur, voyant ainsi un peu mieux de quel « Emigrant
» le titre parle, puis dans la troisième partie, nous verrons le traitement du temps qui passe par le poète et
enfin, sa relation avec la Poésie.
Problématique – En quoi le poème est-il moderne ?
PARTIE I
On peut remarquer l’absence de sujet certain.
Le sujet poétique en effet est très vague, il n’est jamais défini.
Il prend les traits d’un émigrant, mais si nous pouvons nous imaginer cela, ce n’est que grâce au titre qui est
lui-même énigmatique.
La strophe fait office de début narratif, et nous en savons plus sur le personnage
secondaire que sur le sujet poétique, indiqué seulement par le pronom « il ».
La première strophe donne un ton plutôt cocasse au poème.
On remarque que dès le début, Apollinaire fait appel à notre culture.
En effet, la phrase « il entra du pied droit
» peut faire référence à Ovide.
On peut y voir un geste porte-bonheur.
Ovide créa une autofiction, un mythe,
qui fut repris par Du Bellay.
On dit alors que si la destinée fut malheureuse, c’est parce que ce jour-là on
trébucha.
Il y a sûrement ici un parallèle.
Dans cette superstition, l’image est positive, puisque l’adjectif «
droit » v.1 est utilisé, et qu’il renvoie dans une culture judéo-chrétienne à ce qui est bon et juste.
Le comique se retrouve aussi dans les gestes du commerçant, accentués par l’allitération en « qu », qui
décrit parfaitement le geste et le bruit sec de ses décapitations.
Le vocabulaire utilisé, est étrange dans ce
contexte : on ne s’attend pas à voir des termes aussi familiers tels que « commerçants » v.3, « tailleur » v.2,
ou encore « fournisseur » dans un poème.
L’expression « fournisseurs du roi » est problématique.
On peut y
voir une action se déroulant dans le passé, cependant nous dirons ici qu’il s’agit d’une image déstabilisante,
peut-être une métaphore du passé, en tout cas une référence nostalgique.
Ainsi la première strophe nous fait démarrer sur une note positive, plutôt drôle.
C’est en décalage avec le
topos de l’exilé qui est pourtant traité, traditionnellement, de façon triste.
Par ailleurs, l’ambiance est étrange,
indéfinissable, et le mélange des genres produit un effet discordant.
En lisant la deuxième strophe, on peut avoir l’impression de suivre le regard de cet émigrant depuis la
boutique vers l’extérieur.
En effet, la foule est décrite ici, avec des sons plus doux « m », « l », « n », qui donne
une impression de fluidité, de légèreté.
Mais le ton employé est en décalage avec les sons, le regard froid est
traduit par des expressions telles que « sans amour » v.6, « traînaient » v.6, accompagné de l’allitération en « r
», son très dur.
Cependant, dans les deux derniers vers de la strophe, ce sont des images de lumière qui
dominent.
Ce sont les expressions les plus lumineuses de tout le poème : « lacs de lumières » v.7, «
s’envolaient » v.8 et « oiseaux blancs » v.8.
On peut y voir la description des départs des bateaux, quand les
gens restés à quai leur disent adieu en agitant des mouchoirs.
On peut en conclure, que le sujet poétique est en quelque sorte illuminé par cette vision de départ, alors que
son regard froid sur la foule trahit son désintérêt.
Ces deux strophes mettent en place le sujet poétique dans un contexte assez vague, peut-être
influencé par sa vision.
Ce sujet est mystérieux, nous ne savons rien de lui, et nous ne savons pas non plus
avec certitude dans quoi il s’inscrit.
À travers ces deux strophes, le ton du poème est donné : c’est un
mélange entre jeux littéraires faisant appel à notre culture, décalage prononcé des tons, des gestes.
PARTIE II
Nous avons un changement de temps dans la troisième strophe, et de narrateur si on peut dire.
En effet,
grâce au déterminant possessif « mon », on sait que c’est certainement le sujet poétique qui s’exprime
directement, et le verbe « partira » est au futur comme si le sujet poétique ne pouvait s’adresser qu’au futur.
Le pronom « je » v.10 est beaucoup plus impersonnel que celui exprimé sous le déterminant « mon » v.9.
Une
sorte de tension est créée autour du sujet, produite par l’attente, puisque ce sujet poétique ne s’exprime
qu’au vers 9.
Le titre est explicité, enfin, on comprend que l’émigrant qui semble être le sujet poétique est sur
le départ, qu’il quitte son pays, a priori l’Angleterre.
C’est donc le topos de l’exilé qui est traité ici.
En rapprochant les rimes croisées « Amérique » v.9 et « lyrique » v.11, on peut voir ici l’expression du rêve
américain, qui consiste à partir en Amérique, repartir de zéro, et gagner assez d’argent pour vivre bien, de
retour dans son pays.
Le poète fait encore une fois appel à notre culture, il fait référence au vers 13 à la
colonisation par l’Empire Britannique en Asie au XVIIIème siècle, et aux soldats qui ne pouvant vivre dans un
pays de « sauvages » doivent revenir dans leur pays.
Cependant le sujet poétique ne parle pas de retour, bien au contraire, il ne reviendra pas.
Il y a donc
discordance, entre le rêve américain exprimé et la volonté du sujet poétique.
On comprend son caractère
définitif dans l’adverbe « jamais », et dans l’adverbe « enfin », au vers 15, où est exprimé comme un
soulagement.
Le deuxième vers de la strophe est un octosyllabe.
Il rompt le rythme, beaucoup plus bref, coupé, et qui
traduit le caractère définitif de ne pas revenir.
Un autre décalage en présent entre le rêve américain comme on l’entend et la volonté du sujet poétique à
aller là-bas.
Le sujet poétique aurait déjà réussi sa vie, sa poésie allant de pair avec da réussite.
Au vers 14,
on peut interpréter les « crachats » comme étant ce que crée le poète, c’est-à-dire sa poésie, au même titre
que le chant est créé par l’oiseau.
Si ses crachats, donc sa poésie, sont en or fin, c’est probablement parce
qu’il a réussi à être reconnu, et donc qu’il a réussi à vivre de son art.
Cette idée est étayée par le vers suivant :
« habillé de neuf ».
La personnification de son ombre grâce au verbe « guider », v.11, rend l’atmosphère étrange.
Il pourrait s’agir
d’un double du sujet poétique.
Le sujet poétique cherche à se déterminer, à expérimenter de nouvelles
formes d’identité.
On peut faire l’hypothèse que le mot « ombre » est un terme qui a une connotation négative, qui appelle la
mort.
D’ailleurs, le sujet poétique parle au passé, en parlant de sa vie actuelle.
Il se projette dans le futur, et
parle déjà au passé, il a déjà fait un pas vers la mort.
Ici : « […] dormir enfin Sous des arbres » v.15-16, est une
métaphore de la mort.
En effet, le sujet poétique parle d’aller vers la mort, en toute conscience.
On peut cependant noter que le ton employé n’est pas triste ou tragique, que le sujet poétique reste dans la
sobriété et que malgré l’utilisation du terme de l’exilé, allant vers la mort, aucun pathos n’est présent.
La
cohérence est battue en brèche, il faut faire des efforts pour recoller ce qui reste disjoint, y compris pour le
sujet poétique.
PARTIE III
Ensuite, on change de sujet, le « je » devient « il ».
On revient dans la boutique, on quitte des pensées pour
voir ce qui se passe.
La strophe est narrative, on retrouve le même sujet « il » que dans les deux premières
strophes.
Le ton est plutôt drôle, même si ce sujet poétique est assez passif.
Il y a dans le vers 20, une déstructuration rythmique : dans le premier hémistiche 3-3 et dans le second 2-4,
ce qui a pour effet d’accentuer la fin du vers, cette accentuation elle-même appuyée par la diérèse de «
millionnaire ».
L’accent est alors porté sur le côté positif de son habit, sur sa chance.
Cependant l’habit
apparaît comme un déguisement, c’est l’habit d’un autre, la scène est assez drôle, on imagine bien le sujet
poétique un peu dégingandé dans son nouvel habit.
L’inversion du verbe « battirent », v.18, est assez drôle.
Une idée de poussière, de vieux vêtements, domine.
On peut comprendre par....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Les colchiques d'Apollinaire
- « Nuit rhénane » LL - Apollinaire (analyse linéaire)
- Commentez cette affirmation de Guillaume Apollinaire dans « L'Esprit Nouveau et les Poètes » en vous référant aux textes de la poésie contemporaine que vous connaissez : « C'est par la surprise, par la place importante qu'il fait à la surprise, que l'esp