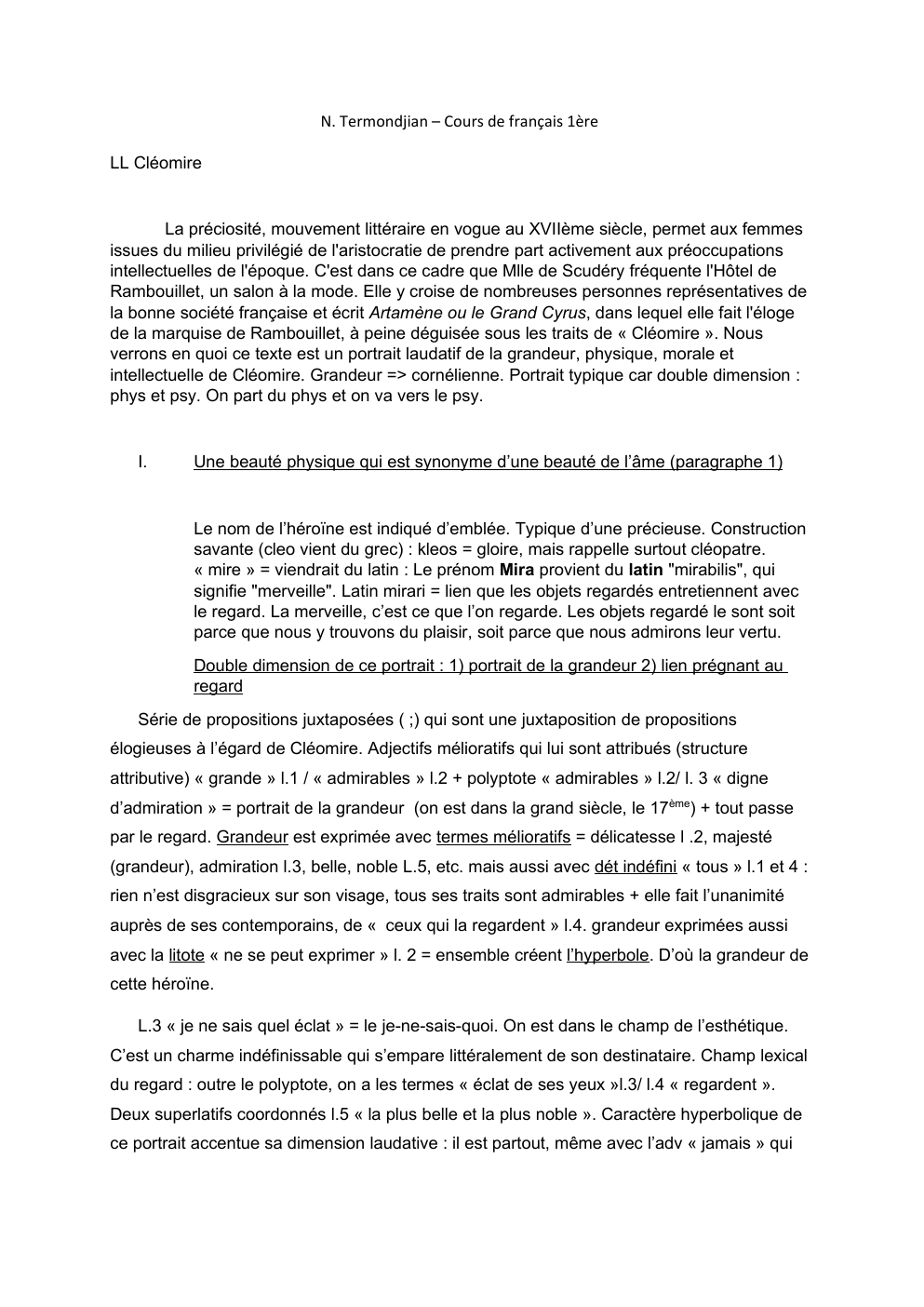lecture linéaire : Cléomire
Publié le 21/01/2024
Extrait du document
«
LL Cléomire
La préciosité, mouvement littéraire en vogue au XVIIème siècle, permet aux femmes
issues du milieu privilégié de l'aristocratie de prendre part activement aux préoccupations
intellectuelles de l'époque.
C'est dans ce cadre que Mlle de Scudéry fréquente l'Hôtel de
Rambouillet, un salon à la mode.
Elle y croise de nombreuses personnes représentatives de
la bonne société française et écrit Artamène ou le Grand Cyrus, dans lequel elle fait l'éloge
de la marquise de Rambouillet, à peine déguisée sous les traits de « Cléomire ».
Nous
verrons en quoi ce texte est un portrait laudatif de la grandeur, physique, morale et
intellectuelle de Cléomire.
Grandeur => cornélienne.
Portrait typique car double dimension :
phys et psy.
On part du phys et on va vers le psy.
I.
Une beauté physique qui est synonyme d’une beauté de l’âme (paragraphe 1)
Le nom de l’héroïne est indiqué d’emblée.
Typique d’une précieuse.
Construction
savante (cleo vient du grec) : kleos = gloire, mais rappelle surtout cléopatre.
« mire » = viendrait du latin : Le prénom Mira provient du latin "mirabilis", qui
signifie "merveille".
Latin mirari = lien que les objets regardés entretiennent avec
le regard.
La merveille, c’est ce que l’on regarde.
Les objets regardé le sont soit
parce que nous y trouvons du plaisir, soit parce que nous admirons leur vertu.
Double dimension de ce portrait : 1) portrait de la grandeur 2) lien prégnant au
regard
Série de propositions juxtaposées ( ;) qui sont une juxtaposition de propositions
élogieuses à l’égard de Cléomire.
Adjectifs mélioratifs qui lui sont attribués (structure
attributive) « grande » l.1 / « admirables » l.2 + polyptote « admirables » l.2/ l.
3 « digne
d’admiration » = portrait de la grandeur (on est dans la grand siècle, le 17ème) + tout passe
par le regard.
Grandeur est exprimée avec termes mélioratifs = délicatesse l .2, majesté
(grandeur), admiration l.3, belle, noble L.5, etc.
mais aussi avec dét indéfini « tous » l.1 et 4 :
rien n’est disgracieux sur son visage, tous ses traits sont admirables + elle fait l’unanimité
auprès de ses contemporains, de « ceux qui la regardent » l.4.
grandeur exprimées aussi
avec la litote « ne se peut exprimer » l.
2 = ensemble créent l’hyperbole.
D’où la grandeur de
cette héroïne.
L.3 « je ne sais quel éclat » = le je-ne-sais-quoi.
On est dans le champ de l’esthétique.
C’est un charme indéfinissable qui s’empare littéralement de son destinataire.
Champ lexical
du regard : outre le polyptote, on a les termes « éclat de ses yeux »l.3/ l.4 « regardent ».
Deux superlatifs coordonnés l.5 « la plus belle et la plus noble ».
Caractère hyperbolique de
ce portrait accentue sa dimension laudative : il est partout, même avec l’adv « jamais » qui
N.
Termondjian – Cours de français 1ère
suit et qui est dans la même tonalité que les autres marqueurs hyperboliques de
l’extraordinaire ici et que nous avons relevés.
Glissement vers les lignes 5 et 6 vers la tranquillité des passions, tranquillité de l’âme,
qui est caractéristique de....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LECTURE LINÉAIRE 12 « Mémoires d’une âme » « Melancholia », Les Contemplations, (1856), Victor Hugo
- Argument lecture linéaire sur la princesse de clèves - scène d'aveu et caractère exceptionnel des personnages
- Lecture Linéaire N°11 Charles Baudelaire, Fleurs du Mal, Texte Intégral, « Tableaux parisiens » « Le Soleil »
- Lecture linéaire Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil : La littérature d’idées du XVIe au XVIIIe siècle
- lecture de l'incipit de Bouvard et Pécuchet de Flaubert