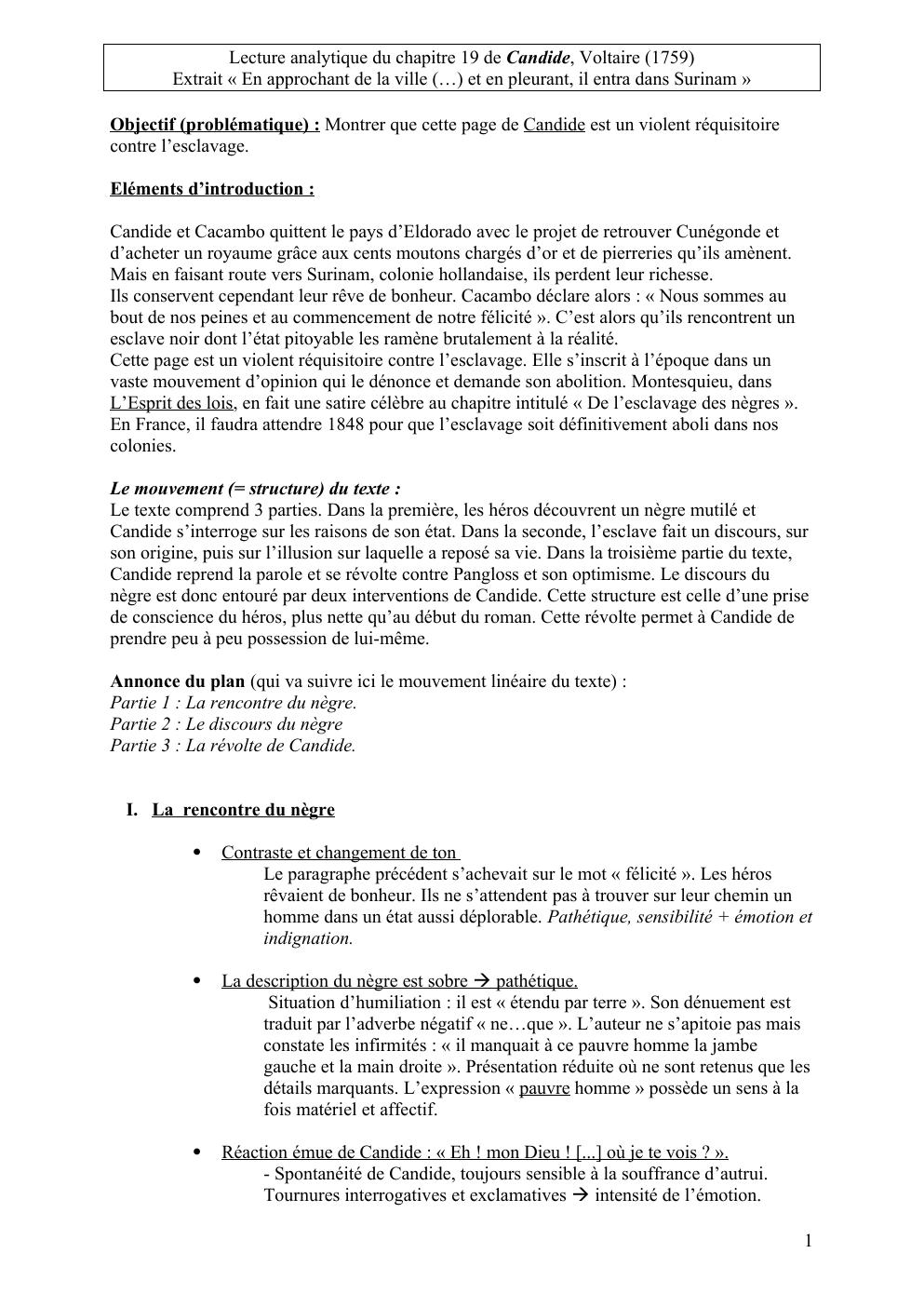Lecture analytique du chapitre 19 de Candide, Voltaire (1759)
Publié le 06/02/2025
Extrait du document
«
Lecture analytique du chapitre 19 de Candide, Voltaire (1759)
Extrait « En approchant de la ville (…) et en pleurant, il entra dans Surinam »
Objectif (problématique) : Montrer que cette page de Candide est un violent réquisitoire
contre l’esclavage.
Eléments d’introduction :
Candide et Cacambo quittent le pays d’Eldorado avec le projet de retrouver Cunégonde et
d’acheter un royaume grâce aux cents moutons chargés d’or et de pierreries qu’ils amènent.
Mais en faisant route vers Surinam, colonie hollandaise, ils perdent leur richesse.
Ils conservent cependant leur rêve de bonheur.
Cacambo déclare alors : « Nous sommes au
bout de nos peines et au commencement de notre félicité ».
C’est alors qu’ils rencontrent un
esclave noir dont l’état pitoyable les ramène brutalement à la réalité.
Cette page est un violent réquisitoire contre l’esclavage.
Elle s’inscrit à l’époque dans un
vaste mouvement d’opinion qui le dénonce et demande son abolition.
Montesquieu, dans
L’Esprit des lois, en fait une satire célèbre au chapitre intitulé « De l’esclavage des nègres ».
En France, il faudra attendre 1848 pour que l’esclavage soit définitivement aboli dans nos
colonies.
Le mouvement (= structure) du texte :
Le texte comprend 3 parties.
Dans la première, les héros découvrent un nègre mutilé et
Candide s’interroge sur les raisons de son état.
Dans la seconde, l’esclave fait un discours, sur
son origine, puis sur l’illusion sur laquelle a reposé sa vie.
Dans la troisième partie du texte,
Candide reprend la parole et se révolte contre Pangloss et son optimisme.
Le discours du
nègre est donc entouré par deux interventions de Candide.
Cette structure est celle d’une prise
de conscience du héros, plus nette qu’au début du roman.
Cette révolte permet à Candide de
prendre peu à peu possession de lui-même.
Annonce du plan (qui va suivre ici le mouvement linéaire du texte) :
Partie 1 : La rencontre du nègre.
Partie 2 : Le discours du nègre
Partie 3 : La révolte de Candide.
I.
La rencontre du nègre
Contraste et changement de ton
Le paragraphe précédent s’achevait sur le mot « félicité ».
Les héros
rêvaient de bonheur.
Ils ne s’attendent pas à trouver sur leur chemin un
homme dans un état aussi déplorable.
Pathétique, sensibilité + émotion et
indignation.
La description du nègre est sobre pathétique.
Situation d’humiliation : il est « étendu par terre ».
Son dénuement est
traduit par l’adverbe négatif « ne…que ».
L’auteur ne s’apitoie pas mais
constate les infirmités : « il manquait à ce pauvre homme la jambe
gauche et la main droite ».
Présentation réduite où ne sont retenus que les
détails marquants.
L’expression « pauvre homme » possède un sens à la
fois matériel et affectif.
Réaction émue de Candide : « Eh ! mon Dieu ! [...] où je te vois ? ».
- Spontanéité de Candide, toujours sensible à la souffrance d’autrui.
Tournures interrogatives et exclamatives intensité de l’émotion.
1
- Adjectif « horrible omniprésence (dans tout le roman) des malheurs
qui frappent l’Homme.
Ton de soumission de l’esclave
- « J’attends mon maître, monsieur Vanderdendur, le fameux négociant ».
L’adjectif « fameux » peut aussi être pris en un sens ironique : le
négociant est certes connu, mais plus pour sa cruauté que pour ses vertus.
- Fantaisie verbale sur le nom « Vanderdendur » : il s’agit d’un nomportrait qui contient dans sa forme la fonction et le caractère du
personnage.
L’allitération en « d » fait d’emblée de lui un être ridicule et
antipathique.
La première partie du nom nous apprend qu’il s’agit d’un
négociant hollandais : « vander » est la transcription sous une forme
hollandaise de l’homonyme « vendeur » ; l’autre partie du nom : « dendur » nous révèle la méchanceté du personnage : « il a la dent dure ».
La suite du roman confirmera ce trait.
Chez Voltaire, on voit que la
fantaisie verbale se met au service de la fiction et de l’argumentation
indirecte.
II.
Le discours du nègre
Le nègre explique la raison de son état
Voltaire concentre l’effet du pathétique en ne retenant que les détails
frappants : caleçon, main, jambe.
« C’est l’usage » désigne le traitement dont le nègre a été victime ;
sous-entend une logique de l’habitude à laquelle le nègre semble se
soumettre ; ses malheurs obéissent à une loi supérieure qui n’a d’autre
justification que la tradition.
Une résignation neutre et objective
L’esclave se contente de juxtaposer sobrement les informations : « On
nous donne un caleçon […] je me suis trouvé dans les deux cas.
» Le
constat objectif du nègre s’articule autour de trois expressions parallèles
formant une sorte de rengaine tragique : « On nous donne… on nous
coupe… on nous coupe… ».
Cette juxtaposition de faits produit une
accumulation qui fait mieux ressortir la cruauté des esclavagistes.
Mais le nègre s'autorise un commentaire critique :
C’est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe ».
Ici Voltaire prend
la parole par la bouche de son personnage pour dénoncer le scandale.
Par
cette phrase incisive, le conte devient pamphlet (= court récit satirique
attaquant avec violence un gouvernement, une institution ou un
personnage connu).
Ce que Voltaire met en évidence, c’est le décalage
monstrueux entre l’insouciance des Européens et les souffrances de ceux
qui sont à leur service aux colonies.
Le nègre raconte alors sa vie
- Il dénonce d’une autre façon l’absurdité de l’esclavage, en reprenant le
thème de l’optimisme, qui est le sujet du roman.
Sa mère lui tient en
effet un discours qui ressemble à ceux de Pangloss : « Mon cher enfant
[…] et de ta mère ».
Elle prêche à son fils l’acceptation de l’ordre établi
et le persuade, contre toute évidence, de son bonheur.
Par un
renversement absurde propre aux raisonnements de Pangloss, la
condition d’esclave devient un « honneur ».
2
- Les « fétiches », qui sont d’ordinaire des objets matériels adorés par les
primitifs, désignent dans ce contexte les prêtres de la religion catholique.
Par cette appellation amusante, Voltaire se moque d’elle en la réduisant à
du fétichisme.
Rupture dans le discours et prise de recul du nègre
- L’interjection « Hélas ! » introduit une rupture et apporte un démenti
à cette promesse de bonheur.
Sur un ton désabusé et détaché, le
nègre se décrit avec humour : « Je ne sais pas si j’ai fait leur fortune,
mais ils n’ont pas fait la mienne ».
Cette attitude de recul vis-à-vis de
la situation lui permet de faire une analyse sévère des rapports de
l’Eglise avec les Noirs.
- Le passage du « je » au « nous » montre que maintenant le nègre se
fait l’avocat de la cause des esclaves en général.
Indignation et dénonciation
- On n’accorde même pas aux esclaves la dignité de la bête.
- Indignation soulignée par l’accumulation bouffonne d’animaux :
« les chiens, les singes et les perroquets », et par l’hyperbole :
« mille fois moins malheureux que nous ».
- Le nègre s’en prend alors directement à l’attitude des prêtres à l’égard
des Noirs.
Voltaire, par sa bouche, dénonce le paradoxe hypocrite
qui consiste à convertir les Noirs et à prétendre qu’ils sont les égaux
des Blancs, alors que dans les faits ils sont traités comme des soushommes : « Les fétiches hollandais qui m’ont converti me disent tous
les dimanches que nous sommes tous enfants d’Adam, blancs et
noirs ; mais si ces prêcheurs disent vrais, nous sommes tous cousins
issus de germain.
»
- Sur un ton poli et détaché, le Noir comme un syllogisme
(= raisonnement composé de trois propositions dont la
troisième dérive nécessairement des deux premières).
Mais,
dans la réalité, la conséquence ne correspond pas à la logique des
deux premières propositions.
Là, le Noir dénonce l’attitude
contradictoire et scandaleuse des chrétiens.
Sur un ton ironique, il
feint de croire qu’ils disent la vérité : « si ces prêcheurs disent vrai ».
En développant la logique de la fraternité entre les hommes prônée
par le christianisme, il fait mieux éclater le scandale qu’introduit
fermement « or », la conjonction de coordination : « Or vous
m’avouerez qu’on ne peut pas en user avec ses parents d’une manière
plus horrible ».
L’ironie tourne ici à l’indignation et prend la forme
d’un euphémisme, qui décrit poliment, par une expression adoucie,
le sort lamentable fait aux Noirs par leurs soi-disant frères blancs.
L’émotion est concentrée dans l’adjectif « horrible », mis en relief à
la fin de la phrase et faisant dramatiquement écho au même mot
employé par Candide au début du texte.
Ce réquisitoire serré fait naître chez le héros (Candide) un sentiment de révolte.
III.
La révolte de Candide
Le discours du nègre provoque une évolution capitale chez Candide
- Pour la première fois dans le roman, il rejette fermement les
enseignements de....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Voltaire - Candide (Chapitre 3).
- Lecture analytique sur Victor Hugo, Les Contemplations, A propos d’Horace Poème Vers 173 à 201
- Analyse du Candide de VOLTAIRE .
- Comment et dans quel but les éléments traditionnels du conte sont-ils détournés? > Voltaire>Candide
- Chapitre 11. Axe 1. Comment définir et mesurer la mobilité sociale ?