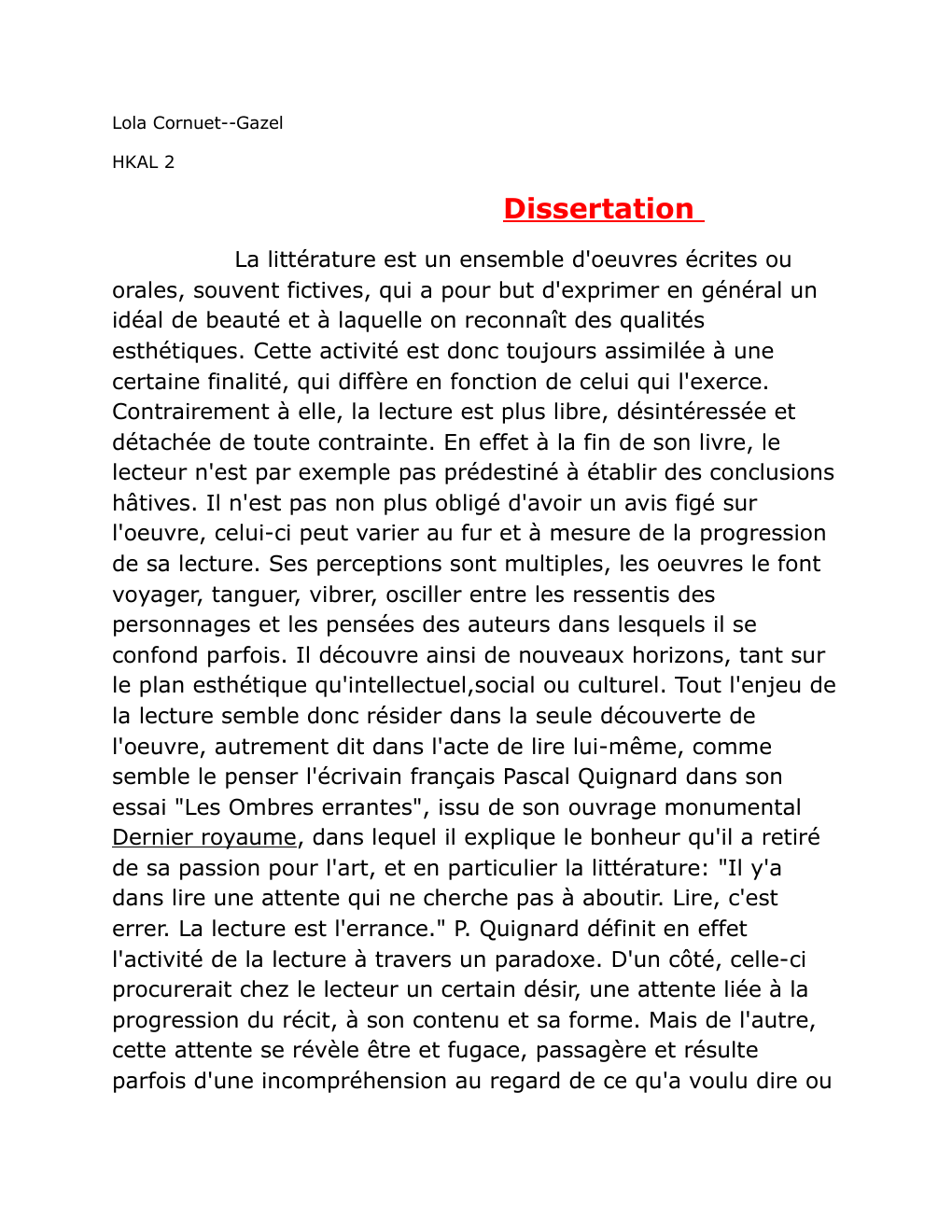la lecture est errance (Quignard)
Publié le 03/05/2023
Extrait du document
«
Lola Cornuet--Gazel
HKAL 2
Dissertation
La littérature est un ensemble d'oeuvres écrites ou
orales, souvent fictives, qui a pour but d'exprimer en général un
idéal de beauté et à laquelle on reconnaît des qualités
esthétiques.
Cette activité est donc toujours assimilée à une
certaine finalité, qui diffère en fonction de celui qui l'exerce.
Contrairement à elle, la lecture est plus libre, désintéressée et
détachée de toute contrainte.
En effet à la fin de son livre, le
lecteur n'est par exemple pas prédestiné à établir des conclusions
hâtives.
Il n'est pas non plus obligé d'avoir un avis figé sur
l'oeuvre, celui-ci peut varier au fur et à mesure de la progression
de sa lecture.
Ses perceptions sont multiples, les oeuvres le font
voyager, tanguer, vibrer, osciller entre les ressentis des
personnages et les pensées des auteurs dans lesquels il se
confond parfois.
Il découvre ainsi de nouveaux horizons, tant sur
le plan esthétique qu'intellectuel,social ou culturel.
Tout l'enjeu de
la lecture semble donc résider dans la seule découverte de
l'oeuvre, autrement dit dans l'acte de lire lui-même, comme
semble le penser l'écrivain français Pascal Quignard dans son
essai "Les Ombres errantes", issu de son ouvrage monumental
Dernier royaume, dans lequel il explique le bonheur qu'il a retiré
de sa passion pour l'art, et en particulier la littérature: "Il y'a
dans lire une attente qui ne cherche pas à aboutir.
Lire, c'est
errer.
La lecture est l'errance." P.
Quignard définit en effet
l'activité de la lecture à travers un paradoxe.
D'un côté, celle-ci
procurerait chez le lecteur un certain désir, une attente liée à la
progression du récit, à son contenu et sa forme.
Mais de l'autre,
cette attente se révèle être et fugace, passagère et résulte
parfois d'une incompréhension au regard de ce qu'a voulu dire ou
transmettre l'auteur.
Il envisage donc la lecture comme une
activité dénuée de véritables fins et d'intentions.
Ou du moins,
celles-ci sont variables.
La lecture fait-elle toujours l'objet d'une
activité transitoire, parfois incomprise, vide de tout
accomplissement ultérieur? Nous verrons dans un premier temps
dans quelle mesure la lecture fait effectivement office d'un
voyage à la fois évanescent et déroutant pour le lecteur.
Cependant, nous nous demanderons si la vision de Quignard n'est
pas trop réductrice et n'omet pas certaines qualités de la lecture
et son importance vis-à-vis de l'oeuvre et de l'auteur.
Cette
réflexion nous portera finalement à concevoir la possibilité d'une
certaine tension entre une lecture qui serait à la fois utile et
indispensable, et une lecture complètement désinterressée de
tout enjeu véritable.
Les oeuvres littéraires obéissent à la volonté de leur
auteur et l'inspiration qui les pousse à créer est bien souvent
énigmatique pour le lecteur, mais lui permet toutefois d'avoir un
aperçu d'un monde extérieur, d'une certaine manière de pensée
ou encore d'un idéal esthétique.
Compte tenu de ce dernier cas,il
paraît alors impossible pour lui d'attendre de l'oeuvre qu'elle lui
fournisse une fin concrète,tangible, conforme à ses attentes et à
ses présupposés.
Cependant, cela ne l'empêche pas d'être happé
par une sorte de curiosité et d'intérêt qui portent davantage sur
la forme de l'oeuvre que sur le fond et qui se conforme aux règles
établies par celui qui crée.
Cet intérêt n'est alors que purement
passager puisqu'il est en grande partie d'ordre visuel et n'a pas
vocation à rester dans l'esprit une fois l'oeuvre terminée.
Ce
constat se fait notamment dès le début de la modernité poétique
dans la deuxième moitié du XIXe siècle, où "L'écriture" qualifie
désormais tout ce qui concerne les questions formelles, les modes
d'énonciation ainsi que les procédés stylistiques, qui deviennent
dès lors les principaux enjeux de la création littéraire.
De ce fait,
l'intention de produire quelque chose en lien avec l'intellect paraît
superflu et aucun contenu préétabli ne semble pouvoir orienter
l'oeuvre dans une véritable prise de position.
Paul Valéry affirme
d'ailleurs n'avoir eu recours à aucune idée, aucune source
d'inspiration pour produire son poème "Cimetière marin", mais
seulement à une "figure rythmique vide".
Le lecteur erre donc à
travers les différents procédés stylistiques et l'élaboration
purement technique de l'oeuvre, sans avoir de bases
intellectuelles auxquelles se raccrocher.
L'écrivain a donc pour
seule tâche de jouer avec les formes littéraires et le projet initial
de la littérature, qui est d'apprendre quelque chose au lecteur,
devient totalement anodin voir inexistant.
Seul le style importe,
comme en témoigne cette "profession de foi" de Flaubert relative
au "livre sur rien" qu'il écrit à Louise Colet dans une lettre de
1852: "Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c'est un
livre sur rien, un livre sans attaque extérieure, qui se tiendrait de
lui-même par la force interne de son style, comme la terre sans
être soutenue se tient en l'air, un livre qui n'aurait presque pas de
sujet ou du moins où le sujet serait presque invisible, si cela se
peut." L'écrivain encourage donc la création de l'Art pur et rejoint
ainsi la théorie parnassienne affirmant que l'art, et donc ici la
littérature, doit être dénuée de toute valeur morale, didactique
voir même utile.
Théophile Gautier, chef de file du mouvement
parnasse, en résume d'ailleurs la thèse dans sa préface de
Mademoiselle Daupin : " Il n’y a de vraiment beau que ce qui ne
peut servir à rien ; tout ce qui est utile est laid." Le lecteur,
décontenancé, est alors obligé de se plier à cette volonté et erre
dans l'oeuvre, entre la vacuité du fond et l'omniprésence de la
forme.
Mais l'effet stylistique ne saurait être cependant le seul lieu de
confusion, de fascination et d'errance pour le lecteur.
En effet,
dès qu'il se met à lire, il traverse une frontière invisible le menant
de l'autre côté du réel, et l'oblige à se confronter à l'inspiration et
donc l'imagination féconde et parfois obscure de l'auteur.
Ainsi,
lire suppose un véritable passage, une traversée dans l'inconnu.
Selon Quignard, le lecteur est le découvreur de monde, de "terra
incognita" tel qu'il l'évoque dans son essai Vie secrète : "J'ai
souvent éprouvé une sensation extraordinaire de porte qui
s'ouvre, de seuil franchi soudain, de promontoire vertigineux dans
ma vie[...] les pages sont les vantaux d'une fenêtre brusquement
ouverte".
De manière fictive, le lecteur est alors marqué par une
perpétuelle évanescence car ses ambitions ne cessent de
changer.Il adopte alors des formes toujours nouvelles, en fonction
des oeuvres ou même des passages qu'il lit au sein d'un même
livre.
Son attente est sans cesse renouvelée par de nouveaux
enjeux, de nouvelles découvertes, de nouvelles envies donc en
somme par d'autres attentes.Il est alors invité à disparaître au
profit de ses lectures, qui revêtent une dimension presque
métaphysique et peuvent conduire à certaine dépersonnalisation
de soi.
En effet, happé par l'oeuvre, dénué de toute notion de
temps, le lecteur peut en venir à s'oublier soi-même et se
conforter dans des idéaux qui ne sont pas les siens.
C'est le cas
d'Emma Bovary, personnage fard de l'oeuvre à scandal de
Flaubert Madame Bovary, qui se réfugie dans des romans
d'exaltations romantiques pour échapper à son existence morose
et monotone.
Cela va la conduire à tromper son mari et
finalement mourir de chagrins après avoir fait face à des
désillusions concernant son amant, Rodolphe, qui refuse de partir
avec elle.
Le lecteur est d'autant plus épris par sa lecture qu'il
arrive parfois à ressentir une forme d'empathie pour certains
personnages qui ne la méritent pas forcément, et c'est d'ailleurs
là toute la magie de la littérature fictive, qui a ce pouvoir
d'enrôler les lecteurs et de faire d'eux les partisans de sujets
ignobles ou de personnages monstrueux.
On peut par exemple
citer le roman de Robert Louis Stevenson Docteur Jekyll et Mr
Hyde, dans lequel le Docteur Jekyll développe une drogue pour
dissocier le bien du mal mais se retrouve intoxiqué par son propre
breuvage et se transforme en son alter ego maléfique Mr Hyde,
qui le poussera à comettre des choses horribles , et finalement au
suicide.
On ne peut ici s'empêcher d'éprouver tout de même une
certaine compassion pour cet homme, qui n'était au départ animé
que de bonnes intentions.
Le lecteur est donc finalement perçu
comme une sorte de pantin, en proie aux intentions de l'auteur et
à son monde dans lequel il est invité à se confondre.
"L'attente qui ne cherche pas à aboutir" peut également
s'avérer être l'effet d'une surprise de la part du lecteur, qui ne
s'attendait pas à rencontrer tel ou tel schéma narratif dans telle
ou telle oeuvre.
Car en effet, lorsqu'il ouvre un livre, le lecteur
amateur est toujours influencé par certains codes littéraires, que
ce soit sur la forme ou sur le fond.
Ainsi, le professeur de
littérature à l'Université de Constance Hans Robert Jauss définit le
concept "d'horizon d'attente".
C'est un système de référence
objectivement formulable, qui pour chaque oeuvre au moment de
l'histoire où elle apparaît résulte de trois facteurs principaux:
l'éxpérience préalable que le public a du genre dont elle relève, la
forme et la thématique dont elle présuppose la connaissance ainsi
que l'opposition entre le langage....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LECTURE LINÉAIRE 12 « Mémoires d’une âme » « Melancholia », Les Contemplations, (1856), Victor Hugo
- lecture de l'incipit de Bouvard et Pécuchet de Flaubert
- Fiche de lecture - Les Globalisations, P.N Giraud
- Argument lecture linéaire sur la princesse de clèves - scène d'aveu et caractère exceptionnel des personnages
- fiche de lecture manon lescaut 20/20