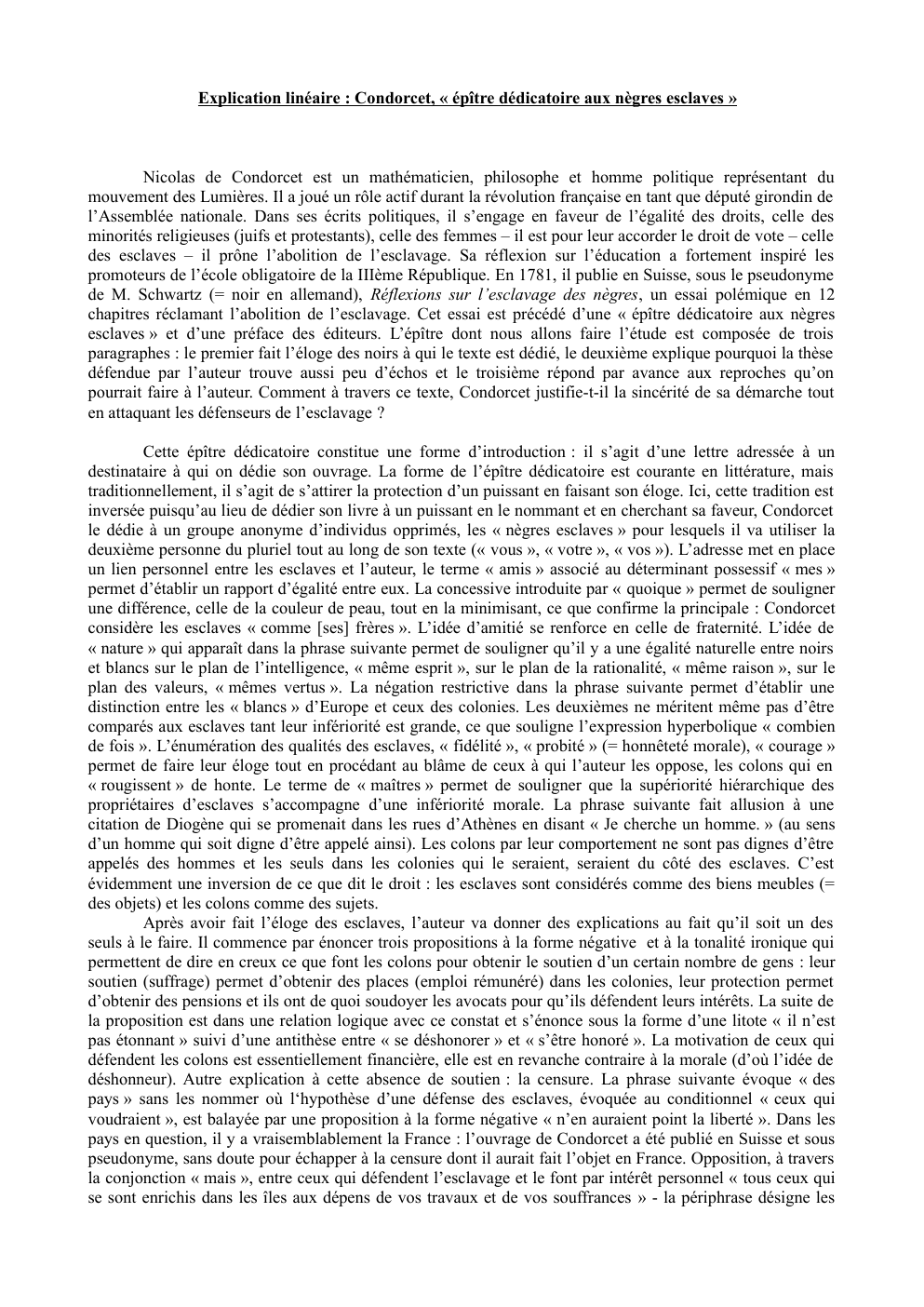Explication linéaire : Condorcet, « épître dédicatoire aux nègres esclaves »
Publié le 25/03/2025
Extrait du document
«
Explication linéaire : Condorcet, « épître dédicatoire aux nègres esclaves »
Nicolas de Condorcet est un mathématicien, philosophe et homme politique représentant du
mouvement des Lumières.
Il a joué un rôle actif durant la révolution française en tant que député girondin de
l’Assemblée nationale.
Dans ses écrits politiques, il s’engage en faveur de l’égalité des droits, celle des
minorités religieuses (juifs et protestants), celle des femmes – il est pour leur accorder le droit de vote – celle
des esclaves – il prône l’abolition de l’esclavage.
Sa réflexion sur l’éducation a fortement inspiré les
promoteurs de l’école obligatoire de la IIIème République.
En 1781, il publie en Suisse, sous le pseudonyme
de M.
Schwartz (= noir en allemand), Réflexions sur l’esclavage des nègres, un essai polémique en 12
chapitres réclamant l’abolition de l’esclavage.
Cet essai est précédé d’une « épître dédicatoire aux nègres
esclaves » et d’une préface des éditeurs.
L’épître dont nous allons faire l’étude est composée de trois
paragraphes : le premier fait l’éloge des noirs à qui le texte est dédié, le deuxième explique pourquoi la thèse
défendue par l’auteur trouve aussi peu d’échos et le troisième répond par avance aux reproches qu’on
pourrait faire à l’auteur.
Comment à travers ce texte, Condorcet justifie-t-il la sincérité de sa démarche tout
en attaquant les défenseurs de l’esclavage ?
Cette épître dédicatoire constitue une forme d’introduction : il s’agit d’une lettre adressée à un
destinataire à qui on dédie son ouvrage.
La forme de l’épître dédicatoire est courante en littérature, mais
traditionnellement, il s’agit de s’attirer la protection d’un puissant en faisant son éloge.
Ici, cette tradition est
inversée puisqu’au lieu de dédier son livre à un puissant en le nommant et en cherchant sa faveur, Condorcet
le dédie à un groupe anonyme d’individus opprimés, les « nègres esclaves » pour lesquels il va utiliser la
deuxième personne du pluriel tout au long de son texte (« vous », « votre », « vos »).
L’adresse met en place
un lien personnel entre les esclaves et l’auteur, le terme « amis » associé au déterminant possessif « mes »
permet d’établir un rapport d’égalité entre eux.
La concessive introduite par « quoique » permet de souligner
une différence, celle de la couleur de peau, tout en la minimisant, ce que confirme la principale : Condorcet
considère les esclaves « comme [ses] frères ».
L’idée d’amitié se renforce en celle de fraternité.
L’idée de
« nature » qui apparaît dans la phrase suivante permet de souligner qu’il y a une égalité naturelle entre noirs
et blancs sur le plan de l’intelligence, « même esprit », sur le plan de la rationalité, « même raison », sur le
plan des valeurs, « mêmes vertus ».
La négation restrictive dans la phrase suivante permet d’établir une
distinction entre les « blancs » d’Europe et ceux des colonies.
Les deuxièmes ne méritent même pas d’être
comparés aux esclaves tant leur infériorité est grande, ce que souligne l’expression hyperbolique « combien
de fois ».
L’énumération des qualités des esclaves, « fidélité », « probité » (= honnêteté morale), « courage »
permet de faire leur éloge tout en procédant au blâme de ceux à qui l’auteur les oppose, les colons qui en
« rougissent » de honte.
Le terme de « maîtres » permet de souligner que la supériorité hiérarchique des
propriétaires d’esclaves s’accompagne d’une infériorité morale.
La phrase suivante fait allusion à une
citation de Diogène qui se promenait dans les rues d’Athènes en disant « Je cherche un homme.
» (au sens
d’un homme qui soit digne d’être appelé ainsi).
Les colons par leur comportement ne sont pas dignes d’être
appelés des hommes et les seuls dans les colonies qui le seraient, seraient du côté des esclaves.
C’est
évidemment une inversion de ce que dit le droit : les esclaves sont considérés comme des biens meubles (=
des objets) et les colons comme des sujets.
Après avoir fait l’éloge des esclaves, l’auteur va donner des explications au fait qu’il soit un des
seuls à le faire.
Il commence par énoncer trois propositions à la forme négative et à la tonalité ironique qui
permettent de dire en creux ce que font les colons pour obtenir le soutien d’un certain nombre de gens : leur
soutien (suffrage) permet d’obtenir des places (emploi rémunéré) dans les colonies, leur protection permet
d’obtenir des pensions et ils ont de quoi soudoyer les avocats pour qu’ils défendent leurs intérêts.
La suite de
la proposition est dans une relation logique avec ce constat et s’énonce sous la forme d’une litote « il n’est
pas étonnant » suivi d’une antithèse entre « se déshonorer » et « s’être honoré ».
La motivation de ceux qui
défendent les colons est essentiellement financière, elle est en revanche contraire à la morale (d’où l’idée de
déshonneur).
Autre explication à cette absence de soutien : la censure.
La phrase suivante évoque « des
pays » sans les nommer où l‘hypothèse d’une défense des esclaves, évoquée au conditionnel « ceux qui
voudraient », est balayée par une proposition à la forme négative « n’en auraient point la liberté ».
Dans les
pays en question, il y a vraisemblablement la France : l’ouvrage de Condorcet a été publié en Suisse et sous
pseudonyme, sans doute pour échapper à la censure dont il aurait fait l’objet en France.
Opposition, à travers
la conjonction « mais », entre ceux qui défendent l’esclavage et le font par intérêt personnel « tous ceux qui
se sont enrichis dans les îles aux dépens de vos travaux et de vos souffrances » - la périphrase désigne les
colons mais également ceux qui profitent de l’argent des colons puisque l’argent vient du travail des esclaves
et qui produisent une littérature favorable à l’esclavage qualifiée sous l’appellation péjorative de « libelles
calomnieux....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Manon Lescaut extrait 1 étude linéaire: Explication linéaire, extrait 1 : « J'avais marqué le temps de mon départ … ses malheurs et les miens. »
- explication linéaire Prologue de "juste la fin du monde"
- explication linéaire Wajdi Mouawad, Incendies , Première partie, « Incendie de Nawal », 2009, Léméac
- La Princesse de Clèves, explications linéaires Explication linéaire I : de « Madame de Chartres, qui avait eu tant d’application […] » à « […] quand on était jeune. » (Première partie)
- Explication linéaire Abbaye de Thélème