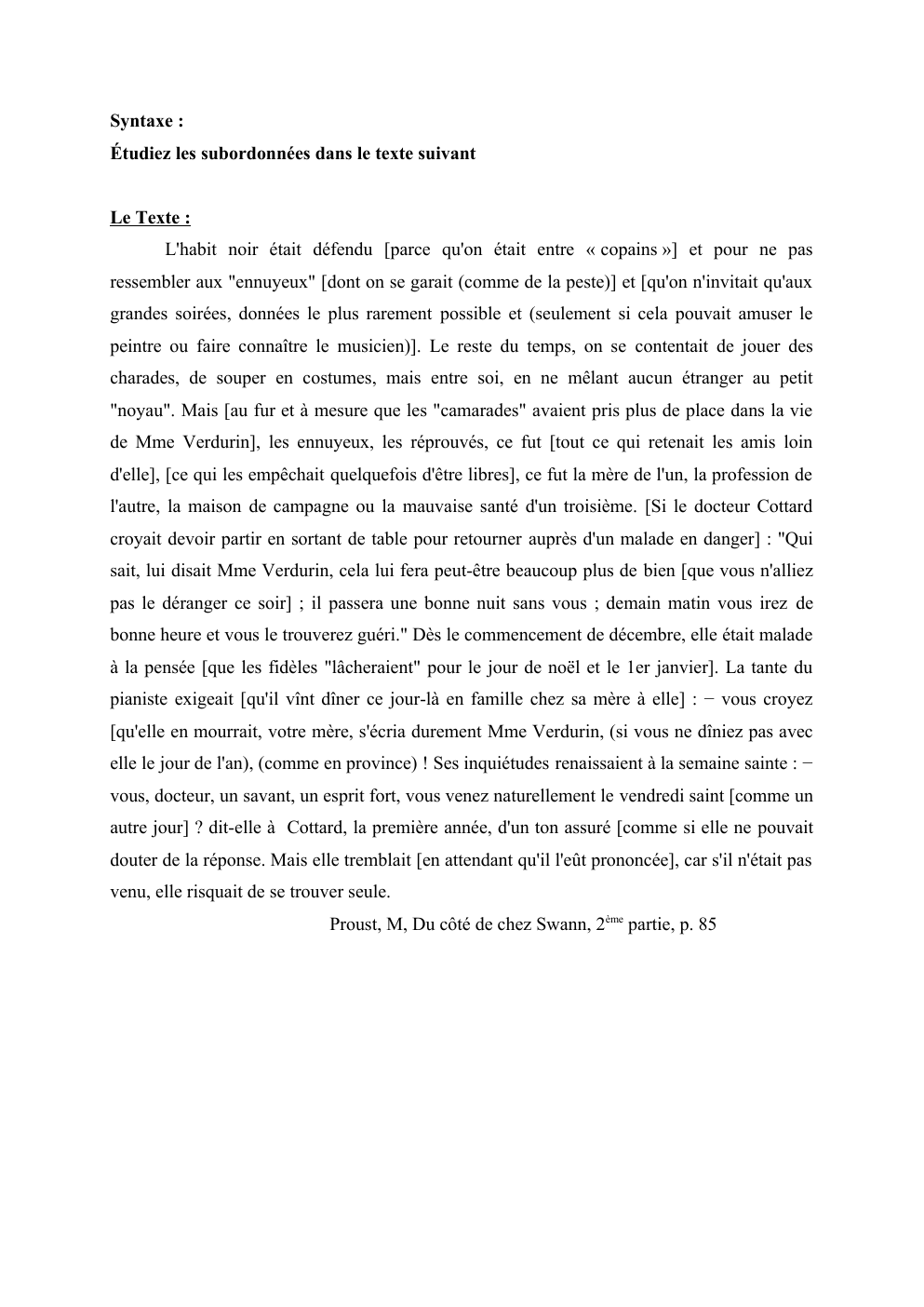Étudiez les subordonnées dans le texte suivant - Proust, M, Du côté de chez Swann, 2ème partie, p. 85
Publié le 18/04/2025
Extrait du document
«
Syntaxe :
Étudiez les subordonnées dans le texte suivant
Le Texte :
L'habit noir était défendu [parce qu'on était entre « copains »] et pour ne pas
ressembler aux "ennuyeux" [dont on se garait (comme de la peste)] et [qu'on n'invitait qu'aux
grandes soirées, données le plus rarement possible et (seulement si cela pouvait amuser le
peintre ou faire connaître le musicien)].
Le reste du temps, on se contentait de jouer des
charades, de souper en costumes, mais entre soi, en ne mêlant aucun étranger au petit
"noyau".
Mais [au fur et à mesure que les "camarades" avaient pris plus de place dans la vie
de Mme Verdurin], les ennuyeux, les réprouvés, ce fut [tout ce qui retenait les amis loin
d'elle], [ce qui les empêchait quelquefois d'être libres], ce fut la mère de l'un, la profession de
l'autre, la maison de campagne ou la mauvaise santé d'un troisième.
[Si le docteur Cottard
croyait devoir partir en sortant de table pour retourner auprès d'un malade en danger] : "Qui
sait, lui disait Mme Verdurin, cela lui fera peut-être beaucoup plus de bien [que vous n'alliez
pas le déranger ce soir] ; il passera une bonne nuit sans vous ; demain matin vous irez de
bonne heure et vous le trouverez guéri." Dès le commencement de décembre, elle était malade
à la pensée [que les fidèles "lâcheraient" pour le jour de noël et le 1er janvier].
La tante du
pianiste exigeait [qu'il vînt dîner ce jour-là en famille chez sa mère à elle] : − vous croyez
[qu'elle en mourrait, votre mère, s'écria durement Mme Verdurin, (si vous ne dîniez pas avec
elle le jour de l'an), (comme en province) ! Ses inquiétudes renaissaient à la semaine sainte : −
vous, docteur, un savant, un esprit fort, vous venez naturellement le vendredi saint [comme un
autre jour] ? dit-elle à Cottard, la première année, d'un ton assuré [comme si elle ne pouvait
douter de la réponse.
Mais elle tremblait [en attendant qu'il l'eût prononcée], car s'il n'était pas
venu, elle risquait de se trouver seule.
Proust, M, Du côté de chez Swann, 2ème partie, p.
85
Corrigé
Introduction :
Le texte que nous étudions illustre trois classes de subordonnées, à savoir les relatives,
les complétives et les circonstancielles (adverbiales).
Toutes les subordonnées sont introduites
par des subordonnants.
La classement que nous adopterons pour ce corpus se fondera sur le
critère de la classe de la subordonnée.
1- Les subordonnées relatives :
Nous relevons dans le texte 4 subordonnées relatives, deux relatives adjectivales et
deux relatives substantivales périphrastiques
1.1-
Les relatives adjectivales :
a- [dont on se garait comme de la peste]
b- [qu'on n'invitait qu'aux grandes soirées, données le plus rarement possible et
seulement si cela pouvait amuser le peintre ou faire connaître le musicien]
Il s’agit dans les deux cas de relatives adjectivales déterminatives explicatives
coordonnées, en fonction d’épithètes liées au nom « ennuyeux » qui est à la fois leur support
et l’antécédent des pronoms relatifs qui les introduisent, respectivement, dont et que.
Ces
relatives sont accessoires du point de vue syntaxique et sémantique, étant donné que leur
support est saturé du point de vue sémantique.
Le pronom relatif « dont » est COI du verbe
« se garer » et le pronom « que » et COD du verbe « inviter ».
Les deux subordonnées sont
enchâssantes : la première enchâsse une comparative elliptique et la seconde une
conditionnelle.
Les verbes des deux relatives sont à l’indicatif étant donné que leur antécédent
est actualisé.
1.2-
Les relatives substantivales périphrastiques :
Le texte n’illustre pas de relatives substantivales pures.
Les deux subordonnées sont
des périphrastiques.
a- [tout ce qui retenait les amis loin d'elle]
b- [ce qui les empêchait quelquefois d'être libres]
Ces deux propositions sont juxtaposées et fonctionnent comme un régime du
présentatif « ce fut » qui est leur support, leur nominalisation étant tout à fait possible : ce fut
le motif pour lequel ses amis s’en éloignaient, l’entrave à leur liberté ».
Toutes les deux sont
introduites par la locution relative « ce qui ».
Les verbes des subordonnées sont à l’indicatif
conformément à la règle pour les substantivales.
2.
Les subordonnées complétives :
Il s’agit des subordonnées :
a- [que les fidèles "lâcheraient" pour le jour de noël et le 1er janvier]
b- [qu'elle en mourrait, votre mère, s'écria durement Mme Verdurin, si vous ne dîniez
pas avec elle le jour de l'an, comme en province !
c- [qu'il vînt dîner ce jour-là en famille chez sa mère à elle]
d- [que vous n'alliez pas le déranger ce soir]
Toutes ces propositions sont des substantives pures et sont introduites par la
conjonction de subordination « que », qui n’a pas de consistance sémantique et qui est non
fonctionnelle.
La proposition « a » est un complément du nom pensée qui est son support,
alors que « b », qui enchâsse une subordonnée hypothétique, et « c » sont des COD des verbes
« exiger » et « croire ».
Le mode dans « a » est l’indicatif (le conditionnel a ici une valeur
temporelle de futur) étant donné que le support nominal a le sens d’un verbe d’opinion.
Pour
dans « b », c’est le conditionnel présent qui est utilisé en corrélation avec l’imparfait de
l’indicatif de la subordonnée hypothétique enchâssée Au contraire dans « b », il y a usage du
subjonctif parce que le support est un verbe de volonté.
Pour ce qui est de « d », elle peut être analysée de deux manières.
La première
hypothèse, plus plausible, permettrait de considérer comme une complétive, si on considère
qu’il s’agit d’un sujet inversé d’une sorte de construction impersonnelle (cela lui fera
beaucoup plus de bien= il lui fera ….) ce qui permet de la lire de la façon suivante (que vous
n’alliez pas le déranger ce soir, lui fera beaucoup plus de bien).
C’est d’ailleurs de ce point de
vue que s’expliquera l’emploi du subjonctif « alliez ».
La seconde hypothèse
est de
l’interpréter comme une hypothétique avec ellipse du subordonnant « si » (cela lui fera
beaucoup plus de bien que....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Analyse Texte 1 Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, Olympe de Gouges ( 1791)
- explication de texte
- Texte de Hobbes : Explication de texte - Thèmes : le désir, le bonheur , la définition du bonheur
- Texte 1 : « Homme est tu capable d’être juste ? »
- Correction de l’explication d’un texte de Hobbes Extrait tiré de l’ouvrage Le Citoyen ou Les Fondements de la politique, 1642