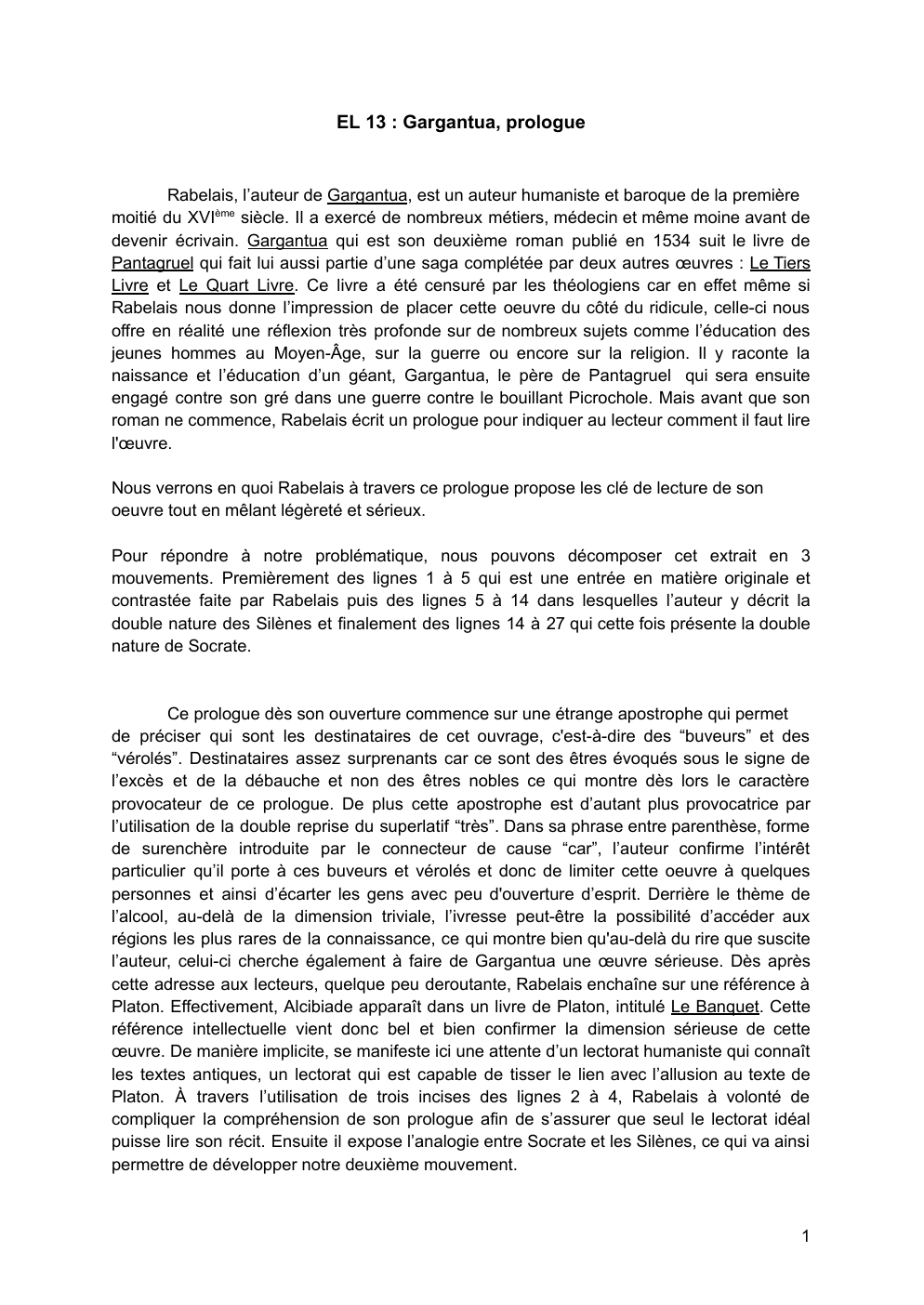Etude Lineaire Gargantua, prologue
Publié le 19/06/2023
Extrait du document
«
EL 13 : Gargantua, prologue
Rabelais, l’auteur de Gargantua, est un auteur humaniste et baroque de la première
moitié du XVIème siècle.
Il a exercé de nombreux métiers, médecin et même moine avant de
devenir écrivain.
Gargantua qui est son deuxième roman publié en 1534 suit le livre de
Pantagruel qui fait lui aussi partie d’une saga complétée par deux autres œuvres : Le Tiers
Livre et Le Quart Livre.
Ce livre a été censuré par les théologiens car en effet même si
Rabelais nous donne l’impression de placer cette oeuvre du côté du ridicule, celle-ci nous
offre en réalité une réflexion très profonde sur de nombreux sujets comme l’éducation des
jeunes hommes au Moyen-Âge, sur la guerre ou encore sur la religion.
Il y raconte la
naissance et l’éducation d’un géant, Gargantua, le père de Pantagruel qui sera ensuite
engagé contre son gré dans une guerre contre le bouillant Picrochole.
Mais avant que son
roman ne commence, Rabelais écrit un prologue pour indiquer au lecteur comment il faut lire
l'œuvre.
Nous verrons en quoi Rabelais à travers ce prologue propose les clé de lecture de son
oeuvre tout en mêlant légèreté et sérieux.
Pour répondre à notre problématique, nous pouvons décomposer cet extrait en 3
mouvements.
Premièrement des lignes 1 à 5 qui est une entrée en matière originale et
contrastée faite par Rabelais puis des lignes 5 à 14 dans lesquelles l’auteur y décrit la
double nature des Silènes et finalement des lignes 14 à 27 qui cette fois présente la double
nature de Socrate.
Ce prologue dès son ouverture commence sur une étrange apostrophe qui permet
de préciser qui sont les destinataires de cet ouvrage, c'est-à-dire des “buveurs” et des
“vérolés”.
Destinataires assez surprenants car ce sont des êtres évoqués sous le signe de
l’excès et de la débauche et non des êtres nobles ce qui montre dès lors le caractère
provocateur de ce prologue.
De plus cette apostrophe est d’autant plus provocatrice par
l’utilisation de la double reprise du superlatif “très”.
Dans sa phrase entre parenthèse, forme
de surenchère introduite par le connecteur de cause “car”, l’auteur confirme l’intérêt
particulier qu’il porte à ces buveurs et vérolés et donc de limiter cette oeuvre à quelques
personnes et ainsi d’écarter les gens avec peu d'ouverture d’esprit.
Derrière le thème de
l’alcool, au-delà de la dimension triviale, l’ivresse peut-être la possibilité d’accéder aux
régions les plus rares de la connaissance, ce qui montre bien qu'au-delà du rire que suscite
l’auteur, celui-ci cherche également à faire de Gargantua une œuvre sérieuse.
Dès après
cette adresse aux lecteurs, quelque peu deroutante, Rabelais enchaîne sur une référence à
Platon.
Effectivement, Alcibiade apparaît dans un livre de Platon, intitulé Le Banquet.
Cette
référence intellectuelle vient donc bel et bien confirmer la dimension sérieuse de cette
œuvre.
De manière implicite, se manifeste ici une attente d’un lectorat humaniste qui connaît
les textes antiques, un lectorat qui est capable de tisser le lien avec l’allusion au texte de
Platon.
À travers l’utilisation de trois incises des lignes 2 à 4, Rabelais à volonté de
compliquer la compréhension de son prologue afin de s’assurer que seul le lectorat idéal
puisse lire son récit.
Ensuite il expose l’analogie entre Socrate et les Silènes, ce qui va ainsi
permettre de développer notre deuxième mouvement.
1
Dans le deuxième mouvement, fidèle à son objectif pédagogique, le locuteur définit
ce qu’est un Silène : Rabelais passe ainsi par une comparaison pour rendre accessible
l’explication.
“comme nous en voyons à présent dans les boutiques des apothicaires”, ici le
pronom personnel “nous” et l’adverbe “à présent”, mobilisent une expérience commune
entre le lecteur et le locuteur.
Une antithèse entre les termes “jadis” et “à présent” est créée
et permet donc de mettre en évidence un parallélisme entre l’Antiquité et le XVIème siècle.
A
la ligne 7, Rabelais commence une description extérieure des boîtes, dans la continuation
de ce passage descriptif, l’auteur fait une longue énumération des “figures comiques et
frivoles” présentes sur ces boîtes.
Elle est variée et fait apparaître des éléments relevants de
divers domaines : des êtres imaginaires issus de l’Antiquité “des harpies, des satyres”des
êtres tirés de l’imagination de Rabelais “des oisons bridés, des lièvres cornus”, éléments
relevants ainsi de la fantaisie.
L’énumération de ces figures mythologiques et animaux
extraordinaires qui renvoient à un univers familier aux lecteurs, en associant un bestiaire
légendaire et mythologique à une culture populaire, l’auteur produit un effet récréatif en
introduisant une esthétique du grotesque et du merveilleux.
Rabelais relie ensuite Silène au
personnage mythologique de Bacchus, comme....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- François Rabelais épisode carnavalesque Paris Gargantua
- etude linéaire sur Manon Lescaut
- analyse lineaire celle qui est trop gaie
- Etude linéaire n°16 : Marguerite Yourcenar, Les Mémoires d’Hadrien, « Varius multiplex multiformis », pages 105-106 (édition Folio) O. I.
- ANALYSE LINEAIRE HUITRE DE PONGE