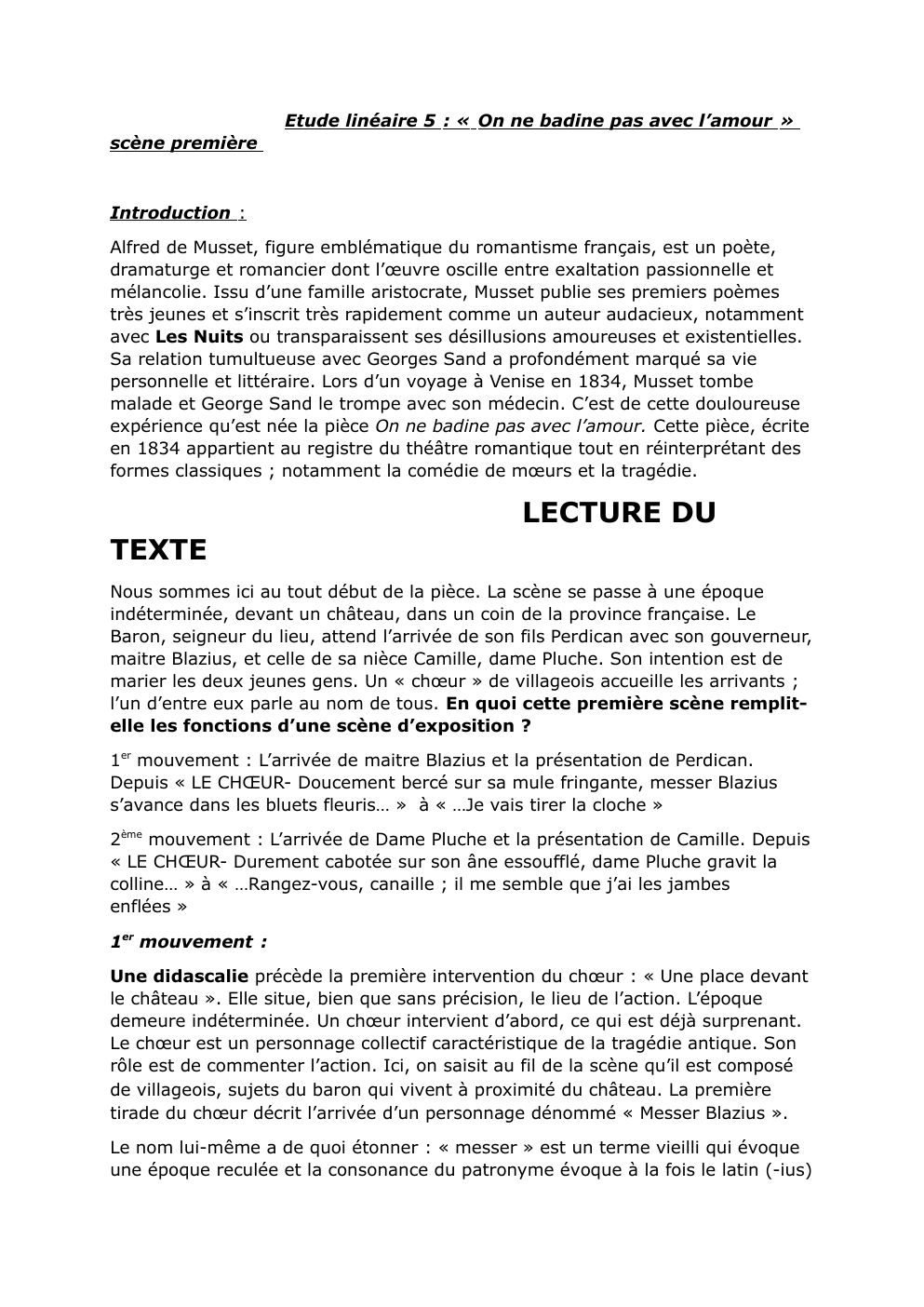Etude linéaire 5 : « On ne badine pas avec l’amour » scène première
Publié le 11/04/2025
Extrait du document
«
Etude linéaire 5 : « On ne badine pas avec l’amour »
scène première
Introduction :
Alfred de Musset, figure emblématique du romantisme français, est un poète,
dramaturge et romancier dont l’œuvre oscille entre exaltation passionnelle et
mélancolie.
Issu d’une famille aristocrate, Musset publie ses premiers poèmes
très jeunes et s’inscrit très rapidement comme un auteur audacieux, notamment
avec Les Nuits ou transparaissent ses désillusions amoureuses et existentielles.
Sa relation tumultueuse avec Georges Sand a profondément marqué sa vie
personnelle et littéraire.
Lors d’un voyage à Venise en 1834, Musset tombe
malade et George Sand le trompe avec son médecin.
C’est de cette douloureuse
expérience qu’est née la pièce On ne badine pas avec l’amour.
Cette pièce, écrite
en 1834 appartient au registre du théâtre romantique tout en réinterprétant des
formes classiques ; notamment la comédie de mœurs et la tragédie.
LECTURE DU
TEXTE
Nous sommes ici au tout début de la pièce.
La scène se passe à une époque
indéterminée, devant un château, dans un coin de la province française.
Le
Baron, seigneur du lieu, attend l’arrivée de son fils Perdican avec son gouverneur,
maitre Blazius, et celle de sa nièce Camille, dame Pluche.
Son intention est de
marier les deux jeunes gens.
Un « chœur » de villageois accueille les arrivants ;
l’un d’entre eux parle au nom de tous.
En quoi cette première scène remplitelle les fonctions d’une scène d’exposition ?
1er mouvement : L’arrivée de maitre Blazius et la présentation de Perdican.
Depuis « LE CHŒUR- Doucement bercé sur sa mule fringante, messer Blazius
s’avance dans les bluets fleuris… » à « …Je vais tirer la cloche »
2ème mouvement : L’arrivée de Dame Pluche et la présentation de Camille.
Depuis
« LE CHŒUR- Durement cabotée sur son âne essoufflé, dame Pluche gravit la
colline… » à « …Rangez-vous, canaille ; il me semble que j’ai les jambes
enflées »
1er mouvement :
Une didascalie précède la première intervention du chœur : « Une place devant
le château ».
Elle situe, bien que sans précision, le lieu de l’action.
L’époque
demeure indéterminée.
Un chœur intervient d’abord, ce qui est déjà surprenant.
Le chœur est un personnage collectif caractéristique de la tragédie antique.
Son
rôle est de commenter l’action.
Ici, on saisit au fil de la scène qu’il est composé
de villageois, sujets du baron qui vivent à proximité du château.
La première
tirade du chœur décrit l’arrivée d’un personnage dénommé « Messer Blazius ».
Le nom lui-même a de quoi étonner : « messer » est un terme vieilli qui évoque
une époque reculée et la consonance du patronyme évoque à la fois le latin (-ius)
et l’argot « blase », qui signifie « nez » ou « nom ».
Quelque chose de ridicule
émane d’emblée de ce personnage.
L’entrée en scène commentée par le chœur
s’impose comme un moment comique et fait signe du côté de la caricature : on a
affaire au portrait d’un personnage tout en rondeur, paresseux et gourmand, qui
récite des prières et ne pense qu’à boire.
Les comparaisons utilisées ridiculisent
Blazius : il est « comme un poupon » donc renvoyé à la toute petite enfance et «
pareil à une amphore antique ».
La forme ovale des vases antiques destinés à contenir le vin justifie sans doute
l’image, de manière burlesque.
Le champ lexical de l’assoupissement est
perceptible : « oreiller », « yeux à demi fermés » et renforce le caractère
paresseux perçu d’emblée.
Son inclination nette vers les plaisirs dionysiaques (le
vin) est aussi indiquée par la comparaison à une amphore et par son arrivée à
point nommé « au temps de la vendange ».
On remarque que la présentation de Blazius par le chœur fait entendre une
majorité de consonnes labiales (phénomène d’allitération).
Les sonorités en
/p/, /b/ et /m/ dominent, tout en rondeur.
La première intervention de Blazius consiste significativement à demander avant
toute chose « un verre de vin frais » : l’ivrognerie comique du personnage est
confirmée.
En échange, il promet « une nouvelle d’importance » qui éveille
l’intérêt des spectateurs visés par la double énonciation.
Le chœur se montre
accueillant en présentant sa « plus grande écuelle », superlative quant au
volume mais pas quant au raffinement.
Sa sollicitude apparaît donc comme un
peu moqueuse.
Nous apprenons dans la tirade de Blazius ce qui justifie son titre de « maître » :
il est le « gouverneur » du « jeune Perdican, fils de notre seigneur » « depuis
l’âge de ses quatre ans ».
À ce titre, il se montre paternel envers le chœur qu’il
appelle « mes enfants ».
La raison de son retour au château est également annoncée : le jeune Perdican a
atteint la majorité et a fini ses études brillamment en étant « reçu docteur ».
S’ensuit un éloge du jeune châtelain qui fait l’admiration de son précepteur.
L’éloge est fortement axé sur le caractère savant de Perdican.
On retrouve des
procédés habituels de ce type de discours avec l’emploi des adverbes
d’intensité : « la bouche toute pleine de façons de parler si belles et si fleuries »
et des métaphores laudatives : « Toute sa gracieuse personne est un livre d’or »
et « Enfin, c’est un diamant fin des pieds à la tête », qui insistent sur la valeur du
jeune maître.
L’éloge est teinté d’une certaine maladresse car le spectateur peut douter avec
un certain mauvais esprit de l’utilité de ces connaissances…
La sensibilité à l’art de Perdican est également présentée avec une naïveté qui
frise le ridicule : « vous ouvririez des yeux grands comme la porte que voilà, de
le voir dérouler un des parchemins qu’il a coloriés d’encres de toutes couleurs, de
ses propres mains et sans en rien dire à personne.
»
Les qualités de Perdican soulignent par contraste l’ignorance de son entourage :
« la bouche toute pleine de façons de parler si belles et si fleuries qu’on ne sait
que lui répondre les trois quarts du temps.
» Perdican est habile orateur, on
gagnera à s’en souvenir pour le reste de....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Analyse linéaire Cyrano de Bergerac - La scène du balcon
- etude linéaire sur Manon Lescaut
- Argument lecture linéaire sur la princesse de clèves - scène d'aveu et caractère exceptionnel des personnages
- Etude linéaire n°16 : Marguerite Yourcenar, Les Mémoires d’Hadrien, « Varius multiplex multiformis », pages 105-106 (édition Folio) O. I.
- Séquence 3 : Le Malade imaginaire de Molière. Analyse linéaire n°12 scène 10 acte III