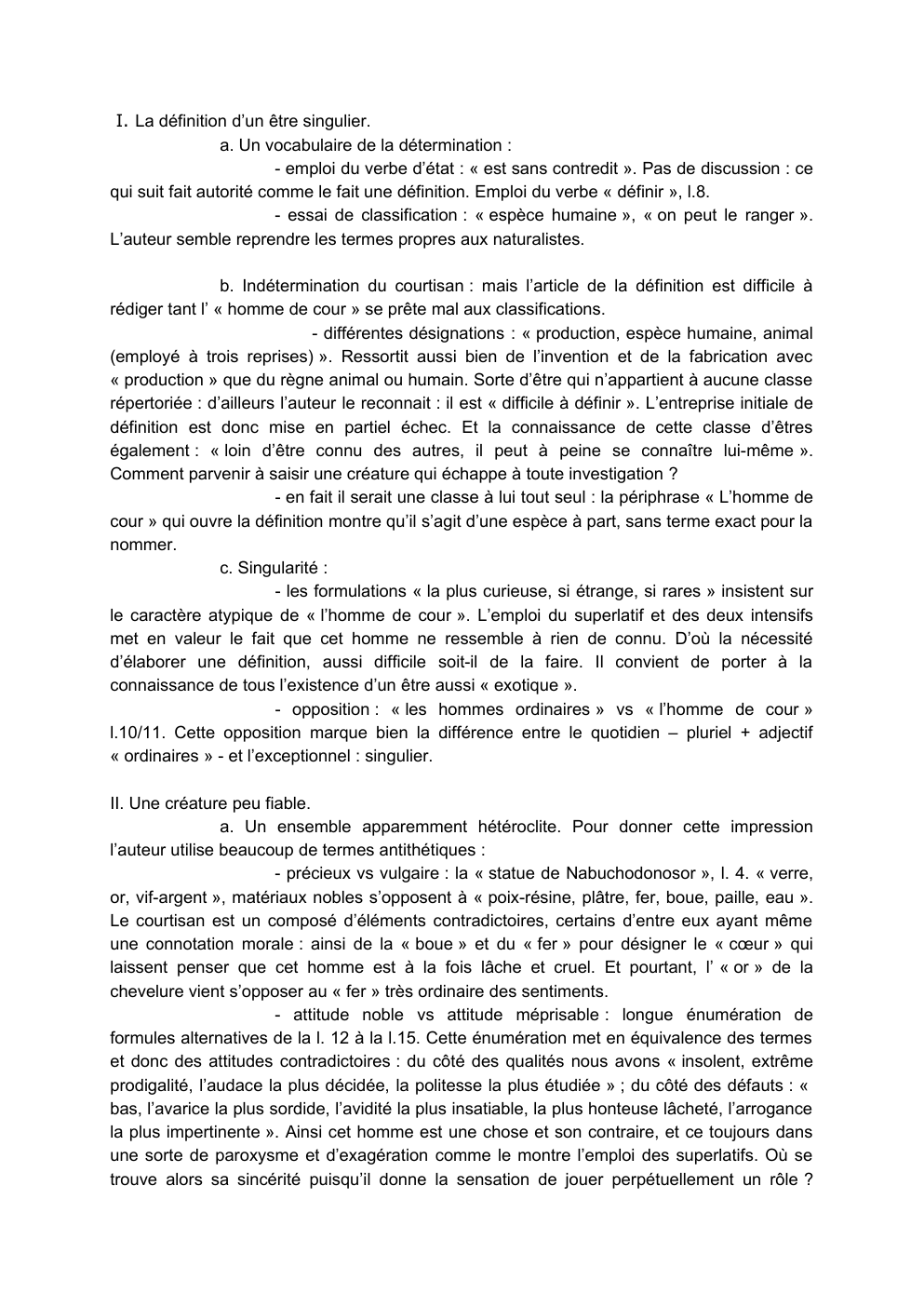Commentaire Premiers paragraphes "De l'art de ramper" d'Holbach
Publié le 04/04/2023
Extrait du document
«
I.
La définition d’un être singulier.
a.
Un vocabulaire de la détermination :
- emploi du verbe d’état : « est sans contredit ».
Pas de discussion : ce
qui suit fait autorité comme le fait une définition.
Emploi du verbe « définir », l.8.
- essai de classification : « espèce humaine », « on peut le ranger ».
L’auteur semble reprendre les termes propres aux naturalistes.
b.
Indétermination du courtisan : mais l’article de la définition est difficile à
rédiger tant l’ « homme de cour » se prête mal aux classifications.
- différentes désignations : « production, espèce humaine, animal
(employé à trois reprises) ».
Ressortit aussi bien de l’invention et de la fabrication avec
« production » que du règne animal ou humain.
Sorte d’être qui n’appartient à aucune classe
répertoriée : d’ailleurs l’auteur le reconnait : il est « difficile à définir ».
L’entreprise initiale de
définition est donc mise en partiel échec.
Et la connaissance de cette classe d’êtres
également : « loin d’être connu des autres, il peut à peine se connaître lui-même ».
Comment parvenir à saisir une créature qui échappe à toute investigation ?
- en fait il serait une classe à lui tout seul : la périphrase « L’homme de
cour » qui ouvre la définition montre qu’il s’agit d’une espèce à part, sans terme exact pour la
nommer.
c.
Singularité :
- les formulations « la plus curieuse, si étrange, si rares » insistent sur
le caractère atypique de « l’homme de cour ».
L’emploi du superlatif et des deux intensifs
met en valeur le fait que cet homme ne ressemble à rien de connu.
D’où la nécessité
d’élaborer une définition, aussi difficile soit-il de la faire.
Il convient de porter à la
connaissance de tous l’existence d’un être aussi « exotique ».
- opposition : « les hommes ordinaires » vs « l’homme de cour »
l.10/11.
Cette opposition marque bien la différence entre le quotidien – pluriel + adjectif
« ordinaires » - et l’exceptionnel : singulier.
II.
Une créature peu fiable.
a.
Un ensemble apparemment hétéroclite.
Pour donner cette impression
l’auteur utilise beaucoup de termes antithétiques :
- précieux vs vulgaire : la « statue de Nabuchodonosor », l.
4.
« verre,
or, vif-argent », matériaux nobles s’opposent à « poix-résine, plâtre, fer, boue, paille, eau ».
Le courtisan est un composé d’éléments contradictoires, certains d’entre eux ayant même
une connotation morale : ainsi de la « boue » et du « fer » pour désigner le « cœur » qui
laissent penser que cet homme est à la fois lâche et cruel.
Et pourtant, l’ « or » de la
chevelure vient s’opposer au « fer » très ordinaire des sentiments.
- attitude noble vs attitude méprisable : longue énumération de
formules alternatives de la l.
12 à la l.15.
Cette énumération met en équivalence des termes
et donc des attitudes contradictoires : du côté des qualités nous avons « insolent, extrême
prodigalité, l’audace la plus décidée, la politesse la plus étudiée » ; du côté des défauts : «
bas, l’avarice la plus sordide, l’avidité la plus insatiable, la plus honteuse lâcheté, l’arrogance
la plus impertinente ».
Ainsi cet homme est une chose et son contraire, et ce toujours dans
une sorte de paroxysme et d’exagération comme le montre l’emploi des superlatifs.
Où se
trouve alors....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- commentaire holbach
- La politique n'est-elle qu'un art du calcul ?
- MÉTHODOLOGIE DU COMMENTAIRE DE PHILOSOPHIE
- « L’art imite la nature » ARISTOTE
- Les oeuvres d'art sont ascétiques et sans pudeur... Horkheimer