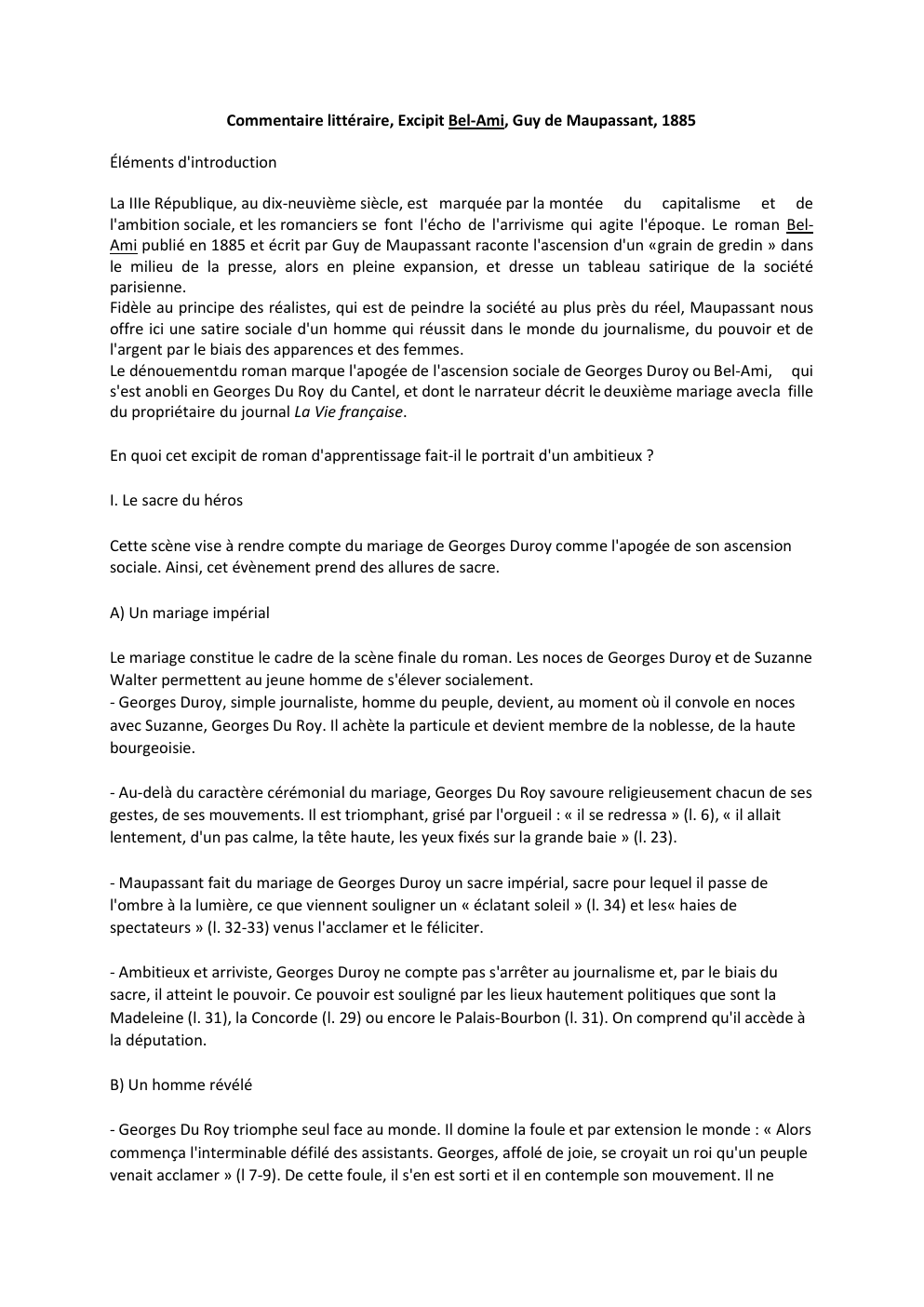Commentaire littéraire, Excipit Bel-Ami, Guy de Maupassant, 1885
Publié le 26/01/2025
Extrait du document
«
Commentaire littéraire, Excipit Bel-Ami, Guy de Maupassant, 1885
Éléments d'introduction
La IIIe République, au dix-neuvième siècle, est marquée par la montée du capitalisme et de
l'ambition sociale, et les romanciers se font l'écho de l'arrivisme qui agite l'époque.
Le roman BelAmi publié en 1885 et écrit par Guy de Maupassant raconte l'ascension d'un «grain de gredin » dans
le milieu de la presse, alors en pleine expansion, et dresse un tableau satirique de la société
parisienne.
Fidèle au principe des réalistes, qui est de peindre la société au plus près du réel, Maupassant nous
offre ici une satire sociale d'un homme qui réussit dans le monde du journalisme, du pouvoir et de
l'argent par le biais des apparences et des femmes.
Le dénouement du roman marque l'apogée de l'ascension sociale de Georges Duroy ou Bel-Ami, qui
s'est anobli en Georges Du Roy du Cantel, et dont le narrateur décrit le deuxième mariage avec la fille
du propriétaire du journal La Vie française.
En quoi cet excipit de roman d'apprentissage fait-il le portrait d'un ambitieux ?
I.
Le sacre du héros
Cette scène vise à rendre compte du mariage de Georges Duroy comme l'apogée de son ascension
sociale.
Ainsi, cet évènement prend des allures de sacre.
A) Un mariage impérial
Le mariage constitue le cadre de la scène finale du roman.
Les noces de Georges Duroy et de Suzanne
Walter permettent au jeune homme de s'élever socialement.
- Georges Duroy, simple journaliste, homme du peuple, devient, au moment où il convole en noces
avec Suzanne, Georges Du Roy.
Il achète la particule et devient membre de la noblesse, de la haute
bourgeoisie.
- Au-delà du caractère cérémonial du mariage, Georges Du Roy savoure religieusement chacun de ses
gestes, de ses mouvements.
Il est triomphant, grisé par l'orgueil : « il se redressa » (l.
6), « il allait
lentement, d'un pas calme, la tête haute, les yeux fixés sur la grande baie » (l.
23).
- Maupassant fait du mariage de Georges Duroy un sacre impérial, sacre pour lequel il passe de
l'ombre à la lumière, ce que viennent souligner un « éclatant soleil » (l.
34) et les« haies de
spectateurs » (l.
32-33) venus l'acclamer et le féliciter.
- Ambitieux et arriviste, Georges Duroy ne compte pas s'arrêter au journalisme et, par le biais du
sacre, il atteint le pouvoir.
Ce pouvoir est souligné par les lieux hautement politiques que sont la
Madeleine (l.
31), la Concorde (l.
29) ou encore le Palais-Bourbon (l.
31).
On comprend qu'il accède à
la députation.
B) Un homme révélé
- Georges Du Roy triomphe seul face au monde.
Il domine la foule et par extension le monde : « Alors
commença l'interminable défilé des assistants.
Georges, affolé de joie, se croyait un roi qu'un peuple
venait acclamer » (l 7-9).
De cette foule, il s'en est sorti et il en contemple son mouvement.
Il ne
court plus après le triomphe, il incarne le triomphe, la réussite, alors que le peuple de Paris continue
de grouiller, telle une marée humaine.
Maupassant s'inspire ici des théories sur la sélection naturelle
de Darwin.
On remarquera que d'un point de vue grammatical et lorsqu'il contemple sa réussite, il
devient le sujet de toutes les actions.
« Il allait lentement, d'un pas calme, la tête haute, les yeux fixés
sur la grande baie ensoleillée de la porte.
Il sentait sur sa peau courir de légers frissons, ces frissons
froids que donnent les immenses bonheurs.
Il ne voyait personne.
Il ne pensait qu'à lui » (l.
23-25).
- Du Roy devient alors l'objet de nombreuses convoitises.
Il exulte dans la solitude parce qu'il aime
être l'objet de tous les désirs : le désir charnel, devant le « soleil flottait l'image de Mme de Marelle
rajustant en face de la glace les petits cheveux frisés de ses tempes, toujours défaits au sortir du lit.
»
(l.
34-36) ; le désir social, le peuple envie son ascension fulgurante au sein de la société car « le
peuple de Paris le contemplait et l'enviait.
» (l.
27- 28) ; le désir politique car il incarne le pouvoir.
On
notera également que, d'un point de vue grammatical, Georges Du Roy est placé en position d'objet.
Il est donc un antihéros qui n'a que faire du bien moral, un ambitieux et un arriviste qui utilise les
autres, et en particulier les femmes, pour réussir.
II.
Une satire sociale
Georges Du Roy incarne en réalité un type.
Ce n'est pas seulement l'attitude de ce personnage que
Maupassant critique, c'est celle de tous les « Georges Du Roy » de la société parisienne du XIXe
siècle.
A) Paris, le théâtre des faux- semblants
- Maupassant donne à voir un spectacle.
En effet, le champ lexical du regard domine tout au long du
texte.
On retrouve les verbes « saluait » (l.
10), « aperçut » (l.
12), « les yeux fixés » (l.
23), « voyait »
(l.
25) et « contemplait » (l.
28).
Tout n'est qu'artifice.
Georges Duroy est un comédien que les
« spectateurs » (l.
33) viennent acclamer pour sa dernière.
Le clou du spectacle est son mariage : son
ascension sociale aboutira certainement à une carrière politique.
- Le passage au discours direct rappelle une scène des jeunes premiers : « Quelle charmante
maîtresse, tout de même » (l.
17) et « je t'aime toujours, je suis à toi ! » (l.
21).
Cela montre par la
même occasion que le mariage....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Fiche de Bel-ami Maupassant
- MÉTHODOLOGIE DU COMMENTAIRE DE PHILOSOPHIE
- commentaire philo Leibniz Monadologie et la justice
- commentaire de texte thérèse desqueroux
- Soren KIERKEGAARD (1813-1855) Ou bien ... ou bien, chapitre L'Assolement: commentaire