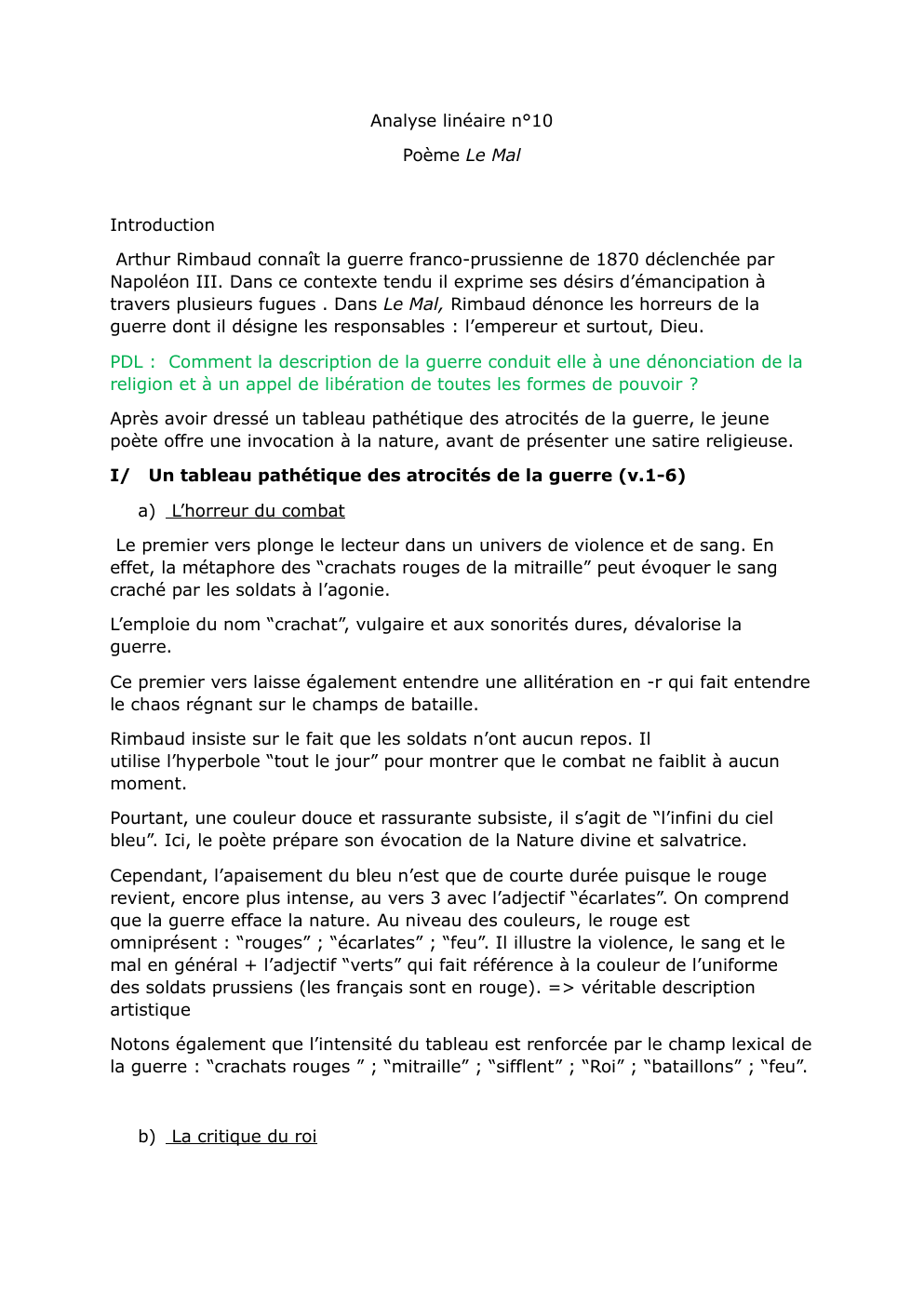Analyse linéaire Le Mal de Rimbaud
Publié le 09/04/2025
Extrait du document
«
Analyse linéaire n°10
Poème Le Mal
Introduction
Arthur Rimbaud connaît la guerre franco-prussienne de 1870 déclenchée par
Napoléon III.
Dans ce contexte tendu il exprime ses désirs d’émancipation à
travers plusieurs fugues .
Dans Le Mal, Rimbaud dénonce les horreurs de la
guerre dont il désigne les responsables : l’empereur et surtout, Dieu.
PDL : Comment la description de la guerre conduit elle à une dénonciation de la
religion et à un appel de libération de toutes les formes de pouvoir ?
Après avoir dressé un tableau pathétique des atrocités de la guerre, le jeune
poète offre une invocation à la nature, avant de présenter une satire religieuse.
I/
Un tableau pathétique des atrocités de la guerre (v.1-6)
a) L’horreur du combat
Le premier vers plonge le lecteur dans un univers de violence et de sang.
En
effet, la métaphore des “crachats rouges de la mitraille” peut évoquer le sang
craché par les soldats à l’agonie.
L’emploie du nom “crachat”, vulgaire et aux sonorités dures, dévalorise la
guerre.
Ce premier vers laisse également entendre une allitération en -r qui fait entendre
le chaos régnant sur le champs de bataille.
Rimbaud insiste sur le fait que les soldats n’ont aucun repos.
Il
utilise l’hyperbole “tout le jour” pour montrer que le combat ne faiblit à aucun
moment.
Pourtant, une couleur douce et rassurante subsiste, il s’agit de “l’infini du ciel
bleu”.
Ici, le poète prépare son évocation de la Nature divine et salvatrice.
Cependant, l’apaisement du bleu n’est que de courte durée puisque le rouge
revient, encore plus intense, au vers 3 avec l’adjectif “écarlates”.
On comprend
que la guerre efface la nature.
Au niveau des couleurs, le rouge est
omniprésent : “rouges” ; “écarlates” ; “feu”.
Il illustre la violence, le sang et le
mal en général + l’adjectif “verts” qui fait référence à la couleur de l’uniforme
des soldats prussiens (les français sont en rouge).
=> véritable description
artistique
Notons également que l’intensité du tableau est renforcée par le champ lexical de
la guerre : “crachats rouges ” ; “mitraille” ; “sifflent” ; “Roi” ; “bataillons” ; “feu”.
b) La critique du roi
La figure du “Roi” est vivement critiquée.
Cette autorité représente en fait
l’empereur Napoléon III, et plus généralement, toute figure de tyran.
On voit qu’il ne se soucie pas des pertes humaines, au contraire, il “raille” les
soldats.
Cela montre bien l’aversion de Rimbaud pour la guerre et les hommes au
pouvoir qu’il tient pour responsables.
Si le roi est mentionné de manière individuelle, ce n’est pas le cas des soldats qui
sont déshumanisés par leur nombre : ils sont des “bataillons”, “une masse” puis
“cent milliers d’hommes” et enfin un “tas fumant”.
Il est clair ici que le poète souligne le désintérêt du Roi pour ses soldats.
Ils ne
sont qu’un contingent informe, sacrifiable et remplaçable.
D’ailleurs, la métaphore filée du bucher, ou du brasier (“dans le feu” puis “tas
fumant”) suggère que les soldats ne tombent “en masse” que pour alimenter un
chaos de plus en plus grand et de plus en plus dévorant.
Ici, il ne semble pas y
avoir de vainqueur.
Le combat déborde dans la seconde strophe, comme s’il était impossible de le
contenir en seulement 4 vers.
Le groupe nominal “une folie épouvantable” peut désigner métaphoriquement la
guerre, voire la folie du roi qui mène son pays à la boucherie.
La force de l’adjectif “épouvantable” laisse transparaître la position du poète qui
se révèle profondément choqué par l’horreur de la guerre.
L’horreur est renforcée par l’utilisation du verbe broyer à la fin du vers 5.
Le tableau de la guerre se clôt par la mort des soldats, la transformation de “cent
milliers d’hommes” (hyperbole) en “un tas fumant” => parachève de
déshumaniser et dévaloriser les soldats qui ne sont plus qu’un amas de chair
meurtrie.
L’adjectif “fumant” peut faire penser à un tas de fumier, ultime
dévalorisation qui insiste sur la manière dont le roi voit son peuple.
II/
a)
Invocation à la nature (v.7-8)
Divinisation de la Nature
Après avoir exposé au lecteur le tableau terrible d’une guerre sale, Rimbaud
ouvre une fenêtre d’espoir lyrique, l’espace de seulement deux vers, qui
s’incarne sous les traits de la Nature.
Le tiret au début du vers indique le poète prend directement la parole.
Submergé
par l’horreur, il sombre dans le registre pathétique et le lyrisme.
La ponctuation expressive (3 points d’exclamation et les points....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Analyse linéaire Cyrano de Bergerac - La scène du balcon
- Analyse linéaire : le dernier feu Les vrilles de la vigne
- Baudelaire- Les fleurs du mal (analyse du reccueil) - 2
- Séquence 3 : Le Malade imaginaire de Molière. Analyse linéaire n°12 scène 10 acte III
- Lecture Linéaire N°11 Charles Baudelaire, Fleurs du Mal, Texte Intégral, « Tableaux parisiens » « Le Soleil »