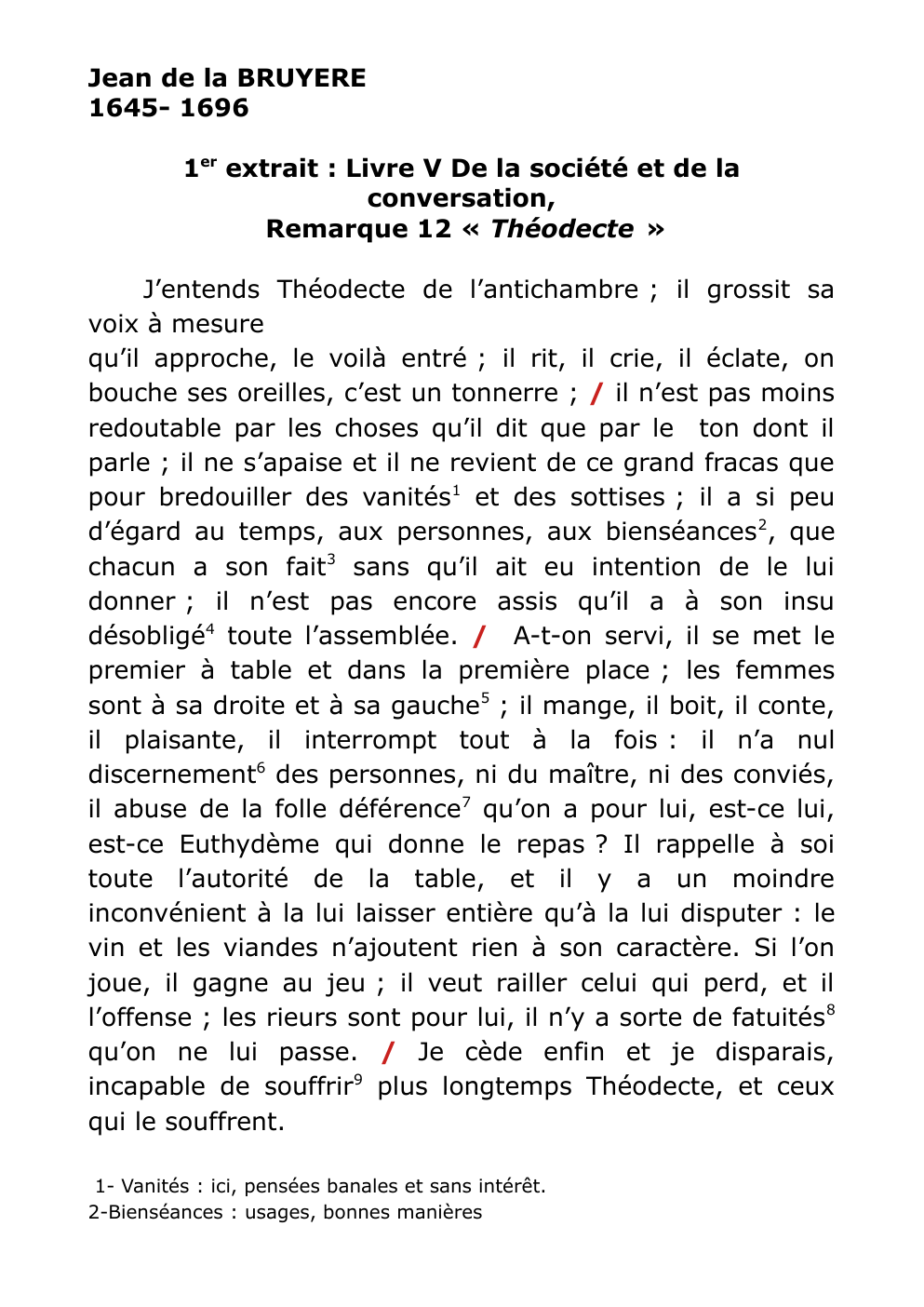Analyse linéaire Jean de la BRUYERE - Livre V De la société et de la conversation, Remarque 12 « Théodecte »
Publié le 23/03/2025
Extrait du document
«
Jean de la BRUYERE
1645- 1696
1er extrait : Livre V De la société et de la
conversation,
Remarque 12 « Théodecte »
J’entends Théodecte de l’antichambre ; il grossit sa
voix à mesure
qu’il approche, le voilà entré ; il rit, il crie, il éclate, on
bouche ses oreilles, c’est un tonnerre ; / il n’est pas moins
redoutable par les choses qu’il dit que par le ton dont il
parle ; il ne s’apaise et il ne revient de ce grand fracas que
pour bredouiller des vanités1 et des sottises ; il a si peu
d’égard au temps, aux personnes, aux bienséances 2, que
chacun a son fait3 sans qu’il ait eu intention de le lui
donner ; il n’est pas encore assis qu’il a à son insu
désobligé4 toute l’assemblée.
/ A-t-on servi, il se met le
premier à table et dans la première place ; les femmes
sont à sa droite et à sa gauche5 ; il mange, il boit, il conte,
il plaisante, il interrompt tout à la fois : il n’a nul
discernement6 des personnes, ni du maître, ni des conviés,
il abuse de la folle déférence7 qu’on a pour lui, est-ce lui,
est-ce Euthydème qui donne le repas ? Il rappelle à soi
toute l’autorité de la table, et il y a un moindre
inconvénient à la lui laisser entière qu’à la lui disputer : le
vin et les viandes n’ajoutent rien à son caractère.
Si l’on
joue, il gagne au jeu ; il veut railler celui qui perd, et il
l’offense ; les rieurs sont pour lui, il n’y a sorte de fatuités8
qu’on ne lui passe.
/ Je cède enfin et je disparais,
incapable de souffrir9 plus longtemps Théodecte, et ceux
qui le souffrent.
1- Vanités : ici, pensées banales et sans intérêt.
2-Bienséances : usages, bonnes manières
3456789-
Chacun a son fait : il blesse ou insulte chacun
Désobligé : Indisposé
A l’époque , l’étiquette codifie les repas
Discernement : compréhension
Déférence : grand respect,servilité
Fatuités : vantardises
souffrir : supporter
Introduction :
►Présentation de l’œuvre :
La Bruyère publie pour la première fois ses Caractères en 1688.
Le succès est immense et immédiat
et l'auteur n'aura de cesse d'amender, augmenter et rééditer son ouvrage.
Il s'agit pour lui, imitant
l'auteur antique Théophraste, de peindre la société de son temps sous la forme d'une série de «
remarques » (au sens littéral de « choses remarquables ») regroupées en seize livres.
Cette peinture
des caractères de son époque lui permet de dénoncer les faiblesses et les corruptions et en
contrepoint de définir l'honnête homme.
►Situation du passage :
La Bruyère consacre le livre V à l'une des préoccupations majeures du XVIIe siècle : comment
vivre avec autrui (« de la société ») et communiquer (« de la conversation ») ? L'« honnête homme
», idéal qui s'est substitué à celui du héros, se caractérise notamment par son aptitude à entretenir
des relations harmonieuses et agréables.
Mais le portrait de cet honnête homme se dessine le plus souvent en creux dans le chapitre.
Si
quelques remarques cherchent à identifier de façon abstraite les qualités qu'une parole juste
suppose, beaucoup analysent le dérèglement de la parole qui entrave toute véritable conversation.
Ces remarques préfigurent les portraits de Théodecte et d'Arrias, édités plus tardivement.
Théodecte (remarque 12) fait partie d'une constellation de personnages déplaisants bien éloignés
de l'honnête homme, comme Acis (7) ou Arrias (9) qui le précèdent de peu dans le livre.
Tous partagent la présomption d'avoir plus d'esprit que les autres et cherchent à imposer leur
parole.
Problématique :
Dans quelle mesure La Bruyère dépeint-il à travers ce portrait les mœurs de son temps ?
Plan en quatre mouvements :
l.1-3 : l’arrivée du personnage
l.3-8 : le personnage infatué se dessine alors même qu'il n'est pas encore assis
l.8-17 : à table et au jeu, il est tout aussi insupportable
l.17-18: sortie de scène du narrateur
Lecture linéaire :
► 1er mouvement : L 1-3 « J’entends …….
tonnerre ; »
- Récit d’une arrivée fracassante de Théodecte, en une seule phrase syncopée dans un style
fragmenté.
Théâtralisation de l’arrivée de Théodecte par son arrivée depuis les coulisses = « l’antichambre »
sur une scène fictive = salle de réception.
La Bruyère reprend ainsi le thème du theatrum mundi qui
fait le rapprochement entre le jeu théâtral et la vie en société.
Le procédé littéraire utilisé par l’auteur est une Juxtaposition de propositions (ponctuation : pointvirgules et virgules) créant ainsi une parataxe : figure de style disposant des propositions
syntaxiques sans rapport de dépendance marqué entre elles.
(contraire hypotaxe)
Cette figure de style est une des plus usitées par La Bruyère.
Dès l’irruption de ce personnage, le lecteur peut effectuer une projection visuelle du personnage et
comprendre l’omniprésence de Théodecte.
- On remarque dès ce premier mouvement le champ lexical du bruit appuyé par une assonance en (i)
« il rit, il crie » (ligne 2).
L’auteur crée un effet d’amplification sonore qui accompagne l’arrivée de
Théodecte qui « grossit » volontairement sa voix, « crie » « rit ».
Le procédé littéraire est une accumulation de verbes d’action, de prise de parole = gradation (figures
d’amplification renforcée par la répétition inutile du « il ») jusqu’à l’assertion (proposition que l’on
avance et que l’on soutient) finale hyperbolique.
« c’est un tonnerre ».
On note l’utilisation du
présentatif « c’est » qui renforce le groupe nominal « c’est un tonnerre ») (Un présentatif est un mot
ou une locution permettant d'introduire ou de mettre en relief un élément du discours).
L’arrivée de
Théodecte, de par tous les effets sonores, prend alors un côté comique renforcé par la gestuelle
exagérée « on bouche ses oreilles ».
Conclusion de mouvement : La théâtralisation de l’arrivée de Théodecte constitue un jugement
moral en soi.
On découvre un personnage infatué et égocentrique.
► 2e mouvement : L
l’assemblée ».
3-8 :
« Il n’est pas moins …..
toute
- Dès son arrivée, Théodecte adopte un comportement histrionique (caractérisé par une émotivité
excessive et une recherche d'attention).
Chacune des pointes verbales de La bruyère le discrédite un
peu plus.
Non seulement ce qu’il dit est sot, mais la façon dont il le dit est également insupportable.
L’auteur effectue une accumulation de propositions juxtaposées qui complètent le portrait.
« Il n’est pas moins redoutable par les choses qu’il dit que par le ton dont il parle » : avec ironie,
utilisation d’une tournure syntaxique négative : négation du contraire : 2 négations = une
affirmation.
De plus il effectue une mise en parallèle de deux éléments par la tournure : « par …..que par »
- On retrouve le champ lexical du bruit déjà présent dans le 1 er mouvement avec la métaphore du
« grand fracas ».
- L’auteur crée de plus une opposition entre le « fracas » et le fait de....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Analyse Linéaire : « Le rat et l’huître », Fables, Jean de La Fontaine
- Analyse linéaire Cyrano de Bergerac - La scène du balcon
- Analyse linéaire : le dernier feu Les vrilles de la vigne
- Séquence 3 : Le Malade imaginaire de Molière. Analyse linéaire n°12 scène 10 acte III
- Analyse linéaire la princesse de Clèves - Analyse linéaire L’apparition à la cour