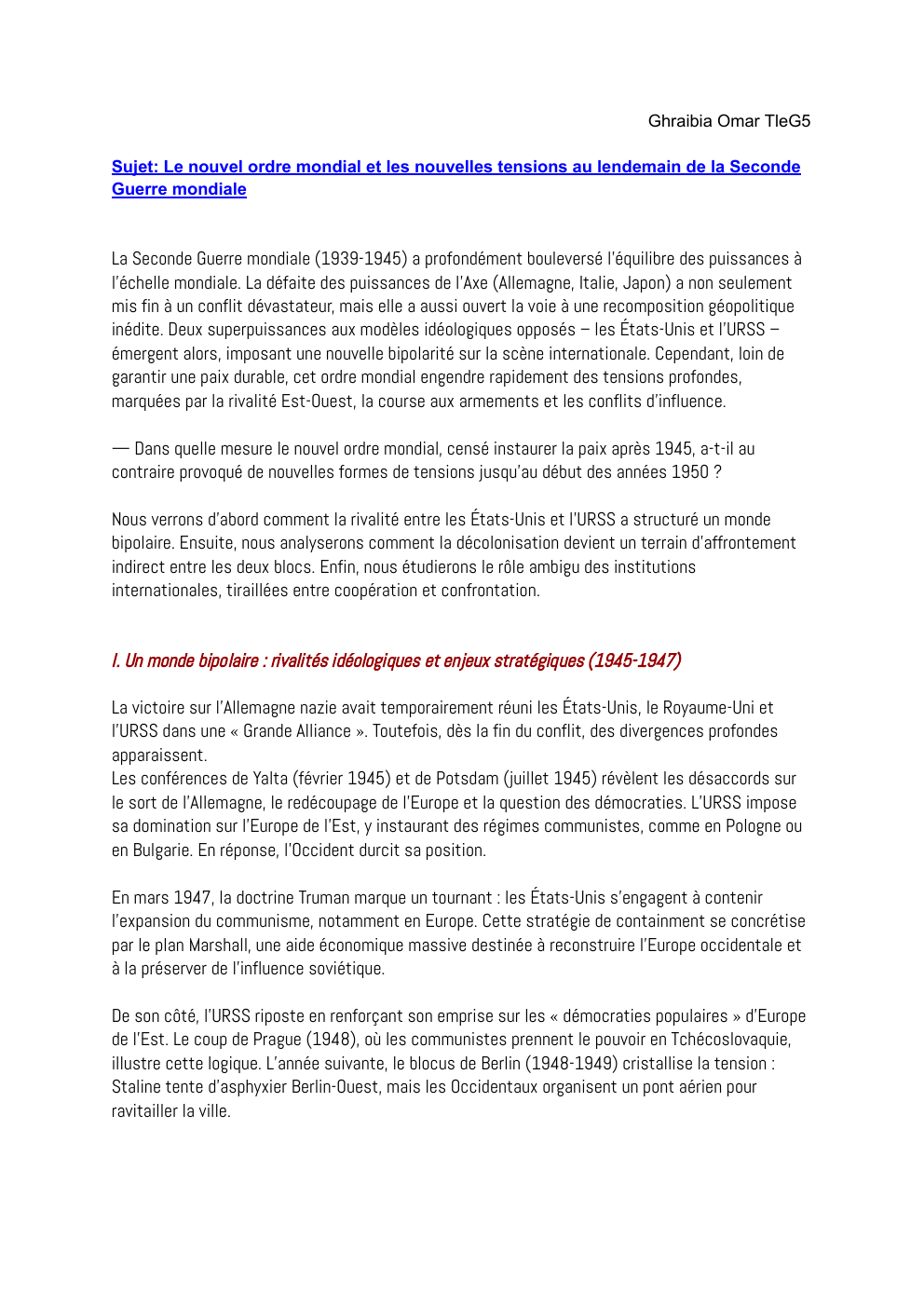Sujet: Le nouvel ordre mondial et les nouvelles tensions au lendemain de la Seconde Guerre mondiale
Publié le 12/04/2025
Extrait du document
«
Sujet: Le nouvel ordre mondial et les nouvelles tensions au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale
La Seconde Guerre mondiale (1939-1945) a profondément bouleversé l’équilibre des puissances à
l’échelle mondiale.
La défaite des puissances de l’Axe (Allemagne, Italie, Japon) a non seulement
mis fin à un conflit dévastateur, mais elle a aussi ouvert la voie à une recomposition géopolitique
inédite.
Deux superpuissances aux modèles idéologiques opposés – les États-Unis et l’URSS –
émergent alors, imposant une nouvelle bipolarité sur la scène internationale.
Cependant, loin de
garantir une paix durable, cet ordre mondial engendre rapidement des tensions profondes,
marquées par la rivalité Est-Ouest, la course aux armements et les conflits d’influence.
— Dans quelle mesure le nouvel ordre mondial, censé instaurer la paix après 1945, a-t-il au
contraire provoqué de nouvelles formes de tensions jusqu’au début des années 1950 ?
Nous verrons d’abord comment la rivalité entre les États-Unis et l’URSS a structuré un monde
bipolaire.
Ensuite, nous analyserons comment la décolonisation devient un terrain d’affrontement
indirect entre les deux blocs.
Enfin, nous étudierons le rôle ambigu des institutions
internationales, tiraillées entre coopération et confrontation.
I.
Un monde bipolaire : rivalités idéologiques et enjeux stratégiques (1945-1947)
La victoire sur l’Allemagne nazie avait temporairement réuni les États-Unis, le Royaume-Uni et
l’URSS dans une « Grande Alliance ».
Toutefois, dès la fin du conflit, des divergences profondes
apparaissent.
Les conférences de Yalta (février 1945) et de Potsdam (juillet 1945) révèlent les désaccords sur
le sort de l’Allemagne, le redécoupage de l’Europe et la question des démocraties.
L’URSS impose
sa domination sur l’Europe de l’Est, y instaurant des régimes communistes, comme en Pologne ou
en Bulgarie.
En réponse, l’Occident durcit sa position.
En mars 1947, la doctrine Truman marque un tournant : les États-Unis s’engagent à contenir
l’expansion du communisme, notamment en Europe.
Cette stratégie de containment se concrétise
par le plan Marshall, une aide économique massive destinée à reconstruire l’Europe occidentale et
à la préserver de l’influence soviétique.
De son côté, l’URSS riposte en renforçant son emprise sur les « démocraties populaires » d’Europe
de l’Est.
Le coup de Prague (1948), où les communistes prennent le pouvoir en Tchécoslovaquie,
illustre cette logique.
L’année suivante, le blocus de Berlin (1948-1949) cristallise la tension :
Staline tente d’asphyxier Berlin-Ouest, mais les Occidentaux organisent un pont aérien pour
ravitailler la ville.
Si les premières tensions apparaissent en Europe, la rivalité des blocs s’étend rapidement à
d’autres continents, notamment dans les territoires en voie de décolonisation.
II.
La décolonisation, un terrain d’affrontement indirect entre les deux blocs
La Seconde Guerre mondiale a affaibli les puissances coloniales européennes, et les peuples
colonisés aspirent de plus en plus à l’indépendance.
Cette vague de décolonisation devient un
enjeu stratégique pour les deux superpuissances, chacune cherchant à gagner l’influence dans le
Tiers-Monde.
Ainsi, dans la guerre d’Indochine (1946-1954), le mouvement indépendantiste Viêt Minh, dirigé par
Hô Chi Minh, bénéficie du soutien de l’URSS et de la Chine communiste, tandis que la France reçoit
l’appui des États-Unis.
Cette guerre, au départ coloniale, prend une dimension de guerre froide.
La crise de Suez en 1956, bien qu’un peu postérieure, illustre aussi le déclin....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Thème 1 Totalitarismes et Seconde Guerre mondiale (2)
- Fragilités des démocraties, totalitarismes et seconde guerre mondiale
- À LA RECHERCHE D·UN NOUVEL ORDRE MONDIAL DEPUIS LES ANNÉES 1970
- LA SECONDE GUERRE MONDIALE : PROJET VIDEO / PREPARATION GRAND ORAL
- SECONDE GUERRE MONDIALE : le génocide des juifs (1939-1945)