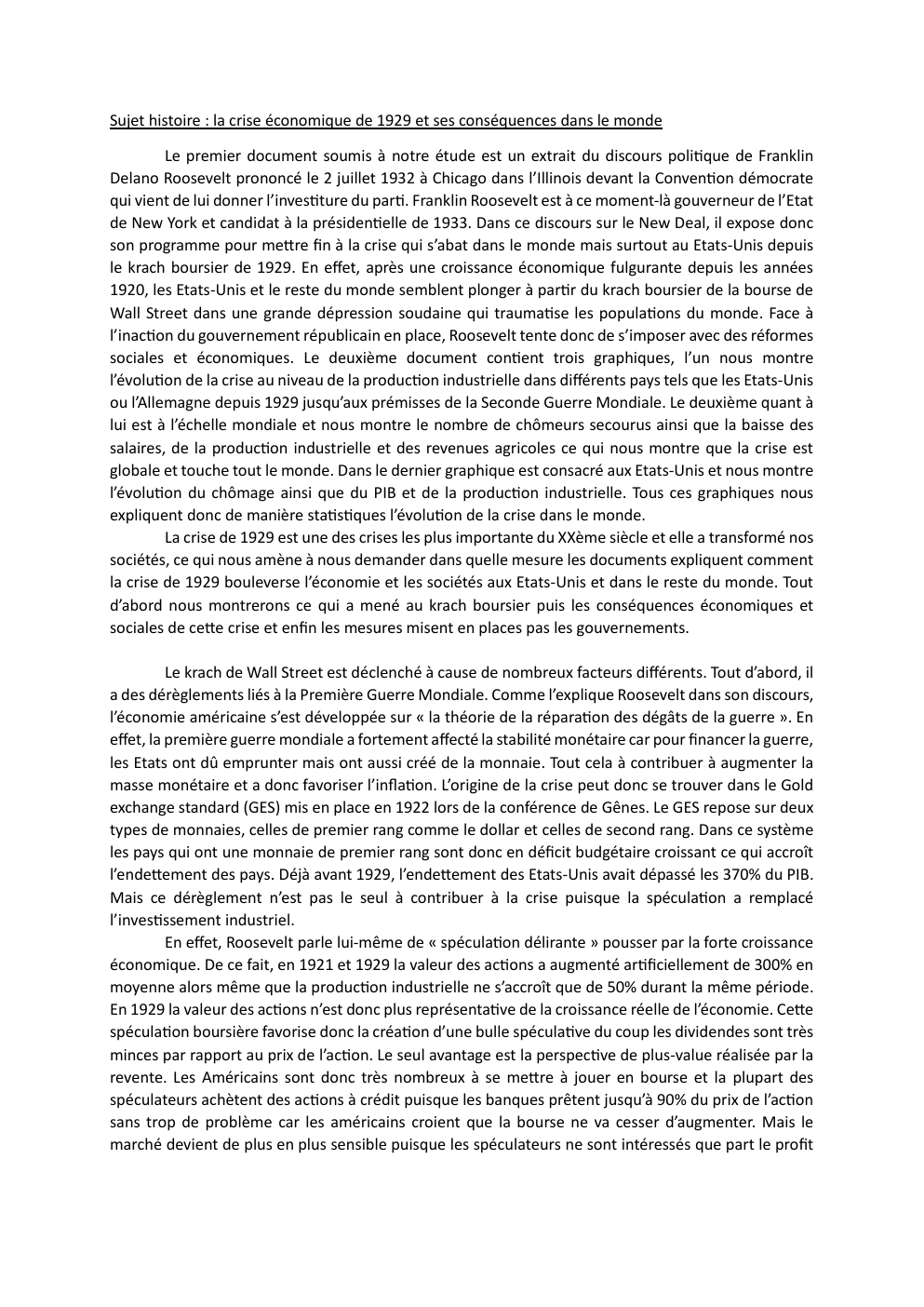Sujet histoire : la crise économique de 1929 et ses conséquences dans le monde
Publié le 21/12/2023
Extrait du document
«
Sujet histoire : la crise économique de 1929 et ses conséquences dans le monde
Le premier document soumis à notre étude est un extrait du discours politique de Franklin
Delano Roosevelt prononcé le 2 juillet 1932 à Chicago dans l’Illinois devant la Convention démocrate
qui vient de lui donner l’investiture du parti.
Franklin Roosevelt est à ce moment-là gouverneur de l’Etat
de New York et candidat à la présidentielle de 1933.
Dans ce discours sur le New Deal, il expose donc
son programme pour mettre fin à la crise qui s’abat dans le monde mais surtout au Etats-Unis depuis
le krach boursier de 1929.
En effet, après une croissance économique fulgurante depuis les années
1920, les Etats-Unis et le reste du monde semblent plonger à partir du krach boursier de la bourse de
Wall Street dans une grande dépression soudaine qui traumatise les populations du monde.
Face à
l’inaction du gouvernement républicain en place, Roosevelt tente donc de s’imposer avec des réformes
sociales et économiques.
Le deuxième document contient trois graphiques, l’un nous montre
l’évolution de la crise au niveau de la production industrielle dans différents pays tels que les Etats-Unis
ou l’Allemagne depuis 1929 jusqu’aux prémisses de la Seconde Guerre Mondiale.
Le deuxième quant à
lui est à l’échelle mondiale et nous montre le nombre de chômeurs secourus ainsi que la baisse des
salaires, de la production industrielle et des revenues agricoles ce qui nous montre que la crise est
globale et touche tout le monde.
Dans le dernier graphique est consacré aux Etats-Unis et nous montre
l’évolution du chômage ainsi que du PIB et de la production industrielle.
Tous ces graphiques nous
expliquent donc de manière statistiques l’évolution de la crise dans le monde.
La crise de 1929 est une des crises les plus importante du XXème siècle et elle a transformé nos
sociétés, ce qui nous amène à nous demander dans quelle mesure les documents expliquent comment
la crise de 1929 bouleverse l’économie et les sociétés aux Etats-Unis et dans le reste du monde.
Tout
d’abord nous montrerons ce qui a mené au krach boursier puis les conséquences économiques et
sociales de cette crise et enfin les mesures misent en places pas les gouvernements.
Le krach de Wall Street est déclenché à cause de nombreux facteurs différents.
Tout d’abord, il
a des dérèglements liés à la Première Guerre Mondiale.
Comme l’explique Roosevelt dans son discours,
l’économie américaine s’est développée sur « la théorie de la réparation des dégâts de la guerre ».
En
effet, la première guerre mondiale a fortement affecté la stabilité monétaire car pour financer la guerre,
les Etats ont dû emprunter mais ont aussi créé de la monnaie.
Tout cela à contribuer à augmenter la
masse monétaire et a donc favoriser l’inflation.
L’origine de la crise peut donc se trouver dans le Gold
exchange standard (GES) mis en place en 1922 lors de la conférence de Gênes.
Le GES repose sur deux
types de monnaies, celles de premier rang comme le dollar et celles de second rang.
Dans ce système
les pays qui ont une monnaie de premier rang sont donc en déficit budgétaire croissant ce qui accroît
l’endettement des pays.
Déjà avant 1929, l’endettement des Etats-Unis avait dépassé les 370% du PIB.
Mais ce dérèglement n’est pas le seul à contribuer à la crise puisque la spéculation a remplacé
l’investissement industriel.
En effet, Roosevelt parle lui-même de « spéculation délirante » pousser par la forte croissance
économique.
De ce fait, en 1921 et 1929 la valeur des actions a augmenté artificiellement de 300% en
moyenne alors même que la production industrielle ne s’accroît que de 50% durant la même période.
En 1929 la valeur des actions n’est donc plus représentative de la croissance réelle de l’économie.
Cette
spéculation boursière favorise donc la création d’une bulle spéculative du coup les dividendes sont très
minces par rapport au prix de l’action.
Le seul avantage est la perspective de plus-value réalisée par la
revente.
Les Américains sont donc très nombreux à se mettre à jouer en bourse et la plupart des
spéculateurs achètent des actions à crédit puisque les banques prêtent jusqu’à 90% du prix de l’action
sans trop de problème car les américains croient que la bourse ne va cesser d’augmenter.
Mais le
marché devient de plus en plus sensible puisque les spéculateurs ne sont intéressés que part le profit
à court terme.
Dès le moindre frémissement tout le monde cherche à vendre ce qui explique donc que
les actions ont perdu autant de valeur entre octobre et novembre 1929.
Une dernière raison explique ce krach boursier et c’est la sous consommation des Américains.
Roosevelt l’exprime dans son discours « nous nous développâmes en vérité bien au-delà de cela, et
aussi au-delà de notre croissance naturelle et normale.
».
Roosevelt à raison sur ce point puisqu’en
1929, les Américains consomment moins, on compte une voiture pour 5 habitants 1928 ce qui veut
dire que les personnes ayant les moyens de s’acheter une voiture l’ont fait et donc la demande baisse,
ce qui entraine une diminution de la production industrielle que chute de 7% entre mars et octobre
1929 et continue de chuter comme on le voit dans le graphique 1.
De plus l’accumulation des stocks
invendus provoquent une baisse générale des prix.
Les entreprises font donc moins de profits ce qui
entraîne une baisse du cours des actions qui accélère les ventes massives du 24 octobre 1929.
La bulle
spéculative éclate et provoque donc le krach boursier de Wall Street.
La crise de 1929 est donc causée par de nombreux facteurs et impact toute l’économie et les
populations des pays.
Les conséquences de krach boursier ne sont pas moindres et impact fortement les pays à
différentes échelles.
Cette crise est donc tout d’abord une crise bancaire et financière.
En effet, les
effets de cette crise sont immédiats sur l’ensemble de l’économie.
Comme le dit Roosevelt « les
banques s’effrayèrent et commencèrent à rappeler leurs prêts », c’est-à-dire que les prêteurs réclament
donc l’argent prêté aux débiteurs qui ne peuvent plus rembourser.
De plus, les Américains rapatrient
leurs capitaux investis à l’étranger notamment ceux de l’Autriche et l’Allemagne.
Les Etats-Unis étant
les principaux créanciers du monde avec plus de 1O milliards de dollars investis ou prêtés à l’étranger
en 1929, le rapatriement des capitaux met donc en difficulté les économies de nombreux pays et donc
comme aux Etats-Unis de nombreuses banques font faillite, par exemple le Kreditanstalt qui est la plus
grande banque autrichienne et qui détient la moitié de l’industrie nationale.
La faillite de ces banques
et la limitation des crédits par les Etats-Unis contribuent donc à diffuser la crise dans le monde entier
et en Europe.
Ensuite la crise s’étend à l’industrie comme nous le montre les graphiques ainsi que Roosevelt
« L’industrie se stoppa.
Le commerce déclina ».
La crise industrielle n’est qu’une conséquence de la
crise bancaire puisque les particuliers et entreprises consomment moins.
Cela se vérifie d’autant plus
que la confiance est ébranlée.
Les investissements des entreprises baissent 35% en 1930 par rapport à
1929 et finissent par cesser en 1932.
De plus on voit dans le graphique 1 que la valeur de la production
industrielle s’effondre puisque pour un indice 100 en 1929, on tombe à 55 pour les Etats-Unis en 1932
et en Allemagne, en France à 72 et au Royaume-Uni à 84.
La déflation est également présente dans
cette crise puisqu’on remarque moins 30% pour les produits industriels et moins 50% pour les produits....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Crise de 1929 et ses conséquences
- « La seule idée qu'apporte la philosophie est la simple idée de la Raison, l'idée que la Raison gouverne le monde et que, par conséquent, l'histoire universelle s'est elle aussi déroulée rationnellement. » Hegel, La Raison dans l'histoire, 1837. Commente
- Un penseur contemporain a écrit : « l'Histoire justifie ce que l'on veut. Elfe n'enseigne rigoureusement rien, car elle contient tout et elle donne des exemples de tout. » (Paul Valéry, « Regards sur le monde actuel »). Ce scepticisme touchant la portée
- Pour Camus, l’absurde est le sentiment qui « naît de cette confrontation entre l’appel humain et le silence déraisonnable du monde.»
- « Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n’en lisent qu’une page » AUGUSTIN D’HIPPONE