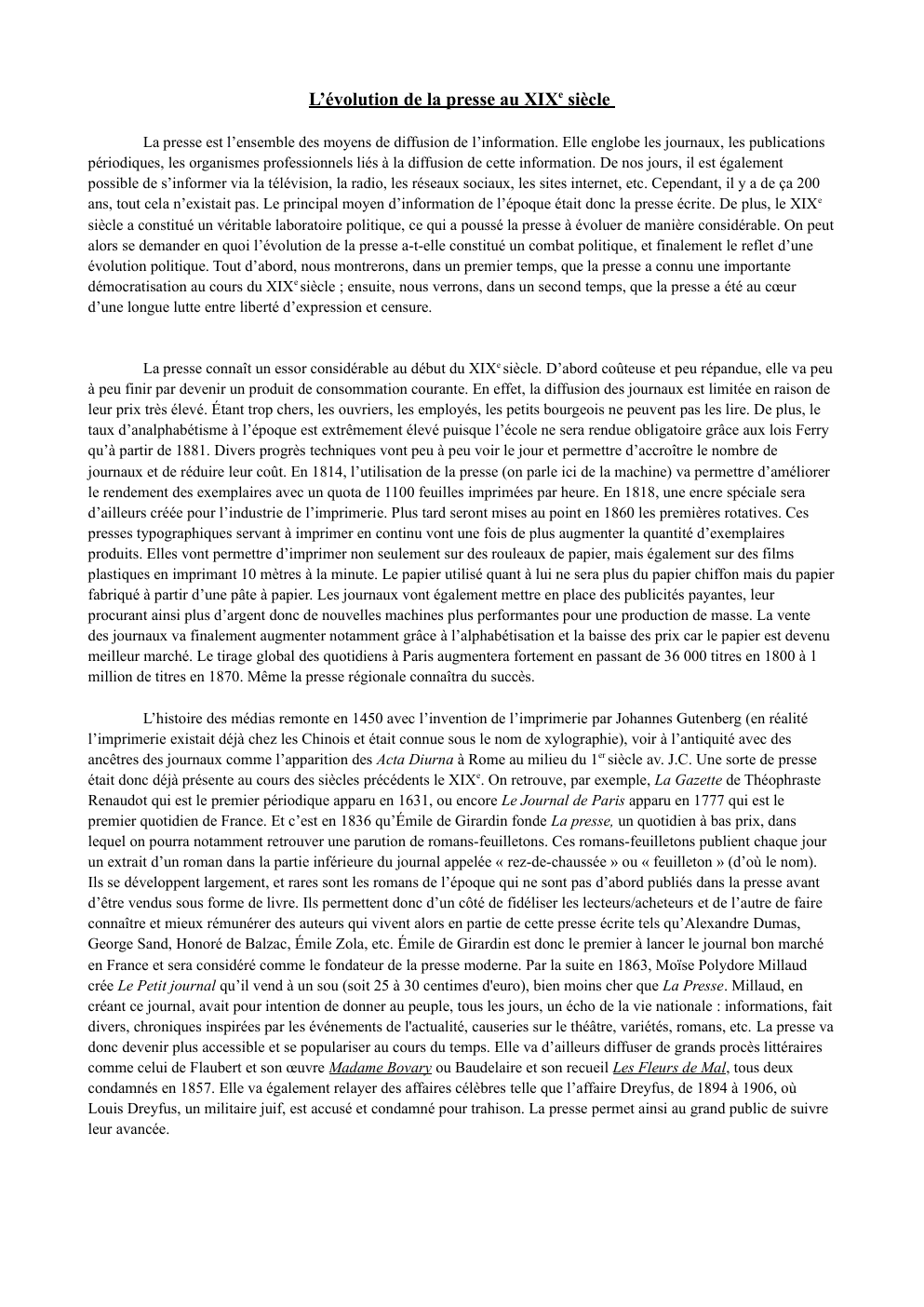L'évolution de la presse au XIXe siècle
Publié le 21/05/2023
Extrait du document
«
L’évolution de la presse au XIXe siècle
La presse est l’ensemble des moyens de diffusion de l’information.
Elle englobe les journaux, les publications
périodiques, les organismes professionnels liés à la diffusion de cette information.
De nos jours, il est également
possible de s’informer via la télévision, la radio, les réseaux sociaux, les sites internet, etc.
Cependant, il y a de ça 200
ans, tout cela n’existait pas.
Le principal moyen d’information de l’époque était donc la presse écrite.
De plus, le XIX e
siècle a constitué un véritable laboratoire politique, ce qui a poussé la presse à évoluer de manière considérable.
On peut
alors se demander en quoi l’évolution de la presse a-t-elle constitué un combat politique, et finalement le reflet d’une
évolution politique.
Tout d’abord, nous montrerons, dans un premier temps, que la presse a connu une importante
démocratisation au cours du XIXe siècle ; ensuite, nous verrons, dans un second temps, que la presse a été au cœur
d’une longue lutte entre liberté d’expression et censure.
La presse connaît un essor considérable au début du XIXe siècle.
D’abord coûteuse et peu répandue, elle va peu
à peu finir par devenir un produit de consommation courante.
En effet, la diffusion des journaux est limitée en raison de
leur prix très élevé.
Étant trop chers, les ouvriers, les employés, les petits bourgeois ne peuvent pas les lire.
De plus, le
taux d’analphabétisme à l’époque est extrêmement élevé puisque l’école ne sera rendue obligatoire grâce aux lois Ferry
qu’à partir de 1881.
Divers progrès techniques vont peu à peu voir le jour et permettre d’accroître le nombre de
journaux et de réduire leur coût.
En 1814, l’utilisation de la presse (on parle ici de la machine) va permettre d’améliorer
le rendement des exemplaires avec un quota de 1100 feuilles imprimées par heure.
En 1818, une encre spéciale sera
d’ailleurs créée pour l’industrie de l’imprimerie.
Plus tard seront mises au point en 1860 les premières rotatives.
Ces
presses typographiques servant à imprimer en continu vont une fois de plus augmenter la quantité d’exemplaires
produits.
Elles vont permettre d’imprimer non seulement sur des rouleaux de papier, mais également sur des films
plastiques en imprimant 10 mètres à la minute.
Le papier utilisé quant à lui ne sera plus du papier chiffon mais du papier
fabriqué à partir d’une pâte à papier.
Les journaux vont également mettre en place des publicités payantes, leur
procurant ainsi plus d’argent donc de nouvelles machines plus performantes pour une production de masse.
La vente
des journaux va finalement augmenter notamment grâce à l’alphabétisation et la baisse des prix car le papier est devenu
meilleur marché.
Le tirage global des quotidiens à Paris augmentera fortement en passant de 36 000 titres en 1800 à 1
million de titres en 1870.
Même la presse régionale connaîtra du succès.
L’histoire des médias remonte en 1450 avec l’invention de l’imprimerie par Johannes Gutenberg (en réalité
l’imprimerie existait déjà chez les Chinois et était connue sous le nom de xylographie), voir à l’antiquité avec des
ancêtres des journaux comme l’apparition des Acta Diurna à Rome au milieu du 1er siècle av.
J.C.
Une sorte de presse
était donc déjà présente au cours des siècles précédents le XIXe.
On retrouve, par exemple, La Gazette de Théophraste
Renaudot qui est le premier périodique apparu en 1631, ou encore Le Journal de Paris apparu en 1777 qui est le
premier quotidien de France.
Et c’est en 1836 qu’Émile de Girardin fonde La presse, un quotidien à bas prix, dans
lequel on pourra notamment retrouver une parution de romans-feuilletons.
Ces romans-feuilletons publient chaque jour
un extrait d’un roman dans la partie inférieure du journal appelée « rez-de-chaussée » ou « feuilleton » (d’où le nom).
Ils se développent largement, et rares sont les romans de l’époque qui ne sont pas d’abord publiés dans la presse avant
d’être vendus sous forme de livre.
Ils permettent donc d’un côté de fidéliser les lecteurs/acheteurs et de l’autre de faire
connaître et mieux rémunérer des auteurs qui vivent alors en partie de cette presse écrite tels qu’Alexandre Dumas,
George Sand, Honoré de Balzac, Émile Zola, etc.
Émile de Girardin est donc le premier à lancer le journal bon marché
en France et sera considéré comme le fondateur de la presse moderne.
Par la suite en 1863, Moïse Polydore Millaud
crée Le Petit journal qu’il vend à un sou (soit 25 à 30 centimes d'euro), bien moins cher que La Presse.
Millaud, en
créant ce journal, avait pour intention de donner au peuple, tous les jours, un écho de la vie nationale : informations, fait
divers, chroniques inspirées par les événements de l'actualité, causeries sur le théâtre, variétés, romans, etc.
La presse va
donc devenir plus accessible et se populariser au cours du temps.
Elle va d’ailleurs diffuser de grands procès littéraires
comme celui de Flaubert et son œuvre Madame Bovary ou Baudelaire et son recueil Les Fleurs de Mal, tous deux
condamnés en 1857.
Elle va également relayer des affaires célèbres telle que l’affaire Dreyfus, de 1894 à 1906, où
Louis Dreyfus, un militaire juif, est accusé et condamné pour trahison.
La presse permet ainsi au grand public de suivre
leur avancée.
La presse devient, au XIXe siècle, un contre-pouvoir politique de plus en plus puissant en France, malgré une
certaine censure encore présente.
Avant la Révolution française, il n'y avait pas de politique dans les journaux car toute
allusion, quelle qu’elle soit, pouvait entraîner une amende.
Et s'il y avait récidive, c'était l'interdiction.
La longue
transition démocratique, de la monarchie absolue, en passant par l’empire, jusqu’à la république, que la France connaît
au cours du XIXe siècle, fait de la presse le principal vecteur d’information et de la parole publique.
La censure
représente donc une arme contre celle-ci.
C’est à partir de 1789 que l’on observe une floraison de multiples journaux
durant 3 ans, le peuple s’étant emparé de la liberté d’expression.
La censure disparaît temporairement avec le roi
dépossédé de ses prérogatives.
La Révolution libère la parole....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L’expansion des idées libérales au XIXe siècle
- Tendances générales du XIXe siècle
- LE XIXe SIÈCLE EN PHILOSOPHIE
- En conclusion d'un article sur « Dom Juan » de Molière un critique du XIXe siècle écrit : « C'est une oeuvre de polémique dans laquelle je me refuse à trouver une profession d'athéisme... mais le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle n'est pas chrétienne
- Commentez ce jugement de Renan sur le XIXe siècle et notamment sur la poésie romantique : « On mêlait trop la poésie à la réalité. La poésie est faite pour nous dépayser, pour nous consoler de la vie par le rêve, non pour déteindre sur la vie. » (Feuille