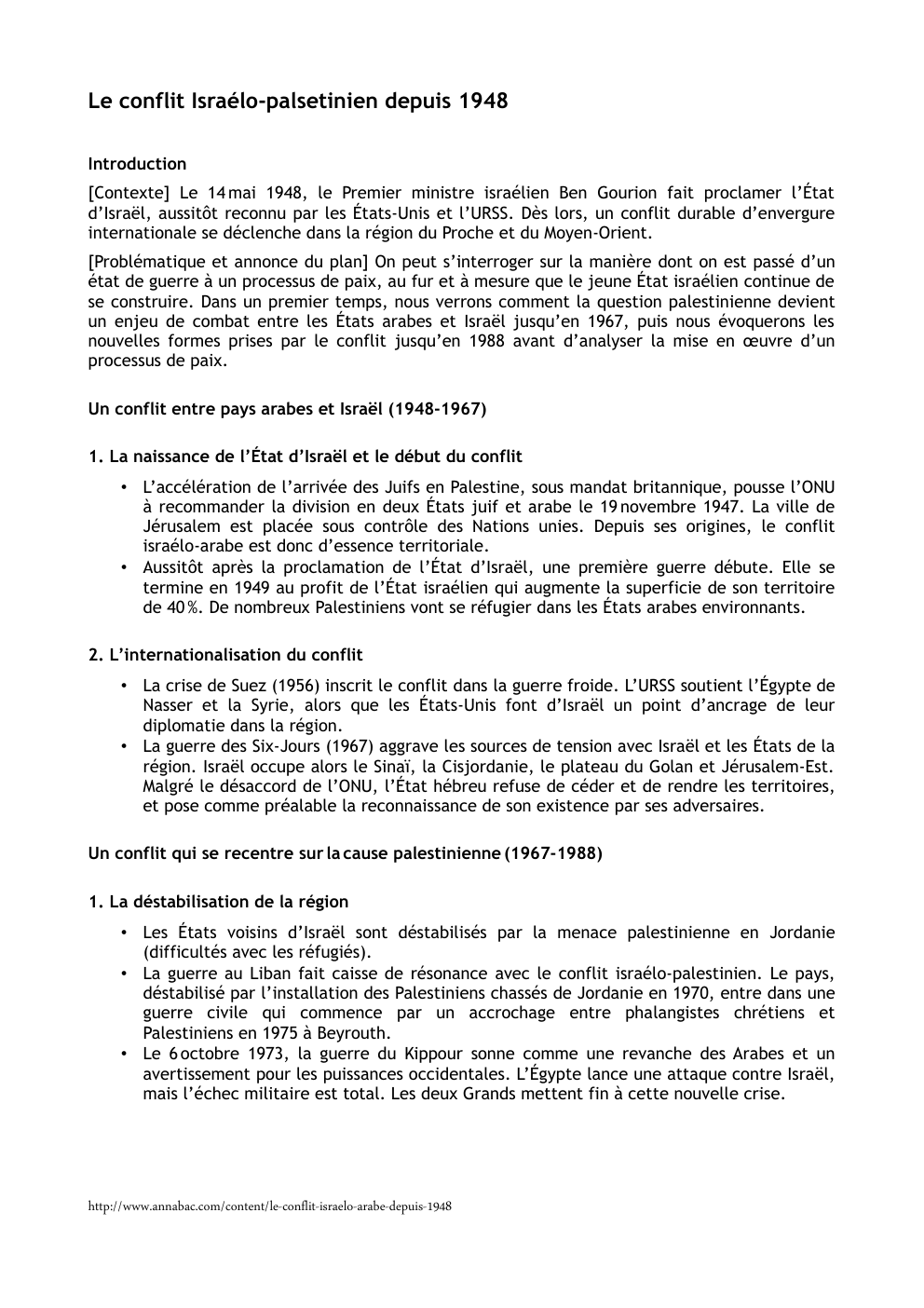Le conflit Israélo-palsetinien depuis 1948
Publié le 29/05/2023
Extrait du document
«
Le conflit Israélo-palsetinien depuis 1948
Introduction
[Contexte] Le 14 mai 1948, le Premier ministre israélien Ben Gourion fait proclamer l’État
d’Israël, aussitôt reconnu par les États-Unis et l’URSS.
Dès lors, un conflit durable d’envergure
internationale se déclenche dans la région du Proche et du Moyen-Orient.
[Problématique et annonce du plan] On peut s’interroger sur la manière dont on est passé d’un
état de guerre à un processus de paix, au fur et à mesure que le jeune État israélien continue de
se construire.
Dans un premier temps, nous verrons comment la question palestinienne devient
un enjeu de combat entre les États arabes et Israël jusqu’en 1967, puis nous évoquerons les
nouvelles formes prises par le conflit jusqu’en 1988 avant d’analyser la mise en œuvre d’un
processus de paix.
Un conflit entre pays arabes et Israël (1948-1967)
1.
La naissance de l’État d’Israël et le début du conflit
• L’accélération de l’arrivée des Juifs en Palestine, sous mandat britannique, pousse l’ONU
à recommander la division en deux États juif et arabe le 19 novembre 1947.
La ville de
Jérusalem est placée sous contrôle des Nations unies.
Depuis ses origines, le conflit
israélo-arabe est donc d’essence territoriale.
• Aussitôt après la proclamation de l’État d’Israël, une première guerre débute.
Elle se
termine en 1949 au profit de l’État israélien qui augmente la superficie de son territoire
de 40 %.
De nombreux Palestiniens vont se réfugier dans les États arabes environnants.
2.
L’internationalisation du conflit
• La crise de Suez (1956) inscrit le conflit dans la guerre froide.
L’URSS soutient l’Égypte de
Nasser et la Syrie, alors que les États-Unis font d’Israël un point d’ancrage de leur
diplomatie dans la région.
• La guerre des Six-Jours (1967) aggrave les sources de tension avec Israël et les États de la
région.
Israël occupe alors le Sinaï, la Cisjordanie, le plateau du Golan et Jérusalem-Est.
Malgré le désaccord de l’ONU, l’État hébreu refuse de céder et de rendre les territoires,
et pose comme préalable la reconnaissance de son existence par ses adversaires.
Un conflit qui se recentre sur la cause palestinienne (1967-1988)
1.
La déstabilisation de la région
• Les États voisins d’Israël sont déstabilisés par la menace palestinienne en Jordanie
(difficultés avec les réfugiés).
• La guerre au Liban fait caisse de résonance avec le conflit israélo-palestinien.
Le pays,
déstabilisé par l’installation des Palestiniens chassés de Jordanie en 1970, entre dans une
guerre civile qui commence par un accrochage entre phalangistes chrétiens et
Palestiniens en 1975 à Beyrouth.
• Le 6 octobre 1973, la guerre du Kippour sonne comme une revanche des Arabes et un
avertissement pour les puissances occidentales.
L’Égypte lance une attaque contre Israël,
mais l’échec militaire est total.
Les deux Grands mettent fin à cette nouvelle crise.
http://www.annabac.com/content/le-conflit-israelo-arabe-depuis-1948
Le conflit Israélo-palsetinien depuis 1948
2.
La difficile affirmation de l’OLP
• Yasser Arafat prend la direction de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) en
1969.
Il est à la tête d’une organisation qui se fixe comme objectif la destruction d’Israël
(charte de 1964).
En 1974, l’OLP accède à un siège d’observateur à l’Assemblée de
l’ONU.
Les Palestiniens entament alors une guerre d’un type nouveau : actions terroristes,
lutte contre les Israéliens dans les territoires....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Kant: Le conflit met-il en danger la société ?
- Peut-on parler de conflit entre la raison et la passion ?
- ENGELS: «Comme l'État est né du besoin de réfréner des oppositions de classes, mais comme il est né, en même temps, au milieu du conflit de ces classes, il est, dans la règle, l'État de la classe la plus puissante.»
- Une société juste est-ce une société sans conflit ?
- Le conflit est il au fondement de tout rapport avec autrui ?