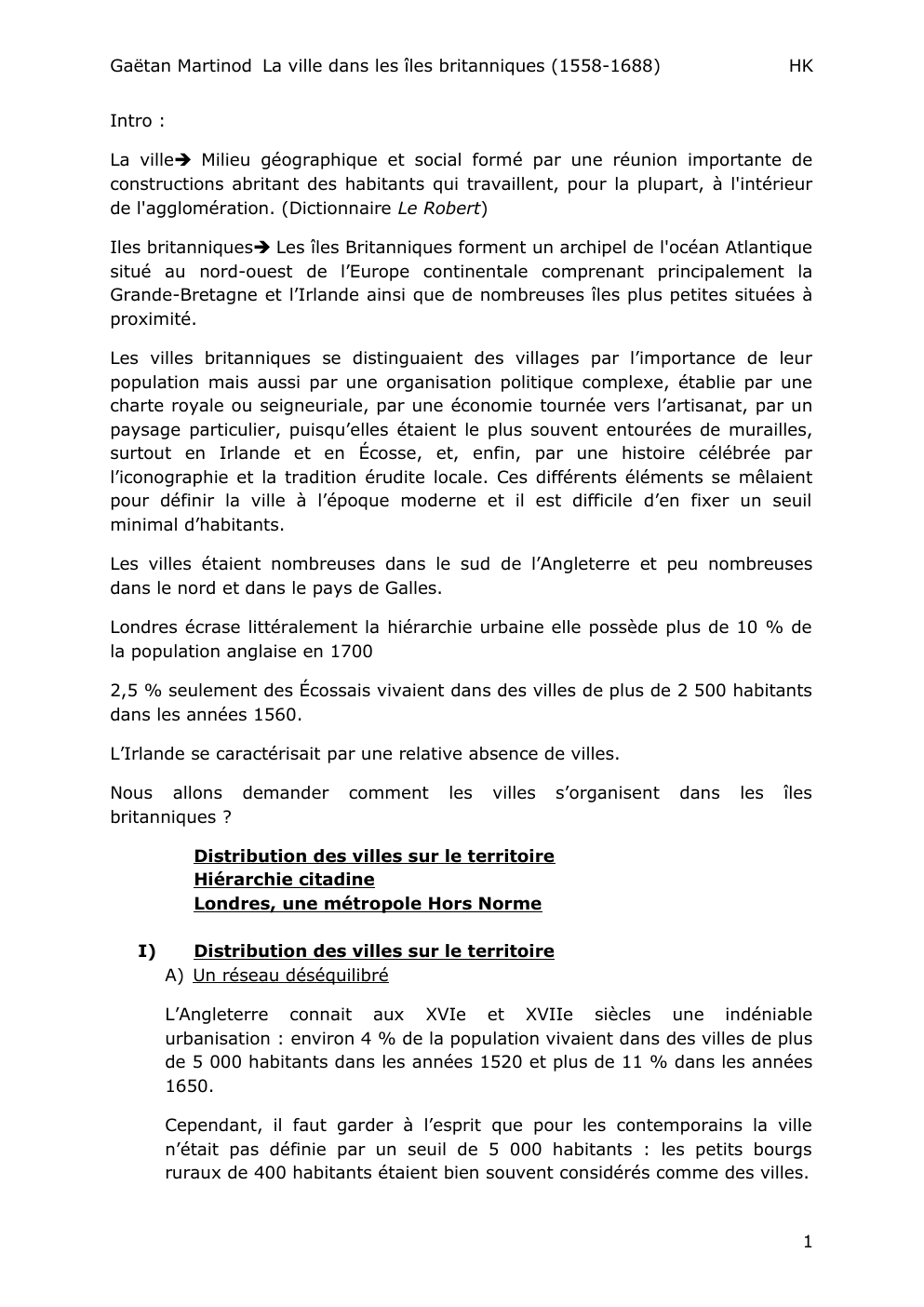La ville dans les îles britanniques (1558-1688)
Publié le 16/10/2023
Extrait du document
«
Gaëtan Martinod La ville dans les îles britanniques (1558-1688)
HK
Intro :
La ville Milieu géographique et social formé par une réunion importante de
constructions abritant des habitants qui travaillent, pour la plupart, à l'intérieur
de l'agglomération.
(Dictionnaire Le Robert)
Iles britanniques Les îles Britanniques forment un archipel de l'océan Atlantique
situé au nord-ouest de l’Europe continentale comprenant principalement la
Grande-Bretagne et l’Irlande ainsi que de nombreuses îles plus petites situées à
proximité.
Les villes britanniques se distinguaient des villages par l’importance de leur
population mais aussi par une organisation politique complexe, établie par une
charte royale ou seigneuriale, par une économie tournée vers l’artisanat, par un
paysage particulier, puisqu’elles étaient le plus souvent entourées de murailles,
surtout en Irlande et en Écosse, et, enfin, par une histoire célébrée par
l’iconographie et la tradition érudite locale.
Ces différents éléments se mêlaient
pour définir la ville à l’époque moderne et il est difficile d’en fixer un seuil
minimal d’habitants.
Les villes étaient nombreuses dans le sud de l’Angleterre et peu nombreuses
dans le nord et dans le pays de Galles.
Londres écrase littéralement la hiérarchie urbaine elle possède plus de 10 % de
la population anglaise en 1700
2,5 % seulement des Écossais vivaient dans des villes de plus de 2 500 habitants
dans les années 1560.
L’Irlande se caractérisait par une relative absence de villes.
Nous allons demander
britanniques ?
comment
les
villes
s’organisent
dans
les
îles
Distribution des villes sur le territoire
Hiérarchie citadine
Londres, une métropole Hors Norme
I)
Distribution des villes sur le territoire
A) Un réseau déséquilibré
L’Angleterre connait aux XVIe et XVIIe siècles une indéniable
urbanisation : environ 4 % de la population vivaient dans des villes de plus
de 5 000 habitants dans les années 1520 et plus de 11 % dans les années
1650.
Cependant, il faut garder à l’esprit que pour les contemporains la ville
n’était pas définie par un seuil de 5 000 habitants : les petits bourgs
ruraux de 400 habitants étaient bien souvent considérés comme des villes.
1
Gaëtan Martinod La ville dans les îles britanniques (1558-1688)
HK
À la fin du XVIIe siècle, plus de 90 % des 1 000 premières villes du
royaume comptaient moins de 2 500 habitants.
Londres écrase littéralement la hiérarchie urbaine anglaise.
Quelques
capitales provinciales, dont Norwich, Bristol, Exeter, York et Newcastle,
rayonnent sur les provinces anglaises les plus éloignées de Londres.
Elles
sont de taille modeste à l’échelle européenne puisque si elles dépassent
10 000 habitants, elles atteignent rarement les 20 000.
En Ecosse, la majeure partie des villes se concentre à l’est.
Vers 1700,
Édimbourg qui, avec son port (Leith), abritait environ 35 000 habitants, et
Glasgow avec 17 000 habitants étaient les plus grandes agglomérations du
royaume.
Aberdeen et Dundee, les capitales du Nord, étaient les deux
seules villes qui comptaient entre 5 000 et 10 000 habitants.
L’Irlande se
caractérisait par une relative absence de villes.
Les plus grandes se
trouvaient sur les côtes comme Dublin, Cork, Limerick et Waterford ;
Kilkenny.
La colonisation anglaise au cours du XVII siècle a entraîné la
création administrative de nombreuses villes mais leur population est
demeurée très faible.
À la fin du XVII siècle, Cork ne comptait que 20 000
habitants et Limerick et Waterford ne dépassaient pas 5 000 habitants.
2
Gaëtan Martinod La ville dans les îles britanniques (1558-1688)
HK
B) Villes comtales (county towns) et villes-marchés (market towns)
Une centaine de villes comtales oscillaient entre 1 500 et 10 000 habitants.
Entourées de murailles qui les séparaient nettement du plat pays, elles
hébergeaient une ou plusieurs administrations locales tels l’évêché, la
commission des juges de paix ou la cour du sheriff, et accueillaient
plusieurs marchés hebdomadaires et des foires annuelles.
À Winchester,
un marché se tenait chaque semaine dans la grand-rue, et sur une place
près de la cathédrale, une maison abritait les poids et les mesures de la
ville ainsi que la cloche qui annonçait l’ouverture du marché et des deux
foires annuelles.
Une structure économique et sociale complexe favorisait
la domination de ces villes comtales sur les villes-marchés et les
3
Gaëtan Martinod La ville dans les îles britanniques (1558-1688)
HK
campagnes des alentours : les marchands de Worcester organisaient ainsi
une partie de la production textile du West Country ; des villes comme
Canterbury, Maidstone ou Faversham dans le Kent recrutaient leurs
apprentis dans une zone rurale de 11 miles autour d’elles.
Certaines villes se développent grâce à l’industrie du textile ou de la
métallurgie.
La base de la hiérarchie urbaine anglaise et galloise était constituée par un
réseau, plus ou moins dense selon les comtés, de villes-marchés ; selon
les estimations, leur nombre oscillait entre 600 et 800 aux XVIe et XVIIe
siècles.
Ces villes étaient organisées autour d’un marché hebdomadaire qui
se tenait, par exemple, tous les jeudis à Dorking (Sussex) avec, en plus,
une foire annuelle le jour de l’Ascension.
Elles se différenciaient des
villages des environs à la fois par une topographie spécifiquement urbaine
ainsi que par la présence de boutiques permanentes et d’une assez grande
variété d’artisans.
À la fin du XVIe siècle, les plus importantes d’entre elles
commencèrent à se spécialiser autour d’un ou plusieurs produits agricoles
qu’elles diffusaient à l’échelle régionale, voire nationale : Farnham
(Surrey), qui comptait seulement 1 400 habitants en 1664, fut ainsi un des
principaux marchés céréaliers où s’approvisionnaient les marchands
londoniens.
À la fin de la période, les villes-marchés et les villes comtales réunirent la
majorité de la population urbaine (54 % en 1700) suite à la décélération
de la croissance urbaine londonienne après 1650.
II)
Hiérarchie citadine
A) Statuts et discours
Les contemporains avaient bien des difficultés à apprécier la diversité des
sociétés urbaines et à reconnaître la particularité de ses élites urbaines.
Ainsi William Harrison dans The Description of England (1577) élaborait de
subtiles nuances au sein des élites foncières (county, parish gentry,
esquire), mais regroupait 90 % des individus restants sous l’expression de
commoners.
Mais parallèlement à ces traités qui insistent sur l’importance
des statuts, des rangs et des honneurs hérités de la période médiévale, les
contemporains utilisent des expressions plus directement liées à la position
économique et professionnelle des individus.
Ainsi, on assiste à partir de la
période élisabéthaine, à l’émergence d’une distinction tripartite mal définie
entre les lower sort, middling sort, richer sort.
Cette nouvelle taxinomie se
renforça pendant la première révolution et témoignent des nouvelles
dynamiques sociales générées par l’inflation, les migrations et l’essor des
villes.
Le langage autour des sorts s’inscrit dans une perspective morale et
géographique.
Les lower sort étaient aussi associés aux qualificatifs
4
Gaëtan Martinod La ville dans les îles britanniques (1558-1688)
HK
d’ordinaire, de vulgaire d’ignorant.
Suspectés de circuler d’une paroisse à
une autre en quête de charité, ils étaient suspectés de duplicité et de
rouerie.
Inversement, les middle sort étaient liées à une communauté bien
définie, dans le cadre d’une ville ou d’un comté.
Ainsi lors des
affrontements militaires des années 1640, dans le Gloucestershire, les
élites urbaines favorables au Parlement étaient qualifiées de middle sort
pour leur défense héroïque de leur liberté contre une foule de soldats
royalistes décrits comme des pillards gyrovagues.
Au sein des villes, la
distinction entre les lower, middle et upper sort reposait sur le classement
des professions jugées « honorables » (docteurs, juristes, grands
marchands), « propre » (boutiquiers, aubergistes) et « dégradantes »
(bouchers, tanneurs).
De fait, la structure professionnelle des villes comtales était bien plus
complexe que celles des villages ou des villes-marchés et le nombre des
métiers représentés y était beaucoup plus important : plus d’une vingtaine
dans la plupart des villes comtales et jusqu’à cent dans les grandes
capitales provinciales comme York ou Bristol.
Artisans et commerçants se
confondaient parfois dans une même catégorie, et il est donc assez difficile
de connaître leur effectif exact.
Les artisans du textile (clothworker) et des
métaux (metalworker) pouvaient d’ailleurs s’enrichir et s’impliquer dans le
commerce.
Ainsi à Manchester, bien des artisans textiles spécialisés (cloth
et linen) disposaient de leur propre réseau de distribution.
En revanche, la
proportion d’artisans ayant développé des activités commerciales est bien
plus faible pour le travail de la poterie ou des draps.
Il est aussi difficile de
comptabiliser les divers marchands qui résidaient dans les villes-marchés
et dans les petits ports, les nombreux intermédiaires et courtiers impliqués
dans le petit commerce maritime.
De même les pauvres suscitaient des discours contradictoires et faisaient
l’objet de multiples typologies.
Leur nombre variait considérablement selon
les lieux, l’époque et surtout la définition retenue de la pauvreté ;
généralement ils formaient entre 20 % et 30 % de la population d’une
ville.
Comme dans les communautés rurales, les inégalités sociales se sont
creusées au cours des XVIe et XVIIe siècles avec d’une part les élites
marchandes, et d’autre part la masse des petits artisans, compagnons ou
manouvriers.
La richesse en ville était très inégalement répartie.
B) Le monde des métiers
L’activité économique dominante différait d’une ville à l’autre mais
généralement entre un tiers et la moitié....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓