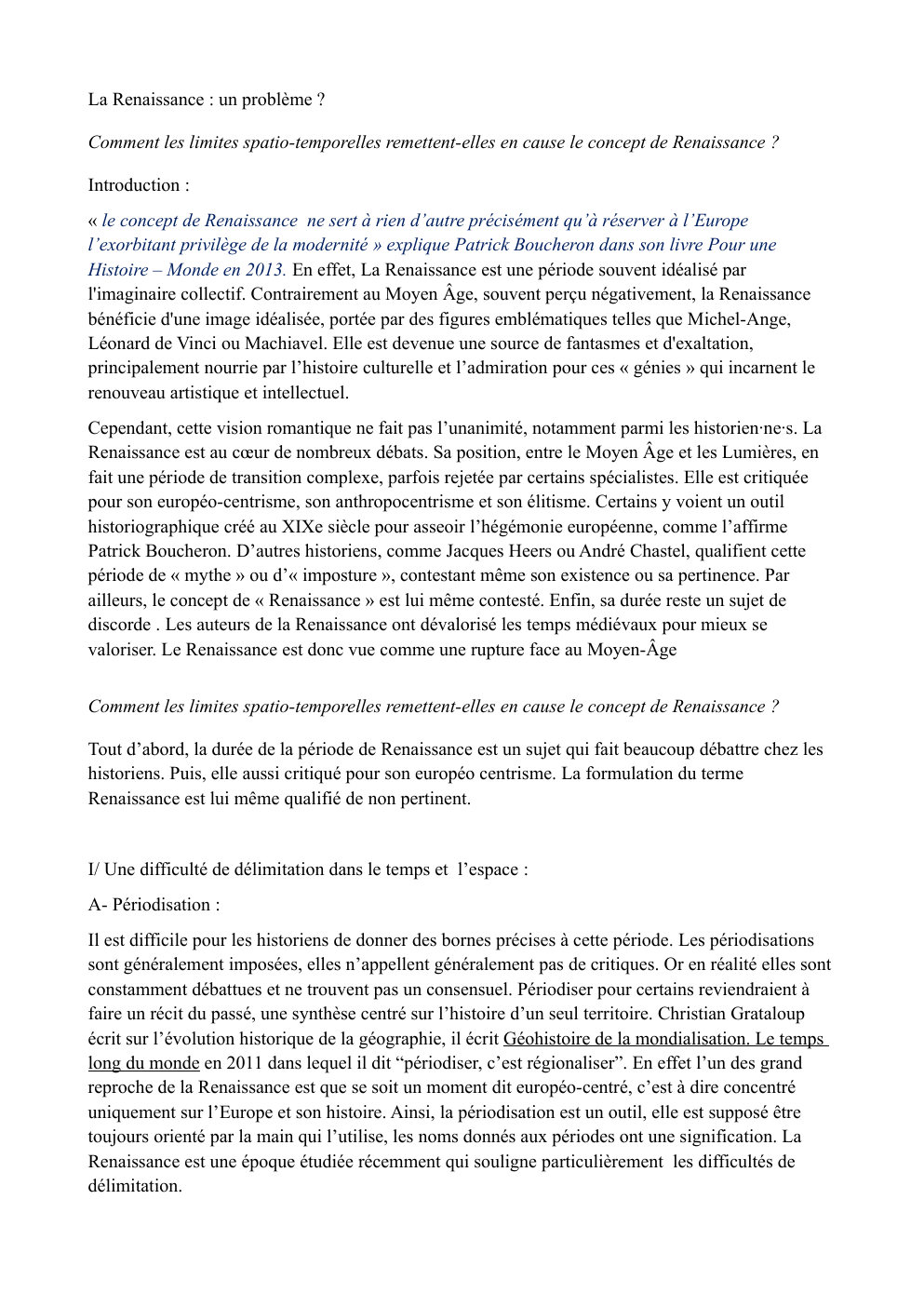La Renaissance : un problème ?
Publié le 26/01/2025
Extrait du document
«
La Renaissance : un problème ?
Comment les limites spatio-temporelles remettent-elles en cause le concept de Renaissance ?
Introduction :
« le concept de Renaissance ne sert à rien d’autre précisément qu’à réserver à l’Europe
l’exorbitant privilège de la modernité » explique Patrick Boucheron dans son livre Pour une
Histoire – Monde en 2013.
En effet, La Renaissance est une période souvent idéalisé par
l'imaginaire collectif.
Contrairement au Moyen Âge, souvent perçu négativement, la Renaissance
bénéficie d'une image idéalisée, portée par des figures emblématiques telles que Michel-Ange,
Léonard de Vinci ou Machiavel.
Elle est devenue une source de fantasmes et d'exaltation,
principalement nourrie par l’histoire culturelle et l’admiration pour ces « génies » qui incarnent le
renouveau artistique et intellectuel.
Cependant, cette vision romantique ne fait pas l’unanimité, notamment parmi les historien·ne·s.
La
Renaissance est au cœur de nombreux débats.
Sa position, entre le Moyen Âge et les Lumières, en
fait une période de transition complexe, parfois rejetée par certains spécialistes.
Elle est critiquée
pour son européo-centrisme, son anthropocentrisme et son élitisme.
Certains y voient un outil
historiographique créé au XIXe siècle pour asseoir l’hégémonie européenne, comme l’affirme
Patrick Boucheron.
D’autres historiens, comme Jacques Heers ou André Chastel, qualifient cette
période de « mythe » ou d’« imposture », contestant même son existence ou sa pertinence.
Par
ailleurs, le concept de « Renaissance » est lui même contesté.
Enfin, sa durée reste un sujet de
discorde .
Les auteurs de la Renaissance ont dévalorisé les temps médiévaux pour mieux se
valoriser.
Le Renaissance est donc vue comme une rupture face au Moyen-Âge
Comment les limites spatio-temporelles remettent-elles en cause le concept de Renaissance ?
Tout d’abord, la durée de la période de Renaissance est un sujet qui fait beaucoup débattre chez les
historiens.
Puis, elle aussi critiqué pour son européo centrisme.
La formulation du terme
Renaissance est lui même qualifié de non pertinent.
I/ Une difficulté de délimitation dans le temps et l’espace :
A- Périodisation :
Il est difficile pour les historiens de donner des bornes précises à cette période.
Les périodisations
sont généralement imposées, elles n’appellent généralement pas de critiques.
Or en réalité elles sont
constamment débattues et ne trouvent pas un consensuel.
Périodiser pour certains reviendraient à
faire un récit du passé, une synthèse centré sur l’histoire d’un seul territoire.
Christian Grataloup
écrit sur l’évolution historique de la géographie, il écrit Géohistoire de la mondialisation.
Le temps
long du monde en 2011 dans lequel il dit “périodiser, c’est régionaliser”.
En effet l’un des grand
reproche de la Renaissance est que se soit un moment dit européo-centré, c’est à dire concentré
uniquement sur l’Europe et son histoire.
Ainsi, la périodisation est un outil, elle est supposé être
toujours orienté par la main qui l’utilise, les noms donnés aux périodes ont une signification.
La
Renaissance est une époque étudiée récemment qui souligne particulièrement les difficultés de
délimitation.
L’histoire est “découper l’histoire en tranches” dit Jacques Leboeuf.
B- Borner la Renaissance pour la définir ?
En effet, pour découper l’histoire les historiens s’appuient sur des grands évènements.
Les trois
bornes les plus connus sont vers 1450 lors de l’invention de l’imprimerie par Gutenberg.
Cette
invention est considéré comme un des points de départ de la Renaissance car elle permet une
avancée dans la société, elle offre un moyen de diffuser les idées de l’époque.
La deuxième borne la
plus importe est le 29 mai 1453 qui est la prise de Constantinople par le sultan ottoman Mehmet II.
La population européenne de Constantinople fuit de peur, vers l’Italie.
Ils apportent avec eux les
ouvrages de philosophes grecs qui n’avaient pas tant circulé (Chrysoloras par exemple qui parle
d’une peur du Turc).
Il y a une redécouverte de l’Antiquité grecque car la plupart des ouvrages
philosophiques sont importés de là bas.
On parle d’un transfert culturel de l'Antiquité grecque et
orientale.
Cela marque le début de la Renaissance pour l’Europe.
Enfin, la grande découverte de ce siècle est en 1492 est la découverte des Amériques par Christophe
Colomb, qui met le pied (non par sur le continent) sur une île des Caraïbes qu’il appelle San
Salvador.
Cette découverte marque une ouverture de l’Europe au monde car l’Europe dépasse ses
frontières.
Elle permet un changement de regard et une diffusion de la connaissance.
Mais placer ses délimitations à ces évènements induisent l’Europe dans une position de puissance.
Les bornes de fin de la Renaissance ne font pas exception.
La borne de fin ce que l’on appelle le
terminus post quem se place dans les années 1560 avec notamment la clôture du Concile de Trente
en 1563.
Ce concile a pour but de trouver une solution face aux guerres de religion entre le
protestantisme et le christianisme.
Il marque l’acceptation de la rupture entre les 2 branches
religieuses.
On constate que tout découpage est discutable puisque plusieurs historiens parlent d’une
Renaissance tardive qui se prolongerait jusqu’en 1630 avec le courant artistique du maniérisme.
Et
que le cadre temporel varie selon les lieux : l’Italie et l’Angleterre n’ont pas les mêmes délimitation.
Elle démarrerait au début du 14e s en Italie et fin du 15e en Angleterre.
Il y a un fort décalage.
C- Quelle Europe à l’époque de la Renaissance ?
Malgré tout il y a un consensus autour du “Beau XVIème siècle”, c’est-à-dire la période de la
Renaissance qui se tiendrait de 1450 à 1560.
En plus de débattre sur sa durée, les historiens
n’arrivent pas à se mettre d’accord sur le point de départ de la Renaissance.
Alors l’historien Peter
BURKE dans son livre La Renaissance européenne souligne l’importance de considérer à la fois les
foyers réputé et moins connu du public.
Les foyers se tiennent dans les villes flamandes, italiennes
et dans la cour de France.
Il existe également des foyers au Portugal, en Hongrie, en Moscovie, en
Scandinavie et en Irlande.
La Renaissance connaît également une influence dans l’Empire Ottoman : les empereurs ottomans
voulaient être portraiturés par des peintres italiens.
Par exemple le sultan Mehmet II fait réaliser son
portrait par un peintre Italien qui séjournait à Constantinople Gentile Bellini.
Ce n’est pas une
simple diffusion, Peter Burke parle de « imitation créative » et de « domestication ».
En effet, il y a
une imitation créative dans l’art et une imitation domestique dans l’urbanisme et les modes de vie.
L’Europe voit apparaître des changements de l’homme, de ses représentations et du monde.
A cette
époque l’Europe « prendrait conscience d’elle même » explique John Hale.
C’est à dire que les
individus appréhendent différemment le monde.
II/ Un concept construit étape par étape
A – Des discours humanistes : la Renaissance par ses contemporains :
La Renaissance est un choix, elle n’a pas été naturelle.
La construction de la Renaissance se fait tout
d’abord par les contemporains de cette période.
Les humanistes sont les principaux artistes de la
Renaissance.
Giorgio Vasari, dans Vie des plus illustres peintres, sculpteurs et architectes italiens,
emploi le terme de “Rinascita” c’est-à-dire de renaissance dans les arts.
Il dit « cette province semble née pour ressusciter les choses mortes, comme on
a vu de la poésie, de la peinture et de la sculpture.
» C’est simple pour lui, les artistes
illustres sont ceux qui s’inspirent le plus des canons antiques.
Alors que les humanistes français
comme Machiavel parlent d’humanisme dans les lettres, Rabelais parle « de restitution des lettres »
et Guillaume Budé parle « de résurrection de l’Antiquité ».
Il faut toutefois nuancer cette notion de
renaissance, le terme de “renovatio” (revenir au passé).
Cependant, cette vision repose sur une idéalisation d'un passé reconstruit.
En revendiquant un retour
à une Antiquité glorifiée, les humanistes de la Renaissance simplifient la complexité historique et
occultent les différences entre leur époque et l'Antiquité.
Chacun associe une idée de Renaissance a un domaine.
C’est le mythe de l’âge d’or.
C’est la
période du s’était mieux avant.
Pour eux le meilleur est dans le passé, pour eux progresser est
revenir dans un passé idéalisé.
Dans l’allégorie de la Caverne de Platon : les humanistes se
prétendent sortis de la caverne et ont vu la réalité du passé.
Certains « voient la lumière » et se
donnent comme devoir d’informer les autres de la vérité et d’autres « restent dans l’ombre »Cela
relève également d’une vision téléologique c’est à dire ils ne peuvent se rendre compte qu’après
l’avoir vécu.
B- Première définition du concept :
En effet le concept de Renaissance n’est que réellement définis qu’à partir du 19e s.
Des historiens
comme Jules Michelet crée une illusion sur cette période qui imprègne durablement les populations.
Il publie en 1855 Introduction à la Renaissance ou il introduit le R majuscule à cette période.
Il
n’est pas à la recherche de nuance, d’objectivité, de neutralité contrairement aux humanistes.
Il se
positionne comme enthousiaste vis-à-vis de la Renaissance.
Il parle d’une “effervescence
nouvelleté” “où tout renaît où naît “.
Il en fait une période charnière et universelle, où tout converge
vers un idéal de progrès et de liberté.
Si c’est pour....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Histoire - La Renaissance
- KANT: «Le problème qui consiste à déterminer d'une façon sûre et générale quelle action peut favoriser le bonheur d'un être raisonnable est un problème tout à fait insoluble.»
- Bachelard, « C'est en termes d'obstacles qu'il faut poser le problème de la connaissance scientifique»: la notion d'obstacle épistémologique
- Aristote: Le problème de la valeur
- Kant: Le problème du jugement esthétique