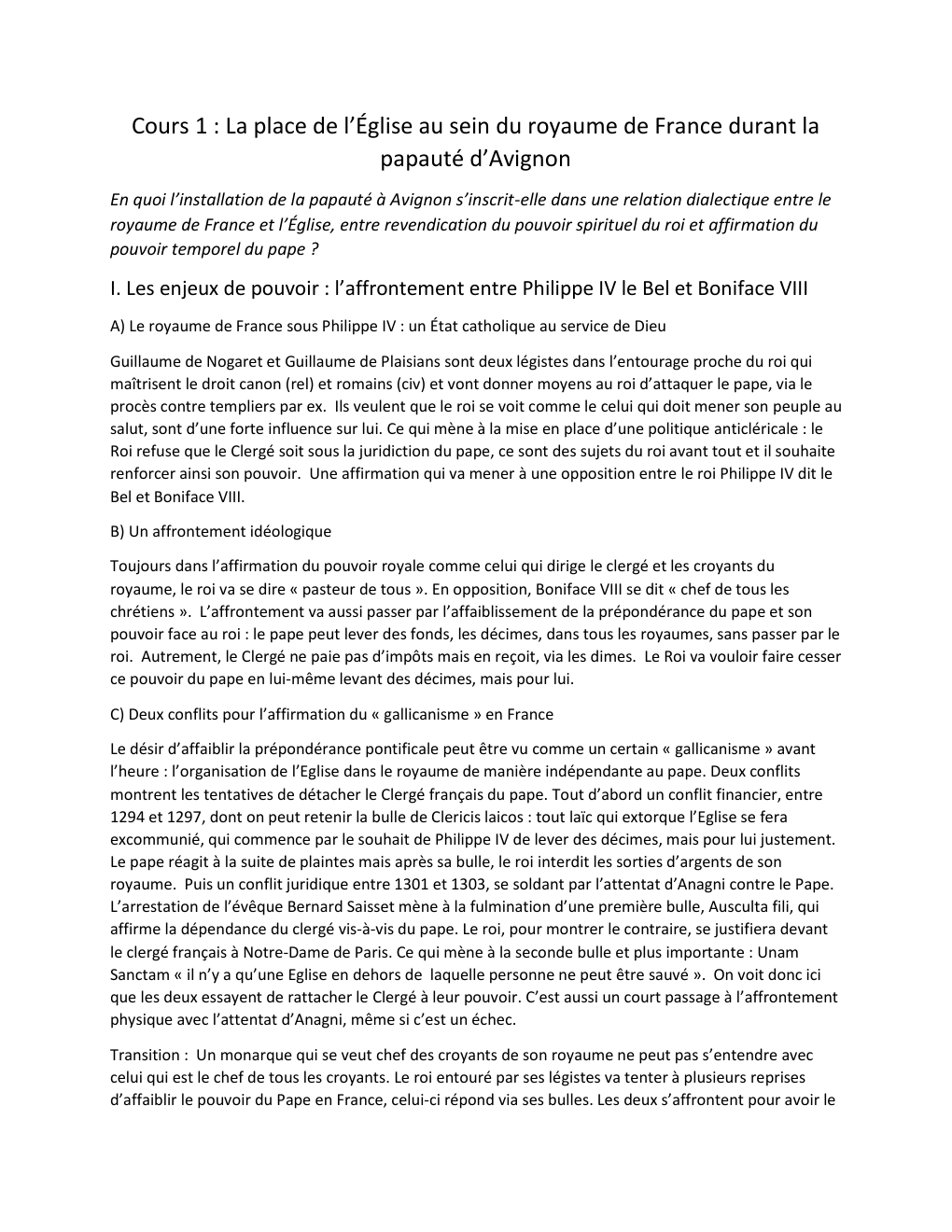La place de L’Église en France sous la papauté d’Avignon
Publié le 22/06/2023
Extrait du document
«
Cours 1 : La place de l’Église au sein du royaume de France durant la
papauté d’Avignon
En quoi l’installation de la papauté à Avignon s’inscrit-elle dans une relation dialectique entre le
royaume de France et l’Église, entre revendication du pouvoir spirituel du roi et affirmation du
pouvoir temporel du pape ?
I.
Les enjeux de pouvoir : l’affrontement entre Philippe IV le Bel et Boniface VIII
A) Le royaume de France sous Philippe IV : un État catholique au service de Dieu
Guillaume de Nogaret et Guillaume de Plaisians sont deux légistes dans l’entourage proche du roi qui
maîtrisent le droit canon (rel) et romains (civ) et vont donner moyens au roi d’attaquer le pape, via le
procès contre templiers par ex.
Ils veulent que le roi se voit comme le celui qui doit mener son peuple au
salut, sont d’une forte influence sur lui.
Ce qui mène à la mise en place d’une politique anticléricale : le
Roi refuse que le Clergé soit sous la juridiction du pape, ce sont des sujets du roi avant tout et il souhaite
renforcer ainsi son pouvoir.
Une affirmation qui va mener à une opposition entre le roi Philippe IV dit le
Bel et Boniface VIII.
B) Un affrontement idéologique
Toujours dans l’affirmation du pouvoir royale comme celui qui dirige le clergé et les croyants du
royaume, le roi va se dire « pasteur de tous ».
En opposition, Boniface VIII se dit « chef de tous les
chrétiens ».
L’affrontement va aussi passer par l’affaiblissement de la prépondérance du pape et son
pouvoir face au roi : le pape peut lever des fonds, les décimes, dans tous les royaumes, sans passer par le
roi.
Autrement, le Clergé ne paie pas d’impôts mais en reçoit, via les dimes.
Le Roi va vouloir faire cesser
ce pouvoir du pape en lui-même levant des décimes, mais pour lui.
C) Deux conflits pour l’affirmation du « gallicanisme » en France
Le désir d’affaiblir la prépondérance pontificale peut être vu comme un certain « gallicanisme » avant
l’heure : l’organisation de l’Eglise dans le royaume de manière indépendante au pape.
Deux conflits
montrent les tentatives de détacher le Clergé français du pape.
Tout d’abord un conflit financier, entre
1294 et 1297, dont on peut retenir la bulle de Clericis laicos : tout laïc qui extorque l’Eglise se fera
excommunié, qui commence par le souhait de Philippe IV de lever des décimes, mais pour lui justement.
Le pape réagit à la suite de plaintes mais après sa bulle, le roi interdit les sorties d’argents de son
royaume.
Puis un conflit juridique entre 1301 et 1303, se soldant par l’attentat d’Anagni contre le Pape.
L’arrestation de l’évêque Bernard Saisset mène à la fulmination d’une première bulle, Ausculta fili, qui
affirme la dépendance du clergé vis-à-vis du pape.
Le roi, pour montrer le contraire, se justifiera devant
le clergé français à Notre-Dame de Paris.
Ce qui mène à la seconde bulle et plus importante : Unam
Sanctam « il n’y a qu’une Eglise en dehors de laquelle personne ne peut être sauvé ».
On voit donc ici
que les deux essayent de rattacher le Clergé à leur pouvoir.
C’est aussi un court passage à l’affrontement
physique avec l’attentat d’Anagni, même si c’est un échec.
Transition : Un monarque qui se veut chef des croyants de son royaume ne peut pas s’entendre avec
celui qui est le chef de tous les croyants.
Le roi entouré par ses légistes va tenter à plusieurs reprises
d’affaiblir le pouvoir du Pape en France, celui-ci répond via ses bulles.
Les deux s’affrontent pour avoir le
pouvoir spirituel au sein du royaume.
Mais face à une affirmation encore plus forte du roi comme chef
religieux, le pape est contraint d’aller jusqu’à son installation dans le royaume.
II.
Le roi, chef du Clergé de France
A) L’affirmation du roi de France comme chef spirituel
Après ces conflits-là, le roi continue de vouloir détacher le royaume au pouvoir pontifical.
L’exemple ici
est l’arrestation des Templiers, en 1307.
C’est toujours influencé par ses légistes que le roi prend cette
décision, après un refus du pape, montrant au passage que le pouvoir de ce dernier n’est plus
prépondérant.
Jugés par le roi (et non les tribunaux du pape) pour hérésie, ils vont avoués leur
culpabilité.
C’est un affaiblissement du pouvoir du pape dans le RDF, qui doit s’y rendre pour surveiller le
procès.
On parle de pontification de la royauté : le roi s’affirme comme celui qui est chef des croyants et
juge des croyants (au nom de Dieu).
B) Un pouvoir politique d’essence religieuse :
En réalité, ce n’est pas inédit ce lien entre la religion et le roi, même si là il est encore plus renforcé.
Le
roi puise son pouvoir dans le religieux.
Un roi est sacré, il est roi par droit divin.
Et par conséquent, il doit
être bon chrétien, pieux, et doit faire preuve d’intolérance face aux hérétiques.
Une intolérance qui se
développe face aux autres religions, pour les exclure, mais....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Exposé peine de mort: ABOLITION DE LA PEINE DE MORT EN FRANCE
- SES grand oral engagement politique: Urgence climatique : quelle place pour la voix des jeunes ?
- Fiche - La sexualité en France dans la deuxième moitié du XXe siècle
- Quelles stratégies le Qatar met en place pour consolider sa puissance sur le plan politique et géopolitique ?
- DS sur la structuration et les classes sociales en France