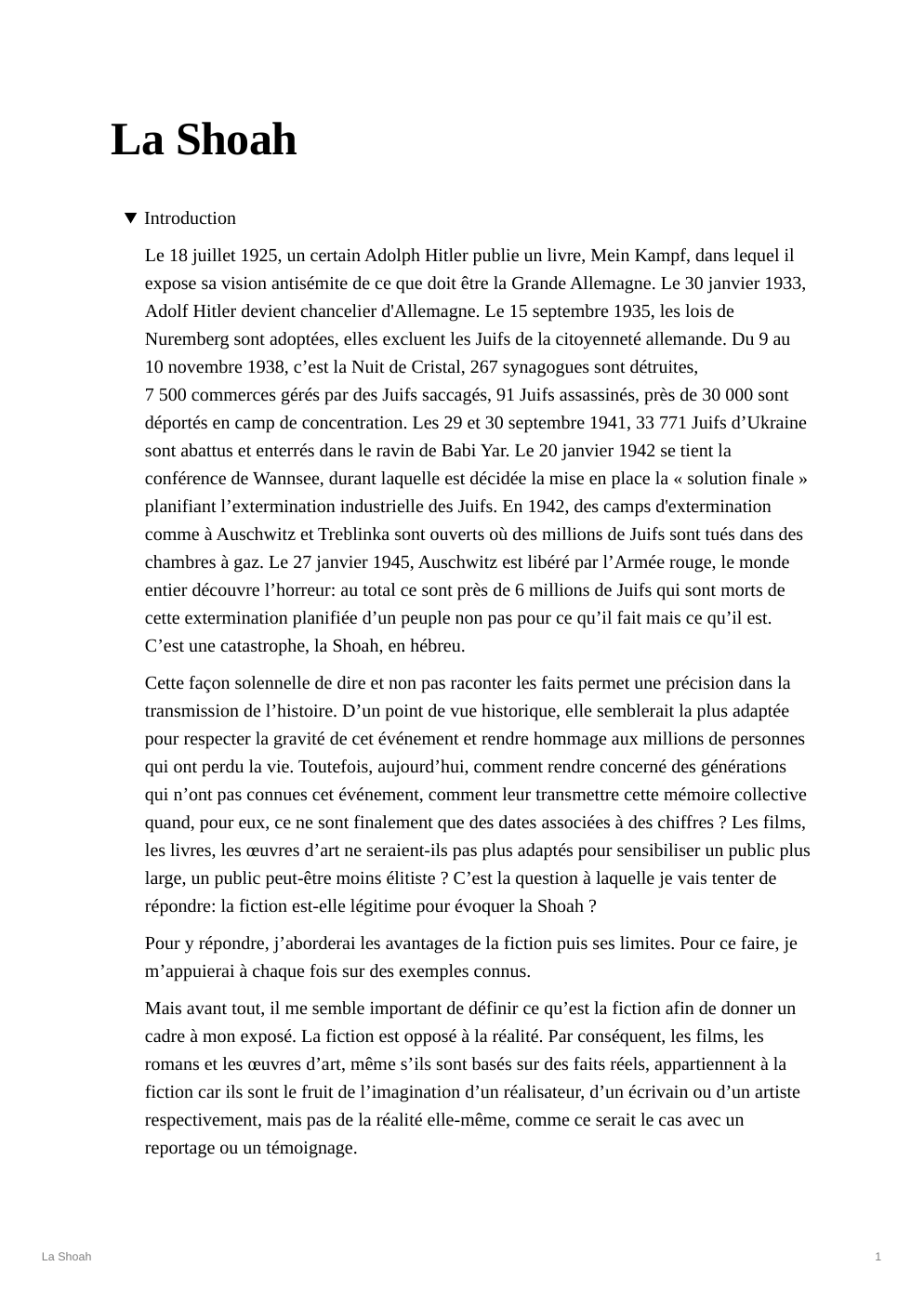Fiction et Shoah
Publié le 04/01/2024
Extrait du document
«
La Shoah
Introduction
Le 18 juillet 1925, un certain Adolph Hitler publie un livre, Mein Kampf, dans lequel il
expose sa vision antisémite de ce que doit être la Grande Allemagne.
Le 30 janvier 1933,
Adolf Hitler devient chancelier d'Allemagne.
Le 15 septembre 1935, les lois de
Nuremberg sont adoptées, elles excluent les Juifs de la citoyenneté allemande.
Du 9 au
10 novembre 1938, c’est la Nuit de Cristal, 267 synagogues sont détruites,
7 500 commerces gérés par des Juifs saccagés, 91 Juifs assassinés, près de 30 000 sont
déportés en camp de concentration.
Les 29 et 30 septembre 1941, 33 771 Juifs d’Ukraine
sont abattus et enterrés dans le ravin de Babi Yar.
Le 20 janvier 1942 se tient la
conférence de Wannsee, durant laquelle est décidée la mise en place la « solution finale »
planifiant l’extermination industrielle des Juifs.
En 1942, des camps d'extermination
comme à Auschwitz et Treblinka sont ouverts où des millions de Juifs sont tués dans des
chambres à gaz.
Le 27 janvier 1945, Auschwitz est libéré par l’Armée rouge, le monde
entier découvre l’horreur: au total ce sont près de 6 millions de Juifs qui sont morts de
cette extermination planifiée d’un peuple non pas pour ce qu’il fait mais ce qu’il est.
C’est une catastrophe, la Shoah, en hébreu.
Cette façon solennelle de dire et non pas raconter les faits permet une précision dans la
transmission de l’histoire.
D’un point de vue historique, elle semblerait la plus adaptée
pour respecter la gravité de cet événement et rendre hommage aux millions de personnes
qui ont perdu la vie.
Toutefois, aujourd’hui, comment rendre concerné des générations
qui n’ont pas connues cet événement, comment leur transmettre cette mémoire collective
quand, pour eux, ce ne sont finalement que des dates associées à des chiffres ? Les films,
les livres, les œuvres d’art ne seraient-ils pas plus adaptés pour sensibiliser un public plus
large, un public peut-être moins élitiste ? C’est la question à laquelle je vais tenter de
répondre: la fiction est-elle légitime pour évoquer la Shoah ?
Pour y répondre, j’aborderai les avantages de la fiction puis ses limites.
Pour ce faire, je
m’appuierai à chaque fois sur des exemples connus.
Mais avant tout, il me semble important de définir ce qu’est la fiction afin de donner un
cadre à mon exposé.
La fiction est opposé à la réalité.
Par conséquent, les films, les
romans et les œuvres d’art, même s’ils sont basés sur des faits réels, appartiennent à la
fiction car ils sont le fruit de l’imagination d’un réalisateur, d’un écrivain ou d’un artiste
respectivement, mais pas de la réalité elle-même, comme ce serait le cas avec un
reportage ou un témoignage.
La Shoah
1
Les avantages mémoriaux de la fiction
La possibilité de transmettre une expérience émotionnelle de la Shoah
Tout d’abord, la fiction a pour avantage de susciter des émotions fortes chez le
lecteur et le spectateur.
Prenons l’exemple du Pianiste de Roman Polanski.
Ce film met en scène un jeune
pianiste juif de Varsovie qui, durant l’occupation allemande, se cache chez des
résistants, puis dans des maisons en ruine pour échapper à la déportation.
Un jour,
alors qu’il cherche à manger, il tombe sur une boite de conserve.
Par manque de
force, il ne peut l’ouvrir et l’échappe.
La boite roule et arrive au pied d’un officier
allemand.
Ce dernier, au lieu d’abattre le pianiste, lui demande de jouer un morceau
sur le piano presqu’intacte de la maison pourtant délabrée.
Le soldat nazi, subjuguée
par la musique de l’artiste, lui donne son manteau et lui apportera régulièrement de
la nourriture.
Cette scène est bien sur romancée mais elle a le mérite de transmettre une expérience
émotionnelle vécue par une victime de la Shoah.
Tout d’abord, le regard du pianiste
est empreint d’angoisse et de terreur face au soldat nazi qui le domine grâce à l’effet
de contre plongée.
De plus, le morceau joué, à savoir la Ballade n.1 de Chopin, est
un moyen d’expression transcendant: à défaut de pouvoir hurler sa détresse, le
pianiste la joue.
La fiction, quoiqu’imparfaite sur le plan historique, permet donc de
marquer l’esprit du spectateur qui n’en sort pas indifférent et qui, à défaut de
connaitre l’entièreté des évènements qui compose la Shoah, en a saisit l’horreur.
Un vecteur de transmission de la mémoire
Mais la fiction ne sert pas seulement à attirer le spectateur par l’émotion, elle peut
aussi s’inscrire comme un vecteur de transmission de la mémoire.
La mémoire se
définit comme l’accumulation empirique de choses du passé.
La transmission de
cette mémoire passe donc inévitablement par le témoignage des anciennes aux plus
jeunes générations.
Or la fiction, peut parfois remplir ce rôle.
Prenons l’exemple de La Liste de Schnilder.
C’est un film dramatique de Steven
Spielberg.
Jouer par des acteurs, le film retrace une histoire vraie.
Il décrit comment
Oskar Schindler, un industriel allemand a réussi à sauver près de 1200 Juifs promis à
la mort dans des camps de concentration.
Le livre biographique dont s’inspire le film se veut comme le témoignage de
l’histoire d’un homme mais le film, lui, est bien ancré, par définition, dans la fiction.
Toutefois, malgré son caractère fictionnel, malgré les quelques scènes parfois
dramatisées, La Liste de Schindler de Spielberg a reçu plusieurs Oscars et par
La Shoah
2
conséquent a touché un large public.
A l’époque, le président des USA souhaitait
même que le film soit diffusé dans toutes les écoles.
Si le livre biographique se veut précis, il manque d’audience.
La valeur de la fiction
est là: parce qu'elle simplifie, parce qu’elle transforme le témoignage en une œuvre
émouvante, elle étend la portée du message.
Les limites historiques de la fiction
Une déformation de....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Nietzsche: Le christianisme ou le domaine de la pure fiction
- La fiction ne peut servir à L'expression de la pensée ?
- Le génie n'est-il qu'une fiction ?
- Nietzsche: Le christianisme ou le domaine de la pure fiction
- Une fiction peut-elle etre vraie ?