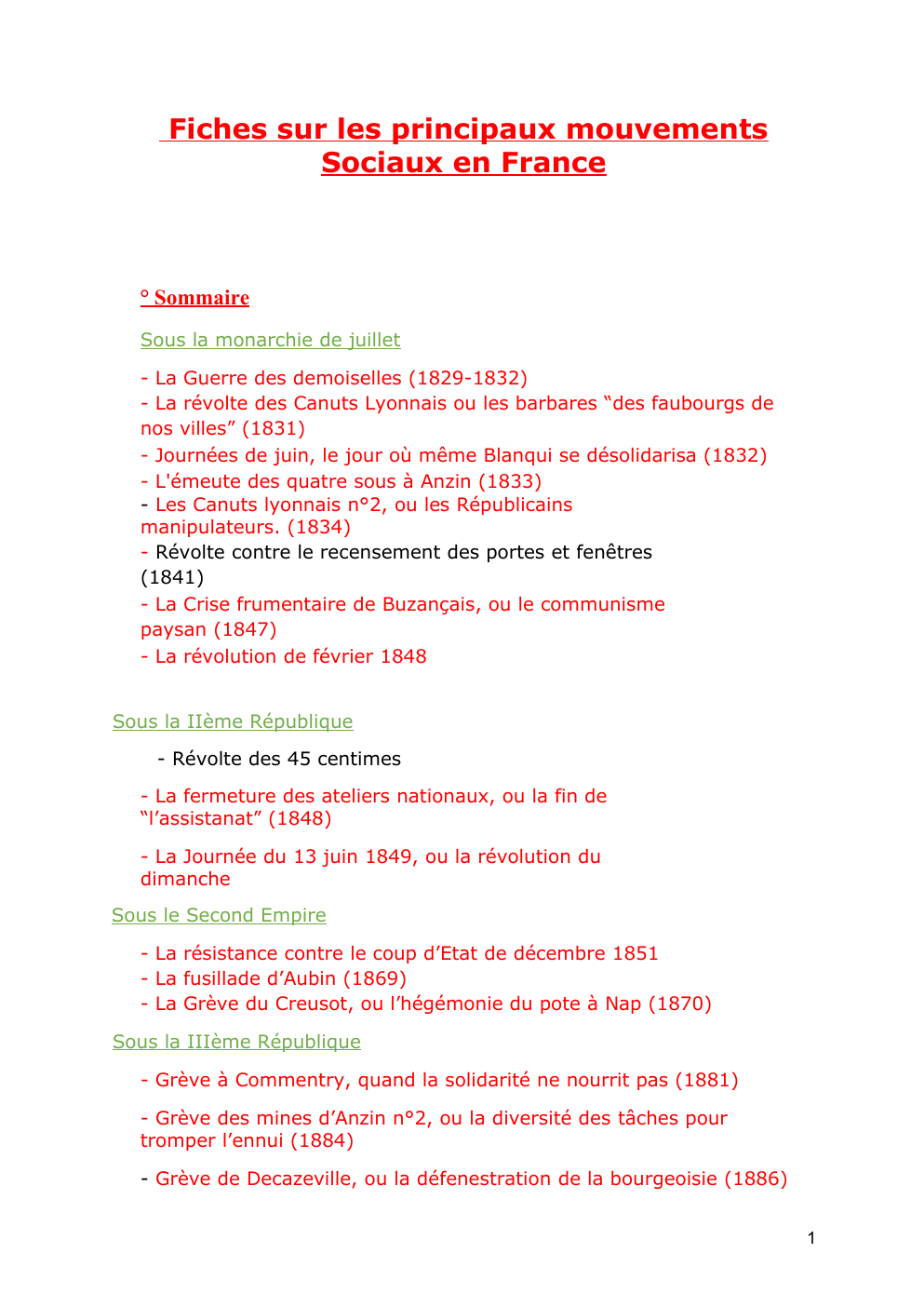Fiches sur les principaux mouvements Sociaux en France
Publié le 03/12/2023
Extrait du document
«
Fiches sur les principaux mouvements
Sociaux en France
° Sommaire
Sous la monarchie de juillet
- La Guerre des demoiselles (1829-1832)
- La révolte des Canuts Lyonnais ou les barbares “des faubourgs de
nos villes” (1831)
- Journées de juin, le jour où même Blanqui se désolidarisa (1832)
- L'émeute des quatre sous à Anzin (1833)
- Les Canuts lyonnais n°2, ou les Républicains
manipulateurs.
(1834)
- Révolte contre le recensement des portes et fenêtres
(1841)
- La Crise frumentaire de Buzançais, ou le communisme
paysan (1847)
- La révolution de février 1848
Sous la IIème République
- Révolte des 45 centimes
- La fermeture des ateliers nationaux, ou la fin de
“l’assistanat” (1848)
- La Journée du 13 juin 1849, ou la révolution du
dimanche
Sous le Second Empire
- La résistance contre le coup d’Etat de décembre 1851
- La fusillade d’Aubin (1869)
- La Grève du Creusot, ou l’hégémonie du pote à Nap (1870)
Sous la IIIème République
- Grève à Commentry, quand la solidarité ne nourrit pas (1881)
- Grève des mines d’Anzin n°2, ou la diversité des tâches pour
tromper l’ennui (1884)
- Grève de Decazeville, ou la défenestration de la bourgeoisie (1886)
1
- Grève de Fourmies, ou le pique-nique champêtre finissant en
massacre (1891)
- Grève de Carmaux n°1, ou l’éviction de l’ouvrier-maire (1892)
- Le massacre de Aigues-Mortes, ou le crachat de trop (1893)
- Grève de Carmaux n°2, ou le smart move patronal foiré (1895)
- Les émeutes durant la Fête Dieu à Nantes, le 14 juin 1903
- Grève de Limoges, Quand la lubricité du mâle est dénoncée (1905)
- Grève de Courrières, ou l’explosion de trop (1906)
- Querelles des inventaires (1906)
- Les révoltés du midi-viticoles de 1907
- Grève de Draveil-Villeneuve-Saint-Georges, ou l’action du briseur
de grève (1908)
- La Grève des PTT, ou David contre Goliath (1909)
- Les manifestations de solidarité pour la libération de Francisco
Ferrer (1909)
- Grève des charbonniers du port du Havre, ou l’affaire Dreyfus des
travailleurs
- Grève générale des chemins de fer, ou les soldats sur les voies
ferrées (1910)
- Grève des midinettes, quand les femmes ont fait trembler
l’Etat
- Grèves de juin 1919, ou la révolution manquée
- Grèves des Penn sardin en 1924, quand les jaunes font mal
leur travail
- Grève de Roubaix-Tourcoing (1930)
- Crise du 6 février 1934, ou les fachos à l’assaut de la République
- Grèves de mai-juin 1936, ou l’espoir en une ère nouvelle
- Grèves du 30 novembre 1938 contre la suppression des 40h/semaine
- Manifestation du 11 novembre 1940
- Grèves patriotiques des mineurs du Nord-Pas-De-Calais, ou la
revanche des polonais (1941)
Sous la IVème République
- Grèves générales d’automne 1947
- Grève des mineurs de 1948, ou l’histoire d’un socialiste qui tape
sur des électeurs
- Grèves d’août 1953, ou le cadeau estival de Laniel
- Manifestations poujadistes de septembre 1955
Sous la Vème République
- La Semaine des Barricade d’Alger, ou la nostalgie du temps béni des
colonies (1961)
2
- Juin 1961, l’assaut de la sous-préfecture de Morlaix, une nouvelle Jacquerie ?
- Massacre du 17 octobre 1961, ou l’histoire d’un nazi qui tape sur
des arabes
- Massacre du métro Charonne, ou la police s’amusant à se faire du
coco (1962)
- La grève des mineurs de 1963 ou le jour où De Gaulle a perdu
- Mai 1968
La Guerre des demoiselles
Contexte : 1829-1832.
Sous la Restauration.
En Ariège (Pyrénées)
Cause : Développement d’une industrie du charbon de bois qui entre en
conflit avec le système agro sylvo pastoral de la région sur l’exploitation
de la forêt -> Vote d’une nouvelle réglementation du code forestier en
mai 1827 qui interdit le marronnage, le pâturage, la pêche et la
cueillette dans les forêts pour favoriser l’industrie du charbon
Déroulement : Des paysans se déguisent en femmes et se noircissent le
visage avec du charbon pour ne pas être reconnus et s’attaquent aux
gardes forestiers et aux gendarmes qui les empêchent de
continuer leur activité agro sylvo pastorale par des escarmouches
et autres techniques de guérilla (ils ont l’avantage de bien connaître le
terrain).
Ils s’opposent aux tentatives des gardes forestiers de saisir
leurs troupeaux ou de les arrêter (solidarité villageoise).
Ils s’attaquent également aux charbonniers accusés de détruire la
forêt en détruisant leurs cabanes et leurs outils + intimidation : en
novembre 1829 placard sommant les charbonniers de Buzan de quitter
la forêt avant qu’il ne leur arrive malheur.
Manifestations de centaines
de demoiselles à Balaguère (24 janvier 1830) et à Massat (17 février
1830) qui crient “A bas les gardes forestiers !” -> soutien des
populations et autorités locales.
L'envoi de la troupe est inopérant, les troubles ayant lieu dans les
montagnes accidentées et mal connues.
Le 10 mai 1830, une centaine de révoltés attaquent la maison d’un
garde de Saleich -> 1 mort côté insurgé.
Bilan : Le pouvoir en place ne se préoccupe pas trop de ces troubles, il
crée une commission départementale des forêts en septembre 1830.
Finalement le code forestier est supprimé dans le seul département de
3
l’Ariège + amnistie de tous les insurgés arrêtés.
D'autres troubles
éclatent les années suivantes à la suite de protestations de charbonniers
voulant préserver leurs droits obtenus avec le code forestier
Mise à sac de l’archevêché de Paris :
Contexte : 14 - 15 février 1831, France, Monarchie de Juillet.
Les
Républicains ne sont pas contents qu’on leur ai volé leur révolution.
Cause : émeutes à Paris à la suite d’un service funèbre organisé par
les légitimistes à Saint-Germain-L'auxerrois pour l’anniversaire de
l’assassinat du duc de Berry.
L’église est envahie et mise à sac par les
républicains.
Le lendemain, les émeutiers saccagent l’archevêché et de
nombreuses églises à Paris et en province.
15 février, France :
Sac de l'archevêché de Paris, destruction de l'archevêché et de la
maison de campagne de l'archevêque à Conflans, tentatives sur les
églises de l'Assomption et de Saint-Roch, envahissement de la maison de
l'avocat Dupin, rue Coq-Héron ;
Bal chez les Rothschild.
Thiers raconte à Rémusat le sac de l'archevêché
qu'il a laissé faire.
Rémusat (Mémoires, t.
2, p.
434) : « Thiers et le sac de l’archevêché »,
Rémusat : « J'y rencontrai Thiers, et nous eûmes sur ce point, au milieu
du salon, une conversation qui se tourna en discussion à la grande
curiosité de la galerie qui, naturellement, était pour moi.
Il était allé le
matin aux ruines de l'archevêché.
C'est là qu'il avait trouvé Arago et sa
compagnie, et qu'ils avaient eu un entretien dont il fut plus tard question à
la tribune.
Il avait été vivement frappé de la rapidité irrésistible avec
laquelle s'était consommée cette grande destruction.
La sensation est
forte chez lui.
Indifférent à ce qu'on lui rapporte, Thiers ressent presque
avec excès l'impression de ce qu'il voit ; pour peu que le spectacle soit
frappant et inattendu, son imagination s'émeut.
La vue de la force et de la
force triomphante ne le trouvent jamais insensible.
Sa seconde pensée
est, non de lui résister, mais de s'en emparer.
C'est ce qui lui reste de son
commerce historique avec Mirabeau, Danton, Napoléon.
Je reconnus cet
effet dans notre conversation du bal ou du concert de Rothschild, et je l'ai
retrouvé d'autres fois.
Il me disait sans cesse : « Ah ! si vous aviez vu ce
que j'ai vu ce matin ! » Sa politique en resta modifiée quelque temps.
»
Thiers, sortant du Palais Bourbon où il avait apostrophé durement Berryer,
4
était allé se rendre compte sur place de l'émeute.
Il arriva à l'archevêché
au moment où Arago se préparait à pénétrer avec ses gardes
nationaux dans le bâtiment pour mettre fin à la dévastation.
Craignant une collision sanglante, Thiers intervint pour empêcher
cette intervention.
Arago, se rendant à cet ordre d'un sous-ministre, ne
bougea pas et le pillage de l'archevêché se poursuivit.
Finalement, les
insurgés finirent le travail qu’ils avaient déjà commencé lors des 3
glorieuses, de précipiter la ruine des locaux de l'archevêché de Paris.
celui-ci fut complètement incendié et à l'intérieur, les insurgés se
livrèrent à de nombreux actes profanateurs.
Ainsi Arago raconte que
des ouvriers furent envoyés au nombre de 7 ou 8 pour arracher une
reproduction de la Croix grandeur nature scellée à un mur.
La troupe ne
put les arrêter, ceux-ci leur ayant tendu un ordre signé du maire
du IXème arrondissement (complicité des élus).
une fois descellée la
croix fut détruite à coup de hache.
Les insurgés pillèrent également la
sacristie et tous les objets précieux qu’elle contenait.
Au total, le coût de
cette mise à sac fut évalué à 127 032 francs de l’époque.
Bilan : cette mise à sac de l'archevêché de Paris est un bon exemple d’émeute anticléricale de
Républicains frustrés qu’on leur ai volé leur révolution en 1830.
On vit à l’occasion que les
émeutiers étaient couverts par certains élus locaux.
Les milieux catholiques reprochèrent
beaucoup à l’Etat son inaction face à ce déferlement de violence.....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Exposé peine de mort: ABOLITION DE LA PEINE DE MORT EN FRANCE
- Fiche - La sexualité en France dans la deuxième moitié du XXe siècle
- l'impact des média sociaux sur les élèves
- DS sur la structuration et les classes sociales en France
- La Nausée - Jean-Paul Sartre (1905-1980) - Roman, France, 1938