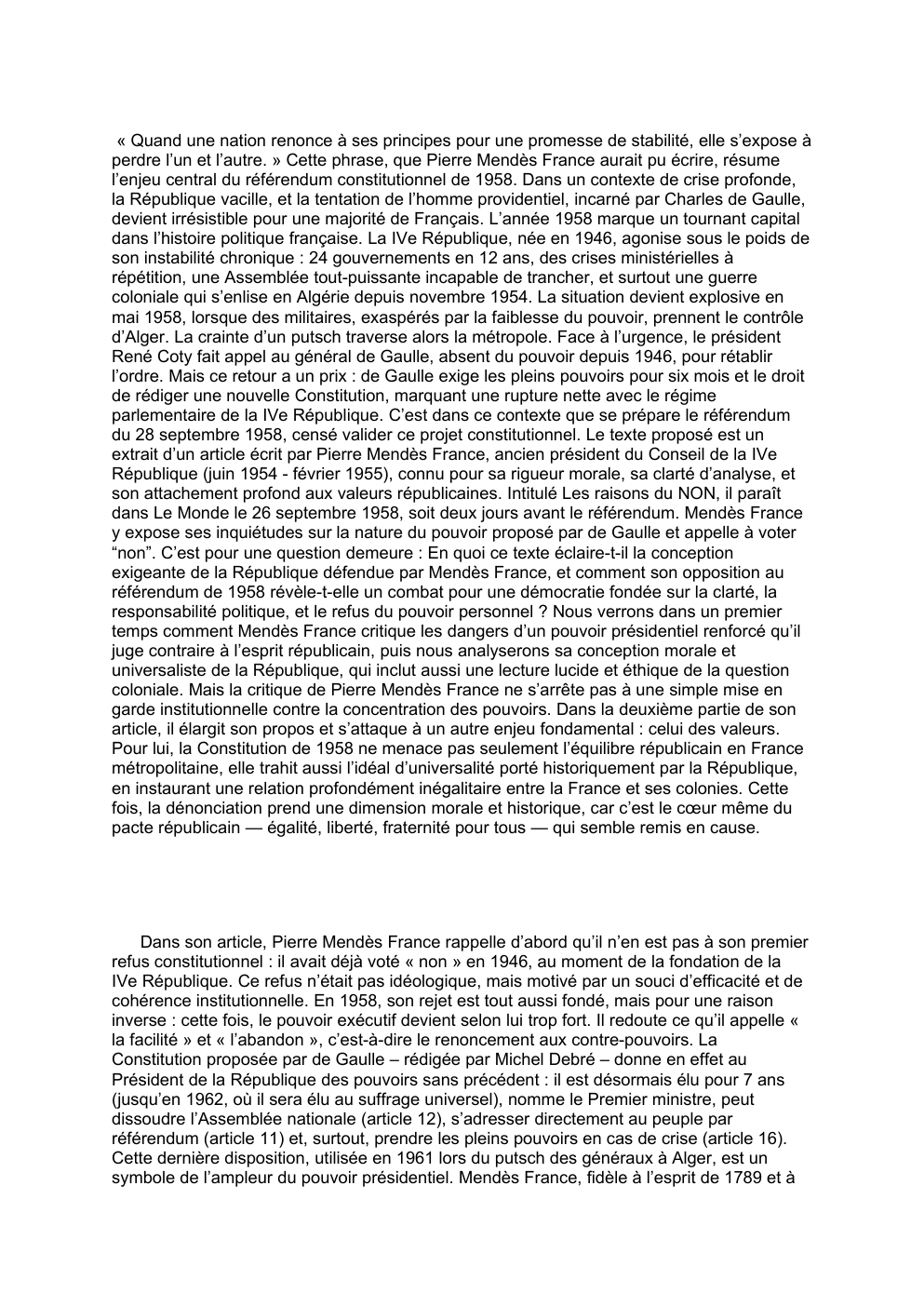« Quand une nation renonce à ses principes pour une promesse de stabilité, elle s’expose à perdre l’un et l’autre. »
Publié le 11/04/2025
Extrait du document
«
« Quand une nation renonce à ses principes pour une promesse de stabilité, elle s’expose à
perdre l’un et l’autre.
» Cette phrase, que Pierre Mendès France aurait pu écrire, résume
l’enjeu central du référendum constitutionnel de 1958.
Dans un contexte de crise profonde,
la République vacille, et la tentation de l’homme providentiel, incarné par Charles de Gaulle,
devient irrésistible pour une majorité de Français.
L’année 1958 marque un tournant capital
dans l’histoire politique française.
La IVe République, née en 1946, agonise sous le poids de
son instabilité chronique : 24 gouvernements en 12 ans, des crises ministérielles à
répétition, une Assemblée tout-puissante incapable de trancher, et surtout une guerre
coloniale qui s’enlise en Algérie depuis novembre 1954.
La situation devient explosive en
mai 1958, lorsque des militaires, exaspérés par la faiblesse du pouvoir, prennent le contrôle
d’Alger.
La crainte d’un putsch traverse alors la métropole.
Face à l’urgence, le président
René Coty fait appel au général de Gaulle, absent du pouvoir depuis 1946, pour rétablir
l’ordre.
Mais ce retour a un prix : de Gaulle exige les pleins pouvoirs pour six mois et le droit
de rédiger une nouvelle Constitution, marquant une rupture nette avec le régime
parlementaire de la IVe République.
C’est dans ce contexte que se prépare le référendum
du 28 septembre 1958, censé valider ce projet constitutionnel.
Le texte proposé est un
extrait d’un article écrit par Pierre Mendès France, ancien président du Conseil de la IVe
République (juin 1954 - février 1955), connu pour sa rigueur morale, sa clarté d’analyse, et
son attachement profond aux valeurs républicaines.
Intitulé Les raisons du NON, il paraît
dans Le Monde le 26 septembre 1958, soit deux jours avant le référendum.
Mendès France
y expose ses inquiétudes sur la nature du pouvoir proposé par de Gaulle et appelle à voter
“non”.
C’est pour une question demeure : En quoi ce texte éclaire-t-il la conception
exigeante de la République défendue par Mendès France, et comment son opposition au
référendum de 1958 révèle-t-elle un combat pour une démocratie fondée sur la clarté, la
responsabilité politique, et le refus du pouvoir personnel ? Nous verrons dans un premier
temps comment Mendès France critique les dangers d’un pouvoir présidentiel renforcé qu’il
juge contraire à l’esprit républicain, puis nous analyserons sa conception morale et
universaliste de la République, qui inclut aussi une lecture lucide et éthique de la question
coloniale.
Mais la critique de Pierre Mendès France ne s’arrête pas à une simple mise en
garde institutionnelle contre la concentration des pouvoirs.
Dans la deuxième partie de son
article, il élargit son propos et s’attaque à un autre enjeu fondamental : celui des valeurs.
Pour lui, la Constitution de 1958 ne menace pas seulement l’équilibre républicain en France
métropolitaine, elle trahit aussi l’idéal d’universalité porté historiquement par la République,
en instaurant une relation profondément inégalitaire entre la France et ses colonies.
Cette
fois, la dénonciation prend une dimension morale et historique, car c’est le cœur même du
pacte républicain — égalité, liberté, fraternité pour tous — qui semble remis en cause.
Dans son article, Pierre Mendès France rappelle d’abord qu’il n’en est pas à son premier
refus constitutionnel : il avait déjà voté « non » en 1946, au moment de la fondation de la
IVe République.
Ce refus n’était pas idéologique, mais motivé par un souci d’efficacité et de
cohérence institutionnelle.
En 1958, son rejet est tout aussi fondé, mais pour une raison
inverse : cette fois, le pouvoir exécutif devient selon lui trop fort.
Il redoute ce qu’il appelle «
la facilité » et « l’abandon », c’est-à-dire le renoncement aux contre-pouvoirs.
La
Constitution proposée par de Gaulle – rédigée par Michel Debré – donne en effet au
Président de la République des pouvoirs sans précédent : il est désormais élu pour 7 ans
(jusqu’en 1962, où il sera élu au suffrage universel), nomme le Premier ministre, peut
dissoudre l’Assemblée nationale (article 12), s’adresser directement au peuple par
référendum (article 11) et, surtout, prendre les pleins pouvoirs en cas de crise (article 16).
Cette dernière disposition, utilisée en 1961 lors du putsch des généraux à Alger, est un
symbole de l’ampleur du pouvoir présidentiel.
Mendès France, fidèle à l’esprit de 1789 et à
la Déclaration des Droits de l’Homme, rappelle implicitement que la souveraineté doit rester
entre les mains du peuple et que le pouvoir doit être équilibré.
Il écrit que le « oui » ouvre «
la voie au fascisme » : un mot très fort, qu’il n’utilise pas au hasard.
Il ne qualifie pas de
Gaulle de fasciste, mais craint qu’un tel régime présidentiel favorise les dérives autoritaires.
Ce que nous pouvons également ajouter c’est que le referendum c’est tenu le 28 septembre
1958.
Le résultat était sans appel : 82,6 % de vie en métropole et dans l’union française
avec un taux de participation de 84, pour cent Mendes France, fait donc partie des 17,4 % à
tenir une position minoritaire, mais profondément, argumenté.
Dans la suite de son article
Les raisons du NON, publié dans Le Monde le 26 septembre 1958, Pierre Mendès France
développe sa critique de la nouvelle Constitution en expliquant que celle-ci dévie de l’esprit
républicain traditionnel en conférant trop de pouvoirs au chef de l’État.
Il ne s’attaque pas
directement au général de Gaulle en tant que personne — et il le précise dans le document
— mais bien à la philosophie institutionnelle que cette Constitution inaugure, qu’il juge
dangereusement autoritaire, voire pré-fasciste.
Ce qu’il redoute, ce n’est pas l’homme, mais
le système.
Il écrit ainsi : « Ce que je condamne, c’est un texte qui institue un régime
personnel.
Ce que je refuse, c’est un pouvoir présidentiel sans contrôle.
» À travers cette
phrase, il pointe une inversion de l’esprit républicain, où le président devient le centre du
pouvoir, et non plus un arbitre au-dessus des partis comme dans les précédentes
constitutions.
Historiquement, cette dénonciation prend tout son sens.
Depuis la Révolution
française, la République française a toujours été méfiante envers les pouvoirs personnels.
Le souvenir de Napoléon Bonaparte, élu consul puis autoproclamé empereur, ou celui de
Louis-Napoléon Bonaparte, élu président de la IIe République puis instigateur du coup d’État
du 2 décembre 1851, reste vif dans les mémoires politiques.
Mendès France fait clairement
le lien avec cette tradition de méfiance : en mettant en garde contre « une présidence sans
contrôle », il alerte sur le risque d’une dérive bonapartiste, où l’exécutif concentre tous les
leviers du pouvoir.
De plus, en 1958, le contexte est explosif : la guerre d’Algérie, la crise du
régime parlementaire, les manifestations militaires à Alger… Le retour de de Gaulle a été
perçu comme un recours providentiel, mais Mendès France refuse de sacrifier la démocratie
à la peur.
Il cible notamment les nouveaux pouvoirs attribués au président dans la
Constitution de 1958, dont certains sont encore en vigueur aujourd’hui, comme l’article
permettant au président de nommer le Premier Ministre ou alors le pouvoir de dissoudre
l’Assemblée nationale.Pour Mendès France, ces dispositions font du président un monarque
républicain.
Dans son article, il avertit : « Le président, au lieu d’être un arbitre, devient le
moteur de l’action.
» Cette phrase est clé : elle illustre comment la Constitution de 1958
rompt avec l’équilibre des pouvoirs voulu depuis la IIIe République.
Jusque-là, c’était le
Parlement qui était au centre de la vie politique.
Or, la IVe République, bien que critiquée
pour son instabilité, reposait sur ce principe d’une souveraineté législative, issue directement
du suffrage universel.
Mendès France défend cette tradition : pour lui, le Parlement doit
rester le cœur de la démocratie.
Il avait d’ailleurs été président du Conseil en 1954, élu par
les députés, et avait gouverné sans recourir à des ordonnances d’exception.
Face à lui, les
partisans de la nouvelle Constitution, notamment Michel Debré et de Gaulle lui-même,
défendent un exécutif fort pour mettre fin à l’instabilité ministérielle chronique : entre 1946 et
1958, pas moins de 24 gouvernements se sont succédé.
Mais Mendès France considère
que ce besoin d’efficacité ne peut justifier l’abandon du contrôle démocratique.
Il écrit dans
son texte : « On veut tout régler par le haut, au mépris de la délibération collective.
» Encore
une fois, c’est l’esprit républicain qu’il défend : celui où les lois sont faites par des
représentants élus, et non imposées par un homme, aussi prestigieux soit-il.
Sa position est
courageuse, car elle va à contre-courant de l’opinion publique.
En septembre 1958, de
Gaulle est vu comme le sauveur de la Nation.
L’appel au référendum donne au peuple le
sentiment d’un choix démocratique, mais Mendès France répond que le peuple est manipulé
par l’urgence et l’émotion.
Son article dans Le Monde tente d’opposer la raison politique à la
peur collective, et la vigilance démocratique à la tentation du pouvoir fort.
Enfin, on peut
rappeler que l’histoire lui a en partie donné raison : sous la Ve République, les présidents —
notamment François Mitterrand ou Jacques Chirac — ont utilisé les outils institutionnels pour
gouverner sans véritable débat parlementaire.....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- EXPOSE PETROLE ET GAZ NATUREL
- Qui montre son jeu risque de le perdre - GRACIÂN
- « On peut juger de la grandeur d'une nation par la façon dont les animaux y sont traités» Gandhi
- L1 : stabilité génétique et évolution clonale
- Qu'est ce que perdre son temps?