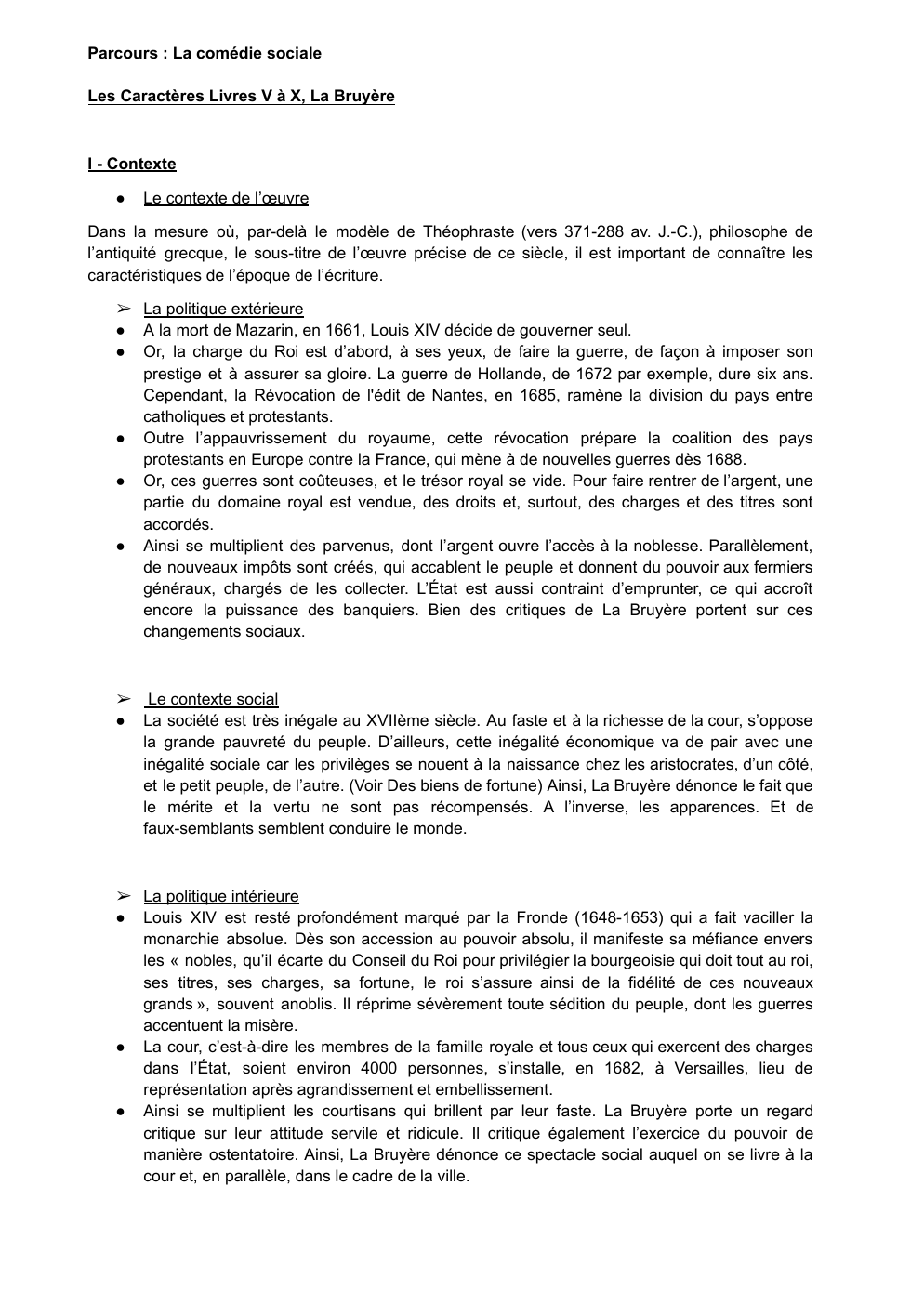Révision pour les Caractères de La Bruyère
Publié le 24/04/2025
Extrait du document
«
Parcours : La comédie sociale
Les Caractères Livres V à X, La Bruyère
I - Contexte
● Le contexte de l’œuvre
Dans la mesure où, par-delà le modèle de Théophraste (vers 371-288 av.
J.-C.), philosophe de
l’antiquité grecque, le sous-titre de l’œuvre précise de ce siècle, il est important de connaître les
caractéristiques de l’époque de l’écriture.
➢ La politique extérieure
● A la mort de Mazarin, en 1661, Louis XIV décide de gouverner seul.
● Or, la charge du Roi est d’abord, à ses yeux, de faire la guerre, de façon à imposer son
prestige et à assurer sa gloire.
La guerre de Hollande, de 1672 par exemple, dure six ans.
Cependant, la Révocation de l'édit de Nantes, en 1685, ramène la division du pays entre
catholiques et protestants.
● Outre l’appauvrissement du royaume, cette révocation prépare la coalition des pays
protestants en Europe contre la France, qui mène à de nouvelles guerres dès 1688.
● Or, ces guerres sont coûteuses, et le trésor royal se vide.
Pour faire rentrer de l’argent, une
partie du domaine royal est vendue, des droits et, surtout, des charges et des titres sont
accordés.
● Ainsi se multiplient des parvenus, dont l’argent ouvre l’accès à la noblesse.
Parallèlement,
de nouveaux impôts sont créés, qui accablent le peuple et donnent du pouvoir aux fermiers
généraux, chargés de les collecter.
L’État est aussi contraint d’emprunter, ce qui accroît
encore la puissance des banquiers.
Bien des critiques de La Bruyère portent sur ces
changements sociaux.
➢ Le contexte social
● La société est très inégale au XVIIème siècle.
Au faste et à la richesse de la cour, s’oppose
la grande pauvreté du peuple.
D’ailleurs, cette inégalité économique va de pair avec une
inégalité sociale car les privilèges se nouent à la naissance chez les aristocrates, d’un côté,
et le petit peuple, de l’autre.
(Voir Des biens de fortune) Ainsi, La Bruyère dénonce le fait que
le mérite et la vertu ne sont pas récompensés.
A l’inverse, les apparences.
Et de
faux-semblants semblent conduire le monde.
➢ La politique intérieure
● Louis XIV est resté profondément marqué par la Fronde (1648-1653) qui a fait vaciller la
monarchie absolue.
Dès son accession au pouvoir absolu, il manifeste sa méfiance envers
les « nobles, qu’il écarte du Conseil du Roi pour privilégier la bourgeoisie qui doit tout au roi,
ses titres, ses charges, sa fortune, le roi s’assure ainsi de la fidélité de ces nouveaux
grands », souvent anoblis.
Il réprime sévèrement toute sédition du peuple, dont les guerres
accentuent la misère.
● La cour, c’est-à-dire les membres de la famille royale et tous ceux qui exercent des charges
dans l’État, soient environ 4000 personnes, s’installe, en 1682, à Versailles, lieu de
représentation après agrandissement et embellissement.
● Ainsi se multiplient les courtisans qui brillent par leur faste.
La Bruyère porte un regard
critique sur leur attitude servile et ridicule.
Il critique également l’exercice du pouvoir de
manière ostentatoire.
Ainsi, La Bruyère dénonce ce spectacle social auquel on se livre à la
cour et, en parallèle, dans le cadre de la ville.
➢ Le contexte culturel
● Dans les Caractères, au début du premier chapitre Des ouvrages de l’esprit, La Bruyère
écrit :
- Il faut chercher seulement à penser et à parler juste, sans vouloir amener les autres à notre
goût et à nos sentiments ; c’est une grande entreprise.
Cette phrase reflète la conception
classique d’une permanence de la nature humaine, héritage des auteurs moralistes
antiques.
● Elle illustre surtout la situation littéraire à la fin du siècle, et les grands succès des auteurs
classiques moralistes La Rochefoucauld a publié ses Maximes en 1664, Boileau ses Satires
en 1666, Pascal ses Pensées en 1670, La Fontaine ses deux recueils de Fables en 1668 et
1678.
● Ainsi, partisan des Anciens, La Bruyère s’inscrit, par le regard sévère qu’il jette sur la société
de son époque, dans le mouvement moraliste de son temps, et c’est ce qui explique aussi le
succès de son ouvrage.
II - La composition
➢ Structure d’ensemble
● Les Caractères comptent seize chapitres ou livres.
Au programme : livres Và X
● Le premier chapitre, Des ouvrages de l’esprit », peut faire figure d’introduction, car il y
dégage le sérieux du métier d’écrivain et les qualités qu’on attend de lui.
● Les chapitres V à X, parcourent la société, depuis une vision d’ensemble, De la société et de
la conversation, puis l’accent est mis sur la place occupée par l’argent dans Des biens de
fortune, avant de suivre l’ordre social : De la ville, De la cour, Des grands, jusqu’à arriver au
sommet, Du souverain , ce qui explique toute l’organisation sociale.
➢ L’écriture fragmentaire
● Le choix du fragment impose un resserrement de l’écriture, la simplification pour ne retenir
que l’essentiel, le trait, le détail qui pourra signifier le tout.
Par la suite, La Bruyère procède
par accumulation, par énumération, par répétition.
● II laisse dans l’obscurité les détails secondaires, pour ne retenir que le détail signifiant.
La
Bruyère retient le trait qui fige et qui arrête.
Le caractère vise ainsi à la généralisation.
Les
Caractères tiennent donc leur originalité de l’alliance de deux genres, de deux modes
d’écriture : la maxime et le portrait.
- Le propre de la maxime est d’énoncer des vérités indiscutables.
Sa qualité tient à sa
brièveté.
Elle doit, pour fonctionner, contenir un contraste, une surprise, une pointe.
Les maximes retiennent l’attention par leur style, qui joue sur la recherche de l’effet
de surprise, proposant parfois des paradoxes ou des énigmes.
- Les portraits, eux, à la mode dans les salons, visent à divertir tout en soutenant les
maximes.
Ils suivent une dynamique théâtrale qui repose sur l’hyperbole jusqu’à la
chute dans la pointe, ce sont des esquisses de comédie, des scènes à un
personnage, à l’intrigue simplifiée.
● En fait, la forme choisie par La Bruyère illustre parfaitement cet art de la conversation qui
caractérise alors l’honnête homme.
Elle lui permet de varier les sujets abordés, afin de ne
jamais laisser les lecteurs s’ennuyer.
III - Enjeu du parcours « la comédie sociale »
➢ L’adjectif sociale dans l’intitulé du parcours le rattache directement aux chapitres étudiés
dans Les Caractères de La Bruyère, qui nous font découvrir les différentes classes sociales,
de la ville à la cour, et jusqu’au plus haut de l’État, à travers leurs occupations, telle la
conversation, et leurs mœurs».
➢ Le terme comédie, lui aussi, renvoie à la façon dont La Bruyère représente ironiquement la
société, comme il l’explique dans De la cour : Dans cent ans le monde subsistera encore en
son entier : ce sera le même théâtre et les mêmes décorations, ce ne seront plus les mêmes
acteurs.
Tout ce qui se réjouit sur une grâce reçue, ou ce qui s’attriste et se désespère sur
un refus, tous auront disparu de la scène.
Il s'avance déjà sur le théâtre d’autres hommes
qui vont jouer dans une même pièce les mêmes rôles ; ils s'évanouissent à leur tour ; et ceux
qui ne sont pas encore, un jour ne seront plus de nouveaux acteurs ont pris leur place.
Quel
fond à faire sur un personnage de comédie ! (99)
➢ Mais il reprend ainsi une vision déjà ancienne, Le monde entier est une scène, hommes et
femmes, tous n'y sont que des acteurs, chacun fait ses entrées, chacun fait ses sorties, et
notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles.
C’est dans la pensée grecque antique que
prend naissance cette comparaison de la société à un théâtre dans lequel chaque homme
joue un rôle.
L’importance de bien jouer ce rôle qu’il rattache à l’idée d’un ordre social
harmonieux.
Il ne s’agit pas alors de comédie, mais seulement d’une exigence morale, tout
le contraire donc de l’approche critique ultérieure.
IV - La satire, comédie sociale
➢ C’est donc à l’antiquité que renvoie la comparaison à une comédie, parce qu’est né, à Rome,
un autre genre littéraire, la satire qui a souvent mis en scène des réalités sociales pour
tourner en ridicule certaines personnes, des types humains ou les abus dans les mœurs.
➢ Ainsi l'adjectif satirique caractérise une tonalité qui associe des procédés comiques, à la
critique et la dénonciation.
V - Le classicisme
➢ Le classicisme, aussi bien chez La Fontaine par rapport aux fables d'Ésope, de Phèdre...
que chez La Bruyère avec Théophraste, accorde de l'importance aux Anciens, fondée sur
cette idée que la nature humaine est éternelle, s'adaptant bien sûr au contexte historique et
social.
➢ Une autre conception empruntée aux philosophes antiques est l'idée de juste mesure»,
empruntée à Aristote, qui renvoie à l'idéal de l'honnête homme propre au XVIIème siècle.
- L'honnête homme : qualités sociales (avoir une bonne réputation, être d’une
humeur douce/placidité, respect, humilité, bienveillance, éloquence), qualités
morales (probité, honnêteté, modestie, justice, piété, générosité), qualités
intellectuelles (culture, esprit, maîtrise de la rhétorique, sagesse, mesure, goût pour
la vérité).
➢ De plus, le classicisme vise deux objectifs: instruire et plaire.
- Pour plaire, les choix sont variés,....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La Bruyère écrit dans la Préface des Caractères : « Je rends au public ce qu'il m'a prêté; j'ai emprunté de lui la matière de cet ouvrage. » En concluriez-vous que l'ouvrage de La Bruyère est un livre d'observation rigoureusement impersonnel et que rien
- Un historien de la littérature française écrit : « La Bruyère, dans ses Caractères, imite bien les grands moralistes classiques, mais il innove par les raffinements et les nouveautés de son style, par le souci du détail concret, par les portraits et la p
- fiche révision plantes
- Fiche de révision Spleen IV Français Première
- THEME : LES CARACTÈRES ET LES MANIFESTATIONS DE LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE