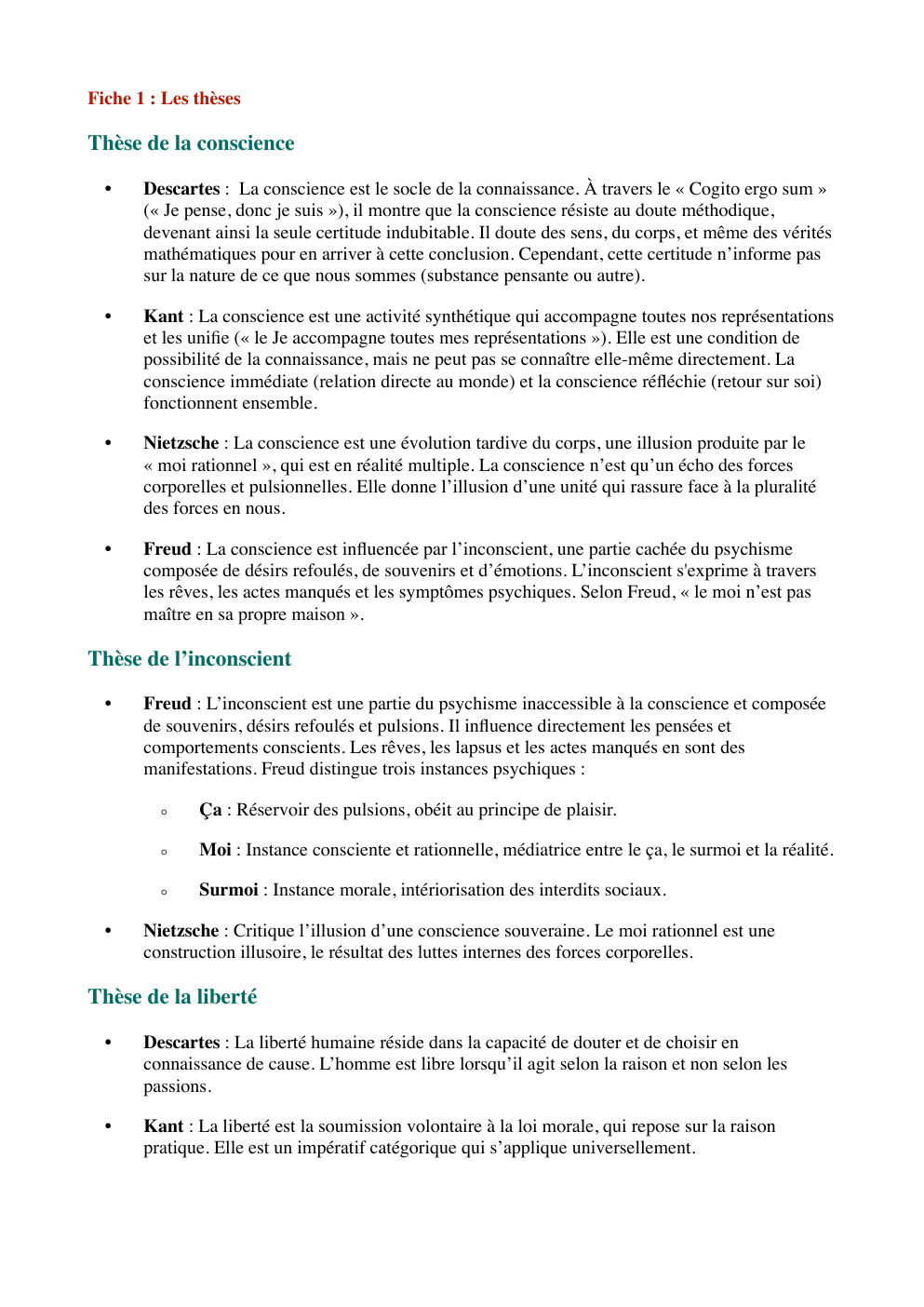Fiche 1 : Les thèses résumé, fiches de lecture
Publié le 23/01/2025
Extrait du document
«
Fiche 1 : Les thèses
Thèse de la conscience
•
Descartes : La conscience est le socle de la connaissance.
À travers le « Cogito ergo sum »
(« Je pense, donc je suis »), il montre que la conscience résiste au doute méthodique,
devenant ainsi la seule certitude indubitable.
Il doute des sens, du corps, et même des vérités
mathématiques pour en arriver à cette conclusion.
Cependant, cette certitude n’informe pas
sur la nature de ce que nous sommes (substance pensante ou autre).
•
Kant : La conscience est une activité synthétique qui accompagne toutes nos représentations
et les uni e (« le Je accompagne toutes mes représentations »).
Elle est une condition de
possibilité de la connaissance, mais ne peut pas se connaître elle-même directement.
La
conscience immédiate (relation directe au monde) et la conscience ré échie (retour sur soi)
fonctionnent ensemble.
•
Nietzsche : La conscience est une évolution tardive du corps, une illusion produite par le
« moi rationnel », qui est en réalité multiple.
La conscience n’est qu’un écho des forces
corporelles et pulsionnelles.
Elle donne l’illusion d’une unité qui rassure face à la pluralité
des forces en nous.
•
Freud : La conscience est in uencée par l’inconscient, une partie cachée du psychisme
composée de désirs refoulés, de souvenirs et d’émotions.
L’inconscient s'exprime à travers
les rêves, les actes manqués et les symptômes psychiques.
Selon Freud, « le moi n’est pas
maître en sa propre maison ».
Thèse de l’inconscient
•
•
Freud : L’inconscient est une partie du psychisme inaccessible à la conscience et composée
de souvenirs, désirs refoulés et pulsions.
Il in uence directement les pensées et
comportements conscients.
Les rêves, les lapsus et les actes manqués en sont des
manifestations.
Freud distingue trois instances psychiques :
◦
Ça : Réservoir des pulsions, obéit au principe de plaisir.
◦
Moi : Instance consciente et rationnelle, médiatrice entre le ça, le surmoi et la réalité.
◦
Surmoi : Instance morale, intériorisation des interdits sociaux.
Nietzsche : Critique l’illusion d’une conscience souveraine.
Le moi rationnel est une
construction illusoire, le résultat des luttes internes des forces corporelles.
•
Kant : La liberté est la soumission volontaire à la loi morale, qui repose sur la raison
pratique.
Elle est un impératif catégorique qui s’applique universellement.
fl
Descartes : La liberté humaine réside dans la capacité de douter et de choisir en
connaissance de cause.
L’homme est libre lorsqu’il agit selon la raison et non selon les
passions.
fl
•
fl
fi
Thèse de la liberté
•
Nietzsche : Remet en question la notion de liberté absolue.
Selon lui, les choix humains sont
déterminés par des pulsions et une volonté de puissance inconsciente.
Thèse de la raison
•
Platon : La raison (« logos ») est la partie noble de l'âme humaine, tournée vers les Idées
parfaites et éternelles.
Elle permet de contempler les vérités universelles, contrairement aux
perceptions sensibles, imparfaites et changeantes.
•
Descartes : La raison est universelle et permet, grâce au doute méthodique, d’atteindre des
vérités certaines.
Le raisonnement rationnel est infaillible lorsqu'il est guidé par une
méthode rigoureuse.
•
Kant : La raison humaine a des limites.
Elle est tentée par des illusions transcendantales
lorsqu'elle cherche à connaître des objets qui échappent à l'expérience (Dieu, l'âme, le
monde).
Elle doit se restreindre aux phénomènes sensibles pour rester légitime.
•
Pascal : La raison est in uencée par des forces extérieures comme l’imagination
(« maîtresse d'erreurs et de fausseté ») et la coutume, qui faussent les jugements.
Thèse de la science
•
Aristote : La science repose sur la démonstration par syllogisme, qui établit des vérités
nécessaires et universelles à partir de prémisses certaines.
•
Claude Bernard : La méthode scienti que repose sur un raisonnement hypothéticodéductif.
Elle comprend plusieurs étapes : observation, hypothèse, expérimentation et
contre-expérimentation.
Cette démarche vise à établir des lois universelles.
•
Popper : Une théorie est scienti que si elle est falsi able, c’est-à-dire si elle peut être mise
à l’épreuve par des expériences susceptibles de la réfuter.
•
Thomas Kuhn : La science évolue par des révolutions paradigmatiques.
Chaque paradigme
scienti que (ensemble de théories et de méthodes dominantes) est remplacé lorsque des
anomalies le remettent en question.
•
Nietzsche : La vérité n’est qu’une construction humaine destinée à servir des instincts de
domination.
Elle n’est pas absolue mais relative à des perspectives historiques et culturelles.
•
Spinoza : La vérité se détermine par elle-même : une idée vraie montre sa propre validité
sans recours extérieur.
Les erreurs viennent d’idées incomplètes ou inadéquates.
fi
Kant : La vérité est liée aux conditions transcendantales de la connaissance : nous ne
connaissons que les phénomènes, pas les choses en soi.
La vérité est une adéquation entre
nos concepts et l’expérience.
fi
•
fi
Descartes : La vérité repose sur l’évidence, c’est-à-dire ce qui est perçu de manière claire et
distincte par l’entendement.
L’erreur provient d’un déséquilibre entre volonté (in nie) et
entendement (limité).
fi
•
fl
fi
Thèse de la vérité
Fiche 2 : L’étymologie
Conscience
•
Latin « cum scientia » : Signi e « savoir avec », faisant référence à une connaissance
partagée ou une conscience de soi.
•
Conscience psychologique : Connaissance intuitive de ses états et actes.
•
Conscience morale : Capacité de discerner le bien du mal.
Raison
•
Grec « logos » : Parole, raison, logique, principe d’ordre.
•
Latin « ratio » : Calcul, mesure, raisonnement.
Science
•....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Fiche de lecture - Les Globalisations, P.N Giraud
- fiche de lecture manon lescaut 20/20
- fiche d'exemples et de thèses sur le roman pour les dissertations
- Fiche de lecture Utopia Thomas More
- Fiche lecture No et Moi de Delphine De Vigan