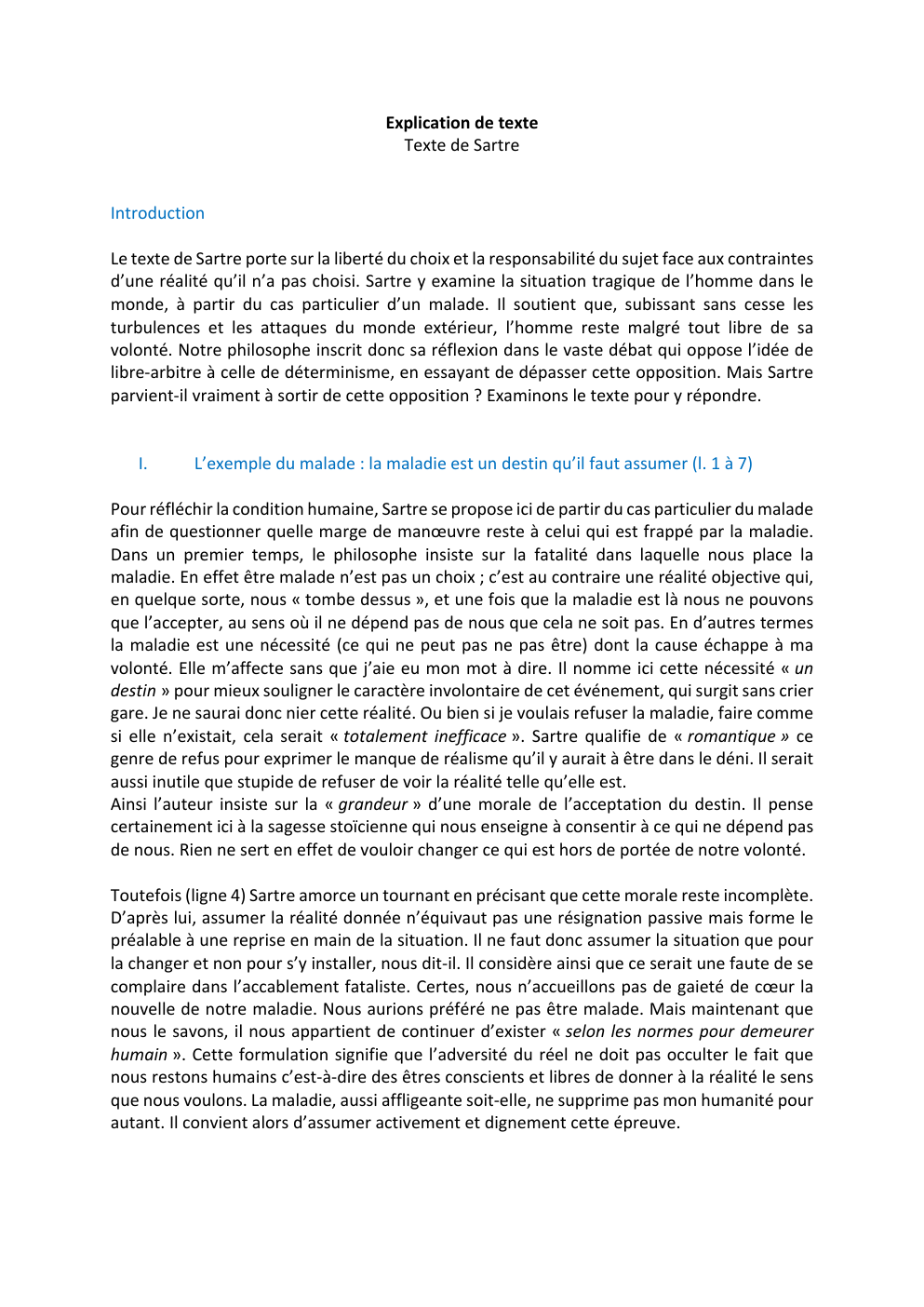Texte Sartre: L’exemple du malade
Publié le 27/03/2025
Extrait du document
«
Explication de texte
Texte de Sartre
Introduction
Le texte de Sartre porte sur la liberté du choix et la responsabilité du sujet face aux contraintes
d’une réalité qu’il n’a pas choisi.
Sartre y examine la situation tragique de l’homme dans le
monde, à partir du cas particulier d’un malade.
Il soutient que, subissant sans cesse les
turbulences et les attaques du monde extérieur, l’homme reste malgré tout libre de sa
volonté.
Notre philosophe inscrit donc sa réflexion dans le vaste débat qui oppose l’idée de
libre-arbitre à celle de déterminisme, en essayant de dépasser cette opposition.
Mais Sartre
parvient-il vraiment à sortir de cette opposition ? Examinons le texte pour y répondre.
I.
L’exemple du malade : la maladie est un destin qu’il faut assumer (l.
1 à 7)
Pour réfléchir la condition humaine, Sartre se propose ici de partir du cas particulier du malade
afin de questionner quelle marge de manœuvre reste à celui qui est frappé par la maladie.
Dans un premier temps, le philosophe insiste sur la fatalité dans laquelle nous place la
maladie.
En effet être malade n’est pas un choix ; c’est au contraire une réalité objective qui,
en quelque sorte, nous « tombe dessus », et une fois que la maladie est là nous ne pouvons
que l’accepter, au sens où il ne dépend pas de nous que cela ne soit pas.
En d’autres termes
la maladie est une nécessité (ce qui ne peut pas ne pas être) dont la cause échappe à ma
volonté.
Elle m’affecte sans que j’aie eu mon mot à dire.
Il nomme ici cette nécessité « un
destin » pour mieux souligner le caractère involontaire de cet événement, qui surgit sans crier
gare.
Je ne saurai donc nier cette réalité.
Ou bien si je voulais refuser la maladie, faire comme
si elle n’existait, cela serait « totalement inefficace ».
Sartre qualifie de « romantique » ce
genre de refus pour exprimer le manque de réalisme qu’il y aurait à être dans le déni.
Il serait
aussi inutile que stupide de refuser de voir la réalité telle qu’elle est.
Ainsi l’auteur insiste sur la « grandeur » d’une morale de l’acceptation du destin.
Il pense
certainement ici à la sagesse stoïcienne qui nous enseigne à consentir à ce qui ne dépend pas
de nous.
Rien ne sert en effet de vouloir changer ce qui est hors de portée de notre volonté.
Toutefois (ligne 4) Sartre amorce un tournant en précisant que cette morale reste incomplète.
D’après lui, assumer la réalité donnée n’équivaut pas une résignation passive mais forme le
préalable à une reprise en main de la situation.
Il ne faut donc assumer la situation que pour
la changer et non pour s’y installer, nous dit-il.
Il considère ainsi que ce serait une faute de se
complaire dans l’accablement fataliste.
Certes, nous n’accueillons pas de gaieté de cœur la
nouvelle de notre maladie.
Nous aurions préféré ne pas être malade.
Mais maintenant que
nous le savons, il nous appartient de continuer d’exister « selon les normes pour demeurer
humain ».
Cette formulation signifie que l’adversité du réel ne doit pas occulter le fait que
nous restons humains c’est-à-dire des êtres conscients et libres de donner à la réalité le sens
que nous voulons.
La maladie, aussi affligeante soit-elle, ne supprime pas mon humanité pour
autant.
Il convient alors d’assumer activement et dignement cette épreuve.
II.
Déduction : Ma liberté me contraint à vouloir ce que je n’ai pas voulu (l.
7 à 15).
Sartre reformule et synthétise alors les enseignements de son exemple.
Il commence par faire usage d’une formulation paradoxale, selon laquelle la liberté est
condamnation.
Une telle affirmation est en droit de nous surprendre tant nous avons plutôt
tendance à associer la liberté à une libération plutôt qu’à une condamnation.
Que veut-il dire
par là ? Il faut lire la suite pour le comprendre.
Reprenant l’alternance entre ce que nous subissons et ce que nous pouvons (ainsi…mais…),
Sartre rappelle d’une part que la maladie est d’abord un mauvais coup du sort que nous
n’avons pas choisi et qui n’est pas notre faute.
La question ne se pose pas ici de savoir si nous
aurions pu l’éviter.
Il s’agit de partir de l’hypothèse d’une affection involontaire et inévitable.
A cet égard, Sartre nous redit que bien sûr, je n’ai pas la liberté de faire qu’il en soit autrement.
Bref je ne choisis ni le monde, ni les situations auxquelles je suis être confronté.
Mais il ajoute
aussi que pourtant je suis libre et même que je suis contraint par ma liberté, ce qui redouble
le paradoxe de la condamnation à être libre, qu’il réitère aussi à la ligne 13 du texte.
Ce que
veut dire l’auteur ici, c’est que la liberté n’est pas une partie plaisir.
Elle ne consiste pas à faire
ce qu’on veut comme on veut.
Elle ne se définit pas par l’absence de contraintes.
Au contraire,
elle est une charge, un fardeau car elle implique que nous ayons à assumer toute une série de
choses que nous n’avons pas voulu.
C’est là le tragique de l’existence humaine : nous ne
choisissons pas les situations que nous avons à vivre mais nous avons pourtant l’obligation de
les vivre et de décider comment nous allons les vivre.
Nous sommes donc sans cesse amener
à nous positionner dans une réalité qui n’est pas conforme à nos désirs et pourtant nous
devons y réinscrire nos projets, réinventer de nouveaux possibles, nous adapter, nous
réajuster, pour continuer de vivre et d’agir malgré tout.
Nous sommes contraints de nous
approprier une réalité qui ne nous plaît pas forcément, et nous n’avons pas le choix de ne pas
le faire.
Bref, nous avons toujours le choix de la manière dont allons assumer la réalité subie
et le seul choix que nous n’avons pas est celui de ne pas choisir.
C’est en ce sens qu’il s’agit
d’une condamnation.
Je suis contraint de choisir toujours et quoi qu’il m’arrive.
L’un des
paradoxes de la liberté tient à ce qu’elle semble autoriser tous les choix sauf celui de renoncer
à elle-même.
D’ailleurs celui qui refuserait de choisir ou qui refuserait d’assumer ferait encore
un choix… Un choix certes très peu efficace, voire lâche, mais un choix quand même.
Ainsi le réel nous malmène, il nous heurte, nous déstabilise, détruit notre unité intérieure en
ce sens qu’il nous force en permanence à réviser nos choix, à accepter les changements (ne
serait-ce que parce que nous vieillissons, nous ne restons pas les mêmes, nos capacités
changent, nos contraintes aussi…).
Mais comme en même temps nous sommes conscients de
tout cela nous ne pouvons pas faire comme si de rien n’était.
Nous devons faire avec et
poursuivre notre trajectoire de vie....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- texte 4 - Molière, Le Malade imaginaire, III, 12 comm linéaire
- texte 2 - Molière, Le Malade imaginaire, I, 1
- Analyse Texte 1 Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, Olympe de Gouges ( 1791)
- explication de texte
- Texte de Hobbes : Explication de texte - Thèmes : le désir, le bonheur , la définition du bonheur