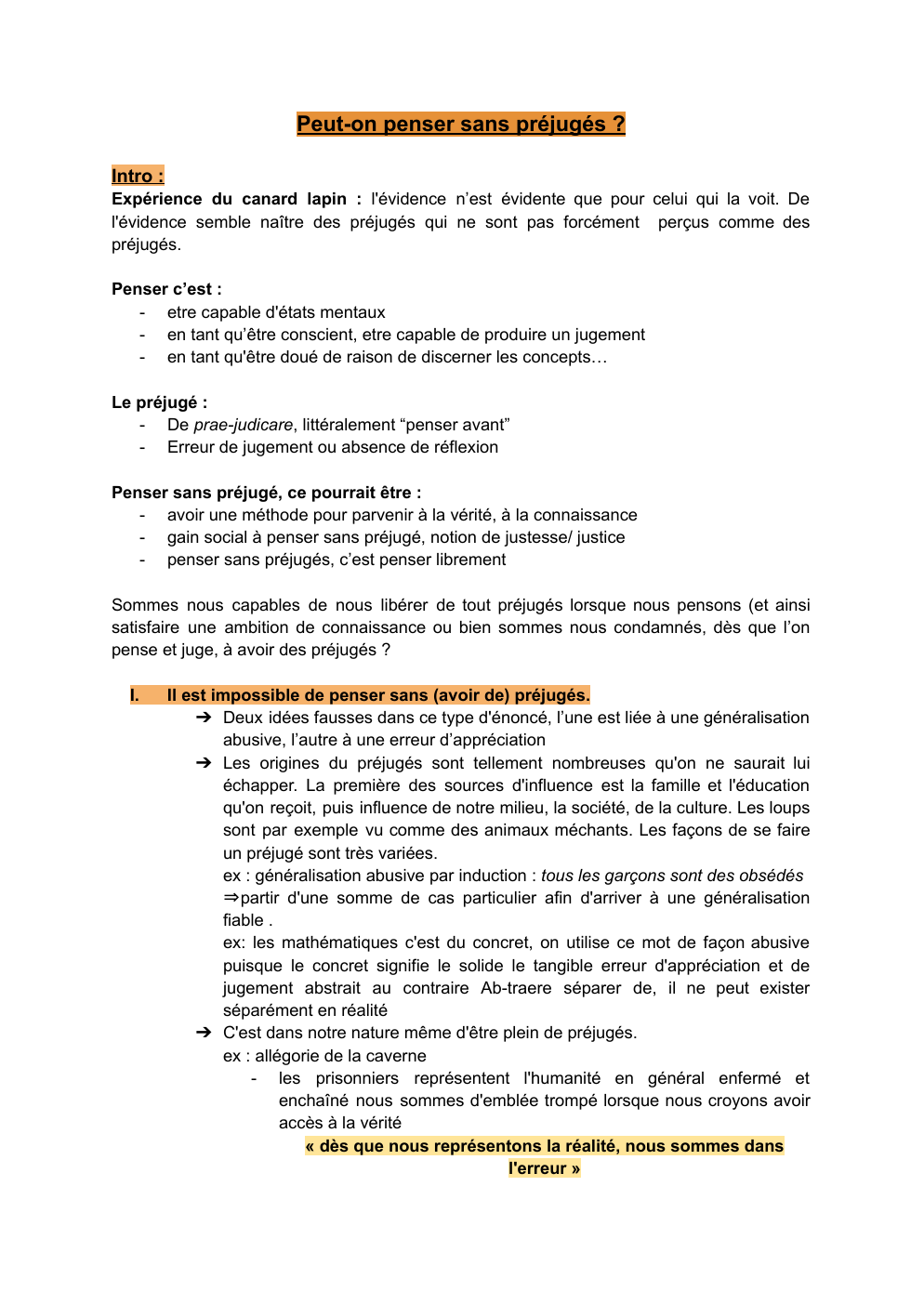Peut-on penser sans préjugés
Publié le 30/03/2025
Extrait du document
«
Peut-on penser sans préjugés ?
Intro :
Expérience du canard lapin : l'évidence n’est évidente que pour celui qui la voit.
De
l'évidence semble naître des préjugés qui ne sont pas forcément perçus comme des
préjugés.
Penser c’est :
- etre capable d'états mentaux
- en tant qu’être conscient, etre capable de produire un jugement
- en tant qu'être doué de raison de discerner les concepts…
Le préjugé :
- De prae-judicare, littéralement “penser avant”
- Erreur de jugement ou absence de réflexion
Penser sans préjugé, ce pourrait être :
- avoir une méthode pour parvenir à la vérité, à la connaissance
- gain social à penser sans préjugé, notion de justesse/ justice
- penser sans préjugés, c’est penser librement
Sommes nous capables de nous libérer de tout préjugés lorsque nous pensons (et ainsi
satisfaire une ambition de connaissance ou bien sommes nous condamnés, dès que l’on
pense et juge, à avoir des préjugés ?
I.
Il est impossible de penser sans (avoir de) préjugés.
➔ Deux idées fausses dans ce type d'énoncé, l’une est liée à une généralisation
abusive, l’autre à une erreur d’appréciation
➔ Les origines du préjugés sont tellement nombreuses qu'on ne saurait lui
échapper.
La première des sources d'influence est la famille et l'éducation
qu'on reçoit, puis influence de notre milieu, la société, de la culture.
Les loups
sont par exemple vu comme des animaux méchants.
Les façons de se faire
un préjugé sont très variées.
ex : généralisation abusive par induction : tous les garçons sont des obsédés
⇒partir d'une somme de cas particulier afin d'arriver à une généralisation
fiable .
ex: les mathématiques c'est du concret, on utilise ce mot de façon abusive
puisque le concret signifie le solide le tangible erreur d'appréciation et de
jugement abstrait au contraire Ab-traere séparer de, il ne peut exister
séparément en réalité
➔ C'est dans notre nature même d'être plein de préjugés.
ex : allégorie de la caverne
- les prisonniers représentent l'humanité en général enfermé et
enchaîné nous sommes d'emblée trompé lorsque nous croyons avoir
accès à la vérité
« dès que nous représentons la réalité, nous sommes dans
l'erreur »
-Platon
-
nous sommes tous victimes d'un préjugés fondamental
Les ombres peuvent représenter les jugements, les choses erronées qu'on a
sur le monde.
Nous fondons la manière de nous représenter le monde dans
nos sens.
C'est quelque chose d'immédiat de subjectif, pas de valeur d'un
point de vue objectif puisqu'elle est nécessairement erronée.
Etant donné que
les prisonniers croient savoir ce qu'elle avait été.
Ainsi, il est impossible de penser sans préjugés si l’on considère que :
- Le préjugés est irrésistible
- Les sources sont nombreuses
- Il est dans notre nature d’homme d'être plein de préjugés
II.
Il est possible de penser sans préjugés (si nous prenons conscience des
préjugés qui nous habitent )
1. On peut se libérer des préjugés à condition qu’on prenne conscience des
préjugés qui nous habitent
- La première étape a lieu lorsque le prisonnier est libéré.
On le détache
de ses chaînes qui représentent les préjugés qui nous maintiennent
dans l’ignorance⇒ anti-conformisme ou panurgisme
- Deuxièmement, les prisonniers sont libérés quand il comprend que les
ombres projetées et les échos qu’ils entendent proviennent d’un
montage artificiel auquel contribuent les marionnettistes (faiseurs
d’influence) et sont remis en question.
On devient alors capable
d’assumer notre responsabilité dans le jugement, de devenir maître/
maîtresse de nos pensées
- 3eme etape : Notre raison s’éveil
- 4eme : Le soleil représente le jugement pleinement objectif après
avoir tout remis en route ⇒ vérité, discernement, nouvelle aptitude
que l’on peut acquérir en outre de notre savoir (monde intelligible)
2. Le philosophe et les philosophes peuvent nous aider à nous libérer/détacher
des préjugés
“Je sais que je ne sais rien”
-Socrate
Le savoir est ici dans l’expression “je sais” ⇒ prise de conscience
Paradoxe socratique : (para doxa contre l’opinion) : Ce qui est
contradictoire mais appartient à une vision qui n’est pas habituelle.
- Sa vision de la connaissance : Le savoir n’est pas un ensemble de
formules que l’on peut écrire, communiquer vendre toutes faites
- Son intention : faire reconnaître à son interlocuteur qu’il ne sait pas
et qu’il croit savoir.
Le philosophe ne sait rien, mais il est conscient de
son non-savoir.
Socrate s’oppose aux savants ayant une conception
élitistes du savoir.
Mais également aux démocrates du savoir ou
sophistes (maîtres en rhétorique, ils prétendent pouvoir vendre le
savoir à qui veut l’acheter )
Dans Le banquet (platon) : image de la transmission de
connaissances d’un vase à un autre.
L’authentique savoir n’est pas
quelque chose qui se fige dans un écrit.
On perdrait quelque chose de
transcrire ce savoir à l'écrit.
Ce n’est pas quelque chose que l’on va
pouvoir vendre, qui se monnaie.
Ce qui expliquerait notre ignorance, est le trop plein d’informations, notre ignorance est liée
à nos préjugés, aux préjugés qui embrassent notre pensée et non pas un vide.
Ironie socratique : Socrate va toujours avoir le rôle de celui qui questionne.
L’ironie
socratique est finalement une ignorance qui est feinte.
Il fait semblant d’être idiot” puis
finalement il pointe les éléments qui ne fonctionne pas.
Le Théétète
Maïeutique socratique : accouchement des esprits, c’est à l’individu lui-même de découvrir
ce savoir.
La remise en question de soi-même ne naît que dans un dépassement de son
individualité qui se hausse au niveau de l’universalité.
C’est une mise au monde
douloureuse, éprouvante pour quelqu’un qui va accoucher : Cela traduit l’idée que l’on doit
remettre en question ses propres opinions.
accepté d’être contredit.
Cette contradiction
passé par le doute, une remise en question.
Lorsqu’on doute on a l’impression que rien est
tangible.
L’un des piliers de la Philo est l’humilité puisqu’il faut accepter l'épreuve du doute.
Socrate serait comme une sage-femme puisqu’il n’a pas le premier rôle, il est là en soutien,
en accompagnement et ce n’est pas à lui de délivrer un savoir.
A l’epoque pour etre sage
femme il fallait etre stérile ⇒ Socrate est stérile de savoir et doit etre bienveillant envers ses
interlocueturs.
Ménon ou de la vertu, Socrate
Ménon compare Socrate à un poisson torpille et à un sorcier.
Il lui reproche de le faire
douter.
Menon fait partie des sophistes et ils sont doués pour se moquer et tourner en ridicule ici,
l’enjeu est de se moquer de Socrate.
Socrate est confronté à des apories (discussions qui
n’a pas de fin, impasse de pensée) soit car il n’a pas de solutions aux problèmes soit parce
que, comme Ménon, il se refuse à la discussion.
Ainsi, il s’agit moins d'acquérir un savoir nouveau à propos de ce dont on parle que de se
remettre par cette réflexion soit-même en question.
Cette image de la maïeutique bien pour
intérêt que c'est à l’individu lui-met de faire l'épreuve de la découverte.
remise en question
de nos préjugés préalables
3. a) La culture de l’étonnement ou de l’esprit critique
- L'étonnement n’est pas la curiosité.
Souvent en tant qu’adulte ou
jeune adulte, nous sommes plus facilement curieux que dans cette
posture d'étonnement.
Ce qui explique cela est que....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Peut-on penser sans préjugés ?
- On dit souvent pour expliquer, ou même excuser, un comportement humain : « c'est naturel ? ». Quel est le sens de cette expression ? Que faut-il en penser ?
- Connaître et penser chez Kant
- Kant: penser, la Critique de la Raison Pure
- Merleau-Ponty: Il est impossible de penser objectivement autrui