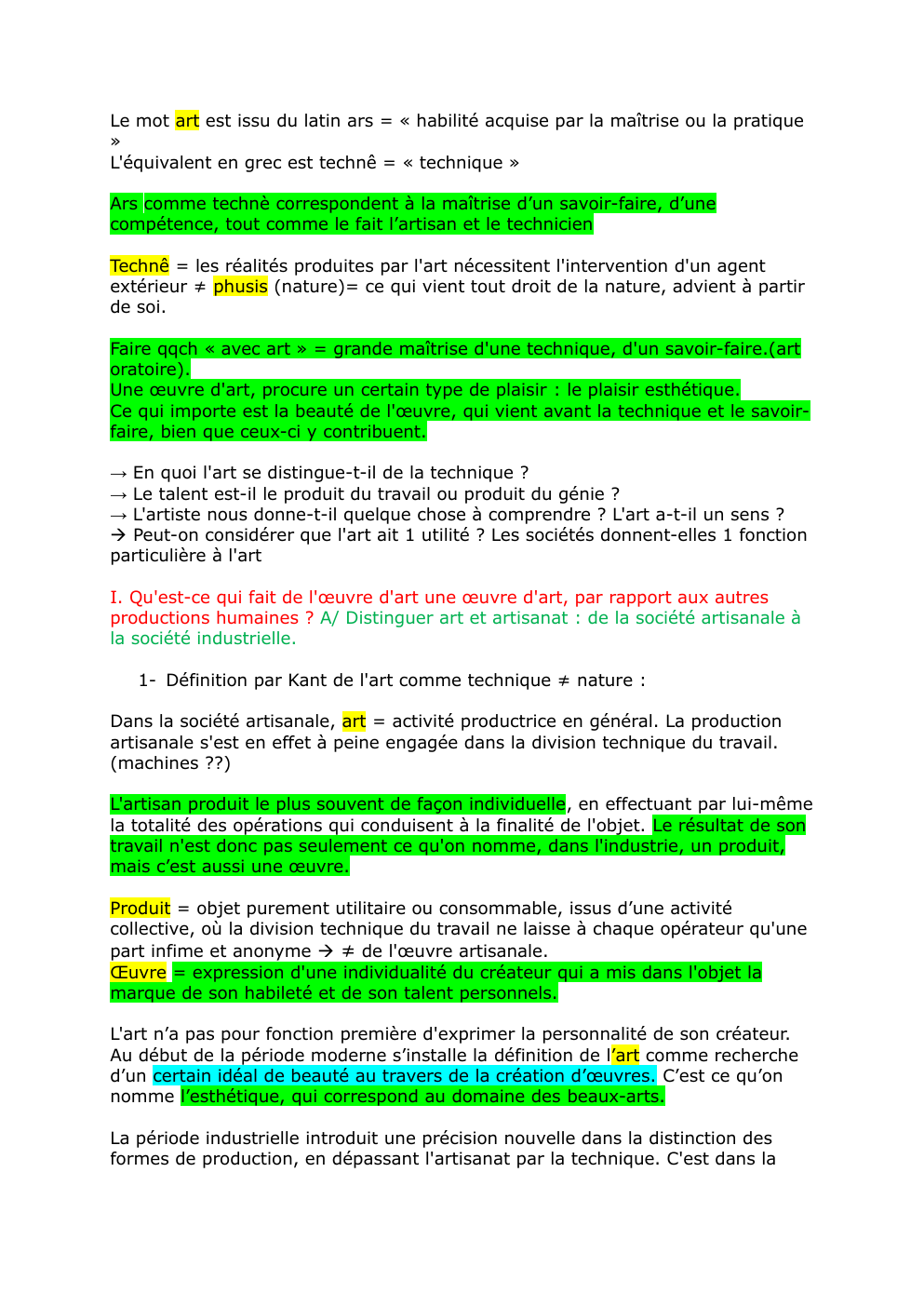Cours de philosophie - L'ART (notes, fiche de révision)
Publié le 16/04/2025
Extrait du document
«
Le mot art est issu du latin ars = « habilité acquise par la maîtrise ou la pratique
»
L'équivalent en grec est technê = « technique »
Ars comme technè correspondent à la maîtrise d’un savoir-faire, d’une
compétence, tout comme le fait l’artisan et le technicien
Technê = les réalités produites par l'art nécessitent l'intervention d'un agent
extérieur ≠ phusis (nature)= ce qui vient tout droit de la nature, advient à partir
de soi.
Faire qqch « avec art » = grande maîtrise d'une technique, d'un savoir-faire.(art
oratoire).
Une œuvre d'art, procure un certain type de plaisir : le plaisir esthétique.
Ce qui importe est la beauté de l'œuvre, qui vient avant la technique et le savoirfaire, bien que ceux-ci y contribuent.
→ En quoi l'art se distingue-t-il de la technique ?
→ Le talent est-il le produit du travail ou produit du génie ?
→ L'artiste nous donne-t-il quelque chose à comprendre ? L'art a-t-il un sens ?
Peut-on considérer que l'art ait 1 utilité ? Les sociétés donnent-elles 1 fonction
particulière à l'art
I.
Qu'est-ce qui fait de l'œuvre d'art une œuvre d'art, par rapport aux autres
productions humaines ? A/ Distinguer art et artisanat : de la société artisanale à
la société industrielle.
1- Définition par Kant de l'art comme technique ≠ nature :
Dans la société artisanale, art = activité productrice en général.
La production
artisanale s'est en effet à peine engagée dans la division technique du travail.
(machines ??)
L'artisan produit le plus souvent de façon individuelle, en effectuant par lui-même
la totalité des opérations qui conduisent à la finalité de l'objet.
Le résultat de son
travail n'est donc pas seulement ce qu'on nomme, dans l'industrie, un produit,
mais c’est aussi une œuvre.
Produit = objet purement utilitaire ou consommable, issus d’une activité
collective, où la division technique du travail ne laisse à chaque opérateur qu'une
part infime et anonyme ≠ de l'œuvre artisanale.
Œuvre = expression d'une individualité du créateur qui a mis dans l'objet la
marque de son habileté et de son talent personnels.
L'art n’a pas pour fonction première d'exprimer la personnalité de son créateur.
Au début de la période moderne s’installe la définition de l’art comme recherche
d’un certain idéal de beauté au travers de la création d’œuvres.
C’est ce qu’on
nomme l’esthétique, qui correspond au domaine des beaux-arts.
La période industrielle introduit une précision nouvelle dans la distinction des
formes de production, en dépassant l'artisanat par la technique.
C'est dans la
deuxième moitié du XVIIIe siècle que le terme de technique s'ajoute à celui d'art.
Celui-ci désigne une réalité nouvelle
Chez Aristote, l'art est productif, et se distingue des sciences, qui sont purement
contemplatives et théoriques.
Chez Kant, les règles de la pratique technique ont pour fonction « de produire un
effet, qui est possible d'après un concept naturel de la cause à l'effet.
» La
technique est ainsi définie comme une science appliquée où l'efficacité de l'action
humaine est le résultat de la connaissance de la nature d'après le principe du
déterminisme des lois naturelles.
2- Art ≠ technique :
Par opposition au travail artisanal, qui est défini comme « mercantile » parce
qu'il ne serait fait que pour l'appât du gain, l'art apparaît « agréable par luimême ».
Il relève ainsi des activités de jeu, ce qui le défini en tant qu'activité
gratuite.
Kant reprend l'expression d'art libéral, qui sert déjà à Diderot à distinguer les «
Beaux-Arts » des arts mécaniques ou industriels.
Notre civilisation voit donc se développer côte à côte l'art de l'artisan et l'art de
l'artiste, les arts mécaniques ou industriels et les arts libéraux, les premiers
produisant des biens d'usage ou de consommation, les seconds des œuvres
belles.
« En général, dès qu'une chose devient utile, elle cesse d'être belle.
» Théophile
Gautier.
(beauté)
Elle met en évidence la distinction entre l'art qui est produit pour son utilité et
l'art qui est créé uniquement pour sa beauté, dépendant de toute fonction
pratique.
L'art pour l'art.
Ce concept soutient que l'art n'a pas d'autre vocation que de
produire du beau, et qu'il doit être jugé uniquement sur cette base.
Selon cette
vision, l'art ne doit pas chercher à transmettre un message moral, politique ou
social, ni à remplir une fonction utilitaire, mais se suffire à lui-même en tant que
recherche esthétique.
B/ L'esthétique, ou la science du beau.
Aussi, l'art, issu de l'idée des Beaux-Arts, a pour particularité de créer du beau.
Mais qu'est-ce que la beauté ? La beauté relève-t-elle uniquement du plaisir des
sens ?
1- La vision antique : le Beau, objectif et universel.
Nous apprécions une œuvre d'art par les sens, mais ceux-ci font alors intervenir
le jugement esthétique, qui est la seule sensibilité.
En effet, une œuvre d'art ne se consomme pas, elle n'est pas un bien de
consommation.
Ceci dit, harmonie des couleurs, symétrie, finesse des traits,
proportion, participent de la beauté d'un objet.
Esthétique = (grec aesthesis = sensation) discipline qui s'occupe des arts et des
jugements que l'on peut avoir sur les œuvres.
Platon : dans Le Banquet décrit l'itinéraire de celui qui, parti du désir initial
des belles choses, est amené à prendre conscience que c'est au fond une idée,
l'idée du Beau, qui est la vraie source du désir qui nous mène à aimer les objets
d'art : désir de nature spirituelle.
Chez les Anciens, le beau est défini comme une symétrie parfaite des formes, le
fait d'atteindre la perfection.
Aussi, pour Aristote, les objets mathématiques,
puisqu'ils sont parfaits, relèvent eux aussi du beau.
Il y a dans le concept de
beauté l'intervention de l'intellect, de l'intelligence humaine.
2- La vision de Kant : le Beau est subjectif et universel.
→ Le goût est-il relatif ou universel ?
Le goût est la faculté de juger un objet ou une représentation par une
satisfaction dégagée de tout intérêt (…)
« Le beau est ce qui est représenté, sans concept, comme l'objet d'une
satisfaction universelle.
»
La citation signifie que le beau est perçu sans recours à des concepts intellectuels
mais uniquement à travers une expérience immédiate et esthétique.
En effet, celui qui éprouve une satisfaction désintéressée à propos de quelque
chose ne peut s'empêcher de penser que cette même chose devrait procurer la
même satisfaction à tout le monde
Le jugement esthétique, ou le goût, est donc à la fois subjectif et universel.
Mais
si le jugement de goût était seulement subjectif, alors tout et n'importe quoi peut
être beau, pourvu que quelqu'un puisse l'apprécier ?
Pour Kant : la matière sensible de l'objet (couleur, texture) est indifférente : ce
que nous trouvons beau c'est une forme pure → les œuvres sollicitent le plaisir
des sens, mais c'est un plaisir qui se mêle à un plaisir d'une autre nature, un
plaisir intellectuel, ou spirituel.
Le critère du plaisir pour désigner et spécifier l'art n'est pas suffisant : il peut
aussi bien désigner l'activité du cuisinier, qui vise lui aussi le plaisir des sens.
Kant distingue :
- Art d'agrément = plaisir intéressé → on tire jouissance et plaisir de l'objet
qui nous les procure ; on le consomme.
- Art esthétique = plaisir désintéressé → ne se consomme pas.
Kant : le jugement esthétique est un jugement de goût, qui se distingue du
jugement de connaissance, car il ne dépend pas des caractéristiques de l'objet.
(Kant : le jugement esthétique est désintéressé et subjectif, fondé sur le plaisir
éprouvé par la forme de l'objet.)
Le plaisir procuré par une œuvre d'art ne peut pas satisfaire un besoin, un désir.
Hegel : le plaisir esthétique est désintéressé : il repose sur la contemplation de
l'œuvre, sans désir de possession ni consommation, laissant l'objet intact.
≠
plaisir procuré par la consommation de l'objet désiré.
Le jugement esthétique
n'est pas intellectuel.
C/ Le beau artistique se distingue-t-il du beau de la nature ?
→ L'art, même s'il imite parfois la nature, nous procure un sentiment
d'admiration et d'agrément, qui n'est pas le même lorsque nous sommes face à
un paysage.
ARISTOTE : Il est plaisant de voir le produit de l'habileté humaine reproduire un
objet de la nature.
C'est cela qui procure le sentiment de plaisir à l'origine du
sentiment du beau (« c'est bien cela »).
Dans La Poétique : l'art imite la nature,
et les humains s'entourent de représentation de choses du monde.
→ L'imitation a fonction de connaissance : on reproduit ce qu'on a vu pour le
partager, par exemple.
Mais aussi elle procure du plaisir, un plaisir esthétique.
HEGEL → Beau artistique supérieur au beau naturel.
→ Esthétique : L'art ne se contente pas d'imiter le réel, il en augmente notre
perception.
Incarnation d'une idée, d'une grandeur humaine, dans l'œuvre d'art.
Hegel : l'art « idéalise la nature », il élève la réalité (= la sublimer), donne un
sens à ce qui, dans la vie ordinaire, demeure insignifiant.
Art = transfiguration du réel.
=> Transformation d'un être qui....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'art (cours - Notes)
- Cours de philosophie: L'ART ?
- [Affinités de l'art et de la philosophie] Bergson
- La philosophie contemporaine (cours)
- l'etat fiche philosophie