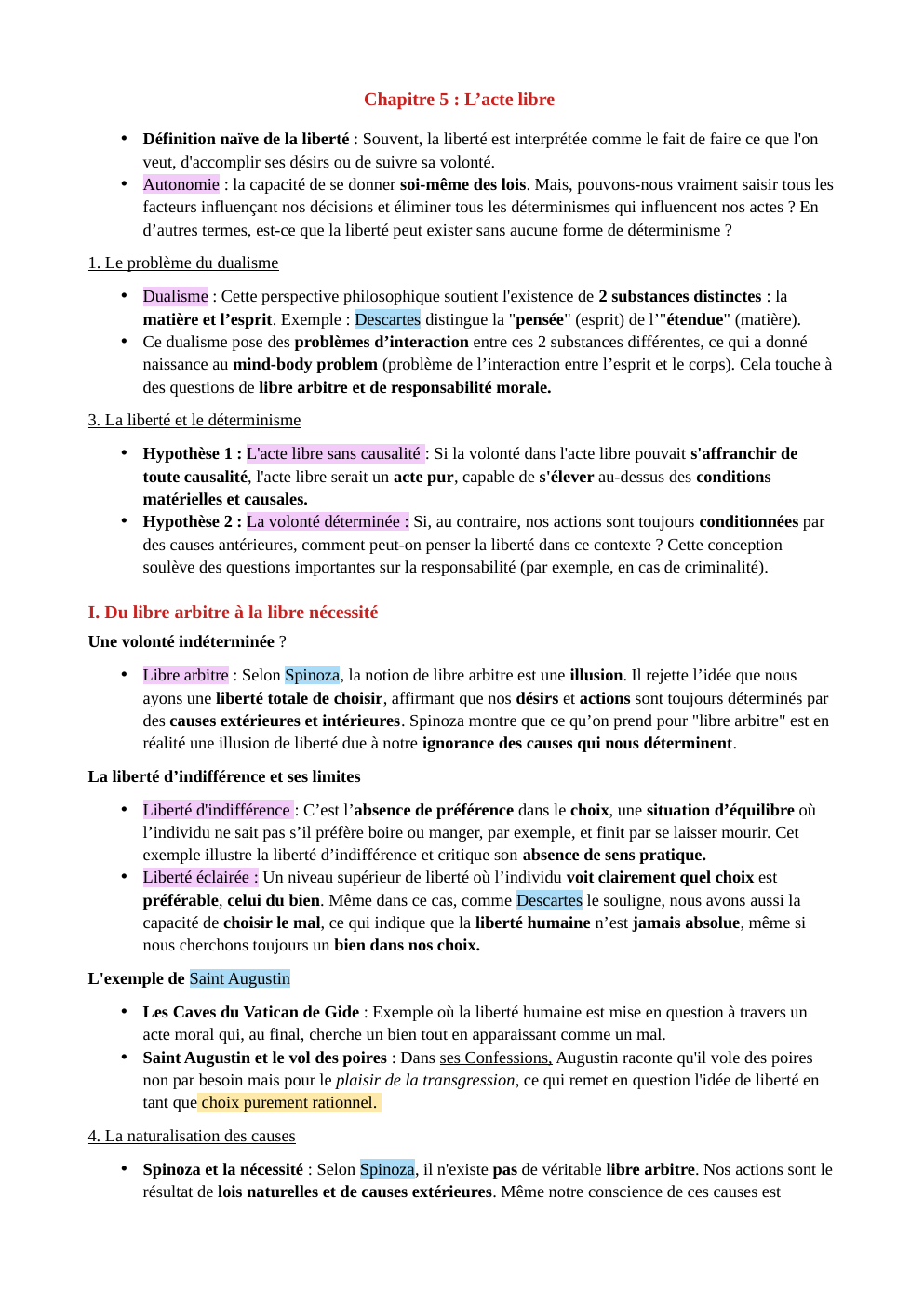Chapitre 5 : L’acte libre
Publié le 15/04/2025
Extrait du document
«
Chapitre 5 : L’acte libre
• Définition naïve de la liberté : Souvent, la liberté est interprétée comme le fait de faire ce que l'on
veut, d'accomplir ses désirs ou de suivre sa volonté.
• Autonomie : la capacité de se donner soi-même des lois.
Mais, pouvons-nous vraiment saisir tous les
facteurs influençant nos décisions et éliminer tous les déterminismes qui influencent nos actes ? En
d’autres termes, est-ce que la liberté peut exister sans aucune forme de déterminisme ?
1.
Le problème du dualisme
• Dualisme : Cette perspective philosophique soutient l'existence de 2 substances distinctes : la
matière et l’esprit.
Exemple : Descartes distingue la "pensée" (esprit) de l’"étendue" (matière).
• Ce dualisme pose des problèmes d’interaction entre ces 2 substances différentes, ce qui a donné
naissance au mind-body problem (problème de l’interaction entre l’esprit et le corps).
Cela touche à
des questions de libre arbitre et de responsabilité morale.
3.
La liberté et le déterminisme
• Hypothèse 1 : L'acte libre sans causalité : Si la volonté dans l'acte libre pouvait s'affranchir de
toute causalité, l'acte libre serait un acte pur, capable de s'élever au-dessus des conditions
matérielles et causales.
• Hypothèse 2 : La volonté déterminée : Si, au contraire, nos actions sont toujours conditionnées par
des causes antérieures, comment peut-on penser la liberté dans ce contexte ? Cette conception
soulève des questions importantes sur la responsabilité (par exemple, en cas de criminalité).
I.
Du libre arbitre à la libre nécessité
Une volonté indéterminée ?
• Libre arbitre : Selon Spinoza, la notion de libre arbitre est une illusion.
Il rejette l’idée que nous
ayons une liberté totale de choisir, affirmant que nos désirs et actions sont toujours déterminés par
des causes extérieures et intérieures.
Spinoza montre que ce qu’on prend pour "libre arbitre" est en
réalité une illusion de liberté due à notre ignorance des causes qui nous déterminent.
La liberté d’indifférence et ses limites
• Liberté d'indifférence : C’est l’absence de préférence dans le choix, une situation d’équilibre où
l’individu ne sait pas s’il préfère boire ou manger, par exemple, et finit par se laisser mourir.
Cet
exemple illustre la liberté d’indifférence et critique son absence de sens pratique.
• Liberté éclairée : Un niveau supérieur de liberté où l’individu voit clairement quel choix est
préférable, celui du bien.
Même dans ce cas, comme Descartes le souligne, nous avons aussi la
capacité de choisir le mal, ce qui indique que la liberté humaine n’est jamais absolue, même si
nous cherchons toujours un bien dans nos choix.
L'exemple de Saint Augustin
• Les Caves du Vatican de Gide : Exemple où la liberté humaine est mise en question à travers un
acte moral qui, au final, cherche un bien tout en apparaissant comme un mal.
• Saint Augustin et le vol des poires : Dans ses Confessions, Augustin raconte qu'il vole des poires
non par besoin mais pour le plaisir de la transgression, ce qui remet en question l'idée de liberté en
tant que choix purement rationnel.
4.
La naturalisation des causes
• Spinoza et la nécessité : Selon Spinoza, il n'existe pas de véritable libre arbitre.
Nos actions sont le
résultat de lois naturelles et de causes extérieures.
Même notre conscience de ces causes est
partielle.
En d'autres termes, notre liberté se résume à une illusion, car nous ne sommes pas
conscients des causes qui nous déterminent.
5.
Liberté et déterminisme
• Liberté vs.
Déterminisme : La liberté se définit par l'absence de contraintes externes ou de
facteurs antérieurs déterminants, tandis que le déterminisme implique que tout acte est conditionné
par des causes antérieures.
Cette dichotomie met en lumière l’enjeu de la responsabilité et de la
justice dans la société, en particulier lorsqu’il s'agit de comprendre la culpabilité et les choix
criminels.
6.
L'importance de la connaissance et de la raison
• Connaissance et liberté : Plus nous comprenons les influences qui nous déterminent, plus nous
pouvons agir librement.
Pour Spinoza, la liberté véritable vient de la compréhension des causes et
de la manière dont elles influencent nos actions.
• La joie : Spinoza associe la liberté à la joie, qui est le signe de l'augmentation de notre puissance
d'agir.
La joie reflète un état de liberté intérieur, obtenu par la connaissance des causes externes
et internes.
Les approches possibles pour résoudre cette tension
• Déterminisme dur (compatibilité impossible) : Tout est causé, donc la liberté est une
illusion.
• Liberté absolue (indéterminisme radical) : Certains choix sont totalement indépendants des
causes antérieures (mais cela soulève la question du hasard pur)→ à approfondir
• Compatibilisme (conciliation possible) : On peut être libre même si nos choix sont
déterminés, à condition de les réaliser sans contrainte immédiate.
Par ex, agir en accord
avec ses désirs profonds est une forme de liberté, même si ces désirs sont déterminés.
II.
La réduction matérialiste
1.
L’esprit est un corps (Lucrèce)
Le matérialisme soutient que tout ce qui existe est de nature matérielle, y compris l’esprit.
Pour les
matérialistes, il n’y a pas de distinction fondamentale entre l’esprit et le corps.
• Lucrèce (philosophe romain, disciple d’Épicure) :
Dans son œuvre De natura rerum (De la nature des choses), Lucrèce reprend la philo d’Épicure et
développe une vision atomiste du monde.
Selon lui, tout ce qui existe est composé d’atomes et de
vide.
L’âme et l’esprit sont également constitués d’atomes, mais plus subtils et plus mobiles que
ceux du corps.
• Pas de finalité : Le monde est le résultat de rencontres aléatoires d’atomes, sans dessein ni
finalité.
• Pas de vie après la mort : À la mort, l’âme se désintègre comme le corps.
Il n’y a ni
jugement ni survie après la mort.
• L’esprit comme assemblage d’atomes : L’esprit est une partie de l’âme, siège de la raison
et des sentiments.
Il assure la coordination des organes du corps.
• Simulacres : Les perceptions sensorielles sont expliquées par des "simulacres", de fines
pellicules qui émanent des objets et atteignent nos sens.
• Clinamen (déclinaison des atomes) :
Lucrèce introduit l’idée de clinamen, une déviation aléatoire des atomes dans leur trajectoire.
Cette
déviation permet d’expliquer la formation des corps et des mondes, et introduit une forme de nondéterminisme dans un univers par ailleurs régi par des lois strictes.
• Propriétés émergentes : Bien que Lucrèce ne parle pas explicitement de propriétés
émergentes (concept du XXe siècle), on peut interpréter sa pensée comme suggérant que la
liberté de l’esprit est une propriété émergente de l’assemblage complexe des atomes.
2.
La sujétion de l’esprit à la matière (D’Holbach)
• D’Holbach (philosophe matérialiste du XVIIIe siècle) :
Dans Système de la nature, D’Holbach affirme que l’esprit est entièrement soumis à la matière.
• Illusion du libre arbitre : Selon lui, l’idée d’un acte libre est une illusion.
Tout ce que nous
faisons est déterminé par des causes matérielles.
• L’esprit comme produit du cerveau : L’esprit est le résultat de l’organisation matérielle
du cerveau.
Il n’a pas d’existence indépendante.
• Argument syllogistique :
• Tout ce qui a une étendue, une solidité et des parties distinctes est matériel.
• L’esprit a une étendue, une solidité et des parties distinctes.
• Donc, l’esprit est matériel.
• Postérité :
Les neurosciences modernes, avec des concepts comme la plasticité cérébrale (capacité du
cerveau à se reconfigurer), semblent confirmer l’idée que l’esprit est profondément lié à la matière.
3.
Le matérialisme historique (Marx)
• Marx :
Marx, considéré comme l’un des "maîtres du soupçon" (avec Nietzsche et Freud), remet en cause la
transparence et la souveraineté de la conscience.
• Déterminisme social : Pour M, ce sont les conditions matérielles et sociales (la
"superstructure") qui déterminent la conscience des individus.
Les idées, les croyances et les
valeurs sont le reflet des rapports de production et des structures économiques.
• Religion comme "opium du peuple" : La religion est vue comme un outil de justification de
l’ordre social, apaisant les souffrances des opprimés et les empêchant de....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Un acte libre est-il un acte imprévisible ?
- Peut-il exister un acte libre ?
- A quoi reconnaît-on un acte libre?
- Qu'est ce qu'un acte libre?
- Caractères de l'acte volontaire et libre ?