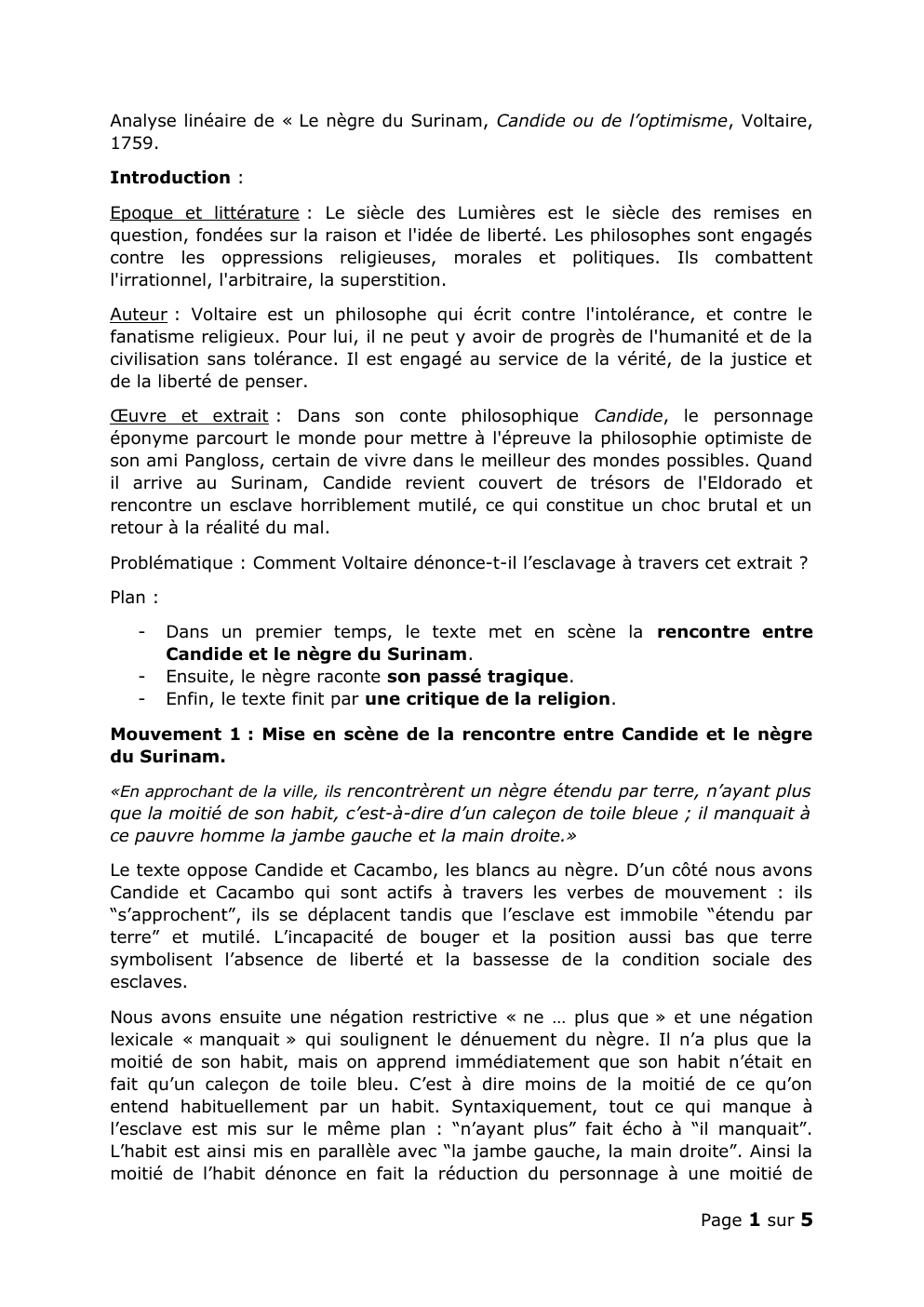Analyse linéaire de « Le nègre du Surinam, Candide ou de l’optimisme, Voltaire, 1759.
Publié le 07/04/2025
Extrait du document
«
Analyse linéaire de « Le nègre du Surinam, Candide ou de l’optimisme, Voltaire,
1759.
Introduction :
Epoque et littérature : Le siècle des Lumières est le siècle des remises en
question, fondées sur la raison et l'idée de liberté.
Les philosophes sont engagés
contre les oppressions religieuses, morales et politiques.
Ils combattent
l'irrationnel, l'arbitraire, la superstition.
Auteur : Voltaire est un philosophe qui écrit contre l'intolérance, et contre le
fanatisme religieux.
Pour lui, il ne peut y avoir de progrès de l'humanité et de la
civilisation sans tolérance.
Il est engagé au service de la vérité, de la justice et
de la liberté de penser.
Œuvre et extrait : Dans son conte philosophique Candide, le personnage
éponyme parcourt le monde pour mettre à l'épreuve la philosophie optimiste de
son ami Pangloss, certain de vivre dans le meilleur des mondes possibles.
Quand
il arrive au Surinam, Candide revient couvert de trésors de l'Eldorado et
rencontre un esclave horriblement mutilé, ce qui constitue un choc brutal et un
retour à la réalité du mal.
Problématique : Comment Voltaire dénonce-t-il l’esclavage à travers cet extrait ?
Plan :
-
Dans un premier temps, le texte met en scène la rencontre entre
Candide et le nègre du Surinam.
Ensuite, le nègre raconte son passé tragique.
Enfin, le texte finit par une critique de la religion.
Mouvement 1 : Mise en scène de la rencontre entre Candide et le nègre
du Surinam.
«En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre, n’ayant plus
que la moitié de son habit, c’est-à-dire d’un caleçon de toile bleue ; il manquait à
ce pauvre homme la jambe gauche et la main droite.»
Le texte oppose Candide et Cacambo, les blancs au nègre.
D’un côté nous avons
Candide et Cacambo qui sont actifs à travers les verbes de mouvement : ils
“s’approchent”, ils se déplacent tandis que l’esclave est immobile “étendu par
terre” et mutilé.
L’incapacité de bouger et la position aussi bas que terre
symbolisent l’absence de liberté et la bassesse de la condition sociale des
esclaves.
Nous avons ensuite une négation restrictive « ne … plus que » et une négation
lexicale « manquait » qui soulignent le dénuement du nègre.
Il n’a plus que la
moitié de son habit, mais on apprend immédiatement que son habit n’était en
fait qu’un caleçon de toile bleu.
C’est à dire moins de la moitié de ce qu’on
entend habituellement par un habit.
Syntaxiquement, tout ce qui manque à
l’esclave est mis sur le même plan : “n’ayant plus” fait écho à “il manquait”.
L’habit est ainsi mis en parallèle avec “la jambe gauche, la main droite”.
Ainsi la
moitié de l’habit dénonce en fait la réduction du personnage à une moitié de
Page 1 sur 5
corps humain.
Par ce procédé, Voltaire oblige le lecteur à reconstituer lui-même
les niveaux de gravité, et donc à s’indigner.
On enlève à l’esclave le nécessaire :
son habit, sa liberté, son corps même ne lui appartient plus.
Puis, l’adjectif péjoratif « pauvre » annonce la dimension pathétique de l’état
moral et social du personnage.
« Eh !
mon Dieu ! lui dit Candide en hollandais, que fais-tu là, mon ami,
dans l’état horrible où je te vois ? — J’attends mon maître, M.
Vanderdendur, le
fameux négociant, répondit le nègre.
— Est-ce M.
Vanderdendur, dit Candide,
qui t’a traité ainsi ? — Oui, monsieur, dit le nègre, c’est l’usage.»
En voyant l’esclave, Candide montre son émotion mêlant pitié et horreur en
utilisant une exclamation “Eh, mon Dieu !”, une interrogation “Que fais-tu là ?” et
une apostrophe “mon ami”.
En même temps qu’il proclame son égalité et son
affection avec l’esclave « mon ami », il s’indigne et s’interroge.
Candide fait
preuve pour la première fois d’un véritable jugement : il dénonce spontanément
cet état ”horrible”.
Cet adjectif fait écho au jugement de l’auteur “ce pauvre
homme”.
Candide et Voltaire parlent alors d’une même voix.
La réponse de l’esclave « J’attends mon maître » souligne encore son état de
dépendance ainsi que son appartenance à son maître.
Il est la propriété de celuici.
La paronomase (rapprocher des mots de sonorités voisines dans une phrase)
indiquant le nom du maître a une dimension symbolique, on y entend le métier
“vendeur” et le mot “dur” : cette dureté est accentuée par les allitérations en “d”.
C’est donc un vendeur qui a la dent dure.
L’adjectif « fameux » peut ainsi
prendre plusieurs sens : est-il célèbre pour sa richesse, pour sa dureté en
affaires, ou pour sa cruauté ?
Le personnage du nègre de Surinam, de par sa politesse non feinte “Oui
Monsieur” tient un discours de vérité.
Le présentatif « c’est l’usage » souligne la
traite des noirs juridiquement, elle est encadrée par ce qu’on appelle le code noir
depuis 1685.
En disant “C’est l’usage” l’esclave explique cela sans ressentiment,
sans se plaindre.
Il n’y a aucun pathos dans ce passage : on ne nous parle pas
du tout de la douleur des amputations.
Le terme “usage” passe sous silence
l’horreur de la mutilation en indiquant qu’elle est pratiquée systématiquement,
froidement.
Et l’auteur l’utilise de façon ironique car le texte repose sur une prise
de distance entre ce qui est écrit (c’est l’usage/normal) et ce qu’il faut penser de
cet usage.
L’absence de révolte de l’esclave oblige le lecteur à s’approprier le
sentiment d’indignation.
«On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement deux fois l’année.
Quand
nous travaillons aux sucreries, et que la meule nous attrape le doigt, on nous
coupe la main : quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe : je me
suis trouvé dans les deux cas.»
Le nègre explique le fonctionnement de l’esclavage.
Les règles du code sont
présentées en raccourci : les causes “la meule nous attrape le doigt”, “nous
voulons nous enfuir” sont juxtaposées aux conséquences violentes “on nous
coupe la main” “on nous coupe la jambe”.
La conjonction « quand » introduit
Page 2 sur 5
l’idée de leur application qui apparaît immédiate, implacable, disproportionnée.
De plus, une dimension ironique apparaît à travers le parallélisme « quand nous
[…] la jambe » car son maître devrait le garder intact pour qu’il puisse encore
travailler.
La tournure passive de la phrase “Je me suis trouvé dans les deux cas”
révèle justement que l’esclave ne fait que subir, toute liberté et toute volonté lui
sont refusés.
D’ailleurs, les personnes responsables de la traite des noirs sont également
présentes dans ce passage, mais de manière très impersonnelle : comme-ci elles
n’avaient pas de nom, pas de visage.
Plusieurs fois, le pronom indéfini “on” est
utilisé : “on nous donne”, “on nous coupe”.
Ce qui est sûr, c’est que ce “on” qui
est utilisé pour les maîtres s’oppose au “nous” qui est utilisé pour les esclaves
avec une dimension collective : “nous travaillons”, “nous voulons”.
Voltaire
montre ainsi que les personnes dominées sont humaines, tandis que les
dominants se conduisent sans humanité.
«C’est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe.
»
On remarque le passage de « on » à « vous ».
Ici, Voltaire s’attache à montrer
que la situation de l’esclave engage la responsabilité des êtres humains,
notamment des occidentaux qui consomme le sucre avec la deuxième personne
du pluriel qui est utilisée ici “vous”.
Par cette phrase, le conte devient pamphlet
(= court récit satirique attaquant avec violence un gouvernement, une institution
ou un personnage connu).
Voltaire met en évidence, le décalage monstrueux
entre l’insouciance des....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Analyse du Candide de VOLTAIRE .
- Analyse linéaire Cyrano de Bergerac - La scène du balcon
- Analyse linéaire : le dernier feu Les vrilles de la vigne
- Séquence 3 : Le Malade imaginaire de Molière. Analyse linéaire n°12 scène 10 acte III
- Analyse linéaire la princesse de Clèves - Analyse linéaire L’apparition à la cour